« Je traverse de nouveau une crise (elles sont récurrentes). Si je ne réussis pas à colmater les trous, je vais finir par prendre l’eau, couler. » Touché, coulé, le dernier livre de Jean-Pierre Ferrini À Belleville laisse son lecteur en état de knock out, sonné comme après un uppercut de Mike Tyson, ou plutôt de Jean-Claude Bouttier, puisque des années 1970 il s’agit aussi dans ce livre, de Paris, d’un quartier, de la France. À Belleville est le livre du cinéma intérieur, celui qu’appelait de ses vœux Marguerite Duras : faites votre film à partir des romans, fermez les yeux, creusez en vous pour laisser monter les images et les émotions.
Treize photographies de François-Xavier Bouchart accompagnent le récit. Treize photographies lie de vin aux couleurs – vintage – du Kodachrome : celle des mondes engloutis. On croise beaucoup de personnages dans À Belleville :Édith Piaf, Charles Trenet, Daniel Pennac, Guy Debord, Willy Ronis. L’un des plus marquants est ZZZ (M’Hamed Azzouz) qui tient une maison de la presse dans la portion Jourdain de la rue des Pyrénées. ZZZ est une des figures de ces mondes engloutis, de ce passage du monde réel au monde virtuel. Le papier encré des journaux qui salit les doigts (celui dans lequel on enveloppait le poisson) tend à disparaître. Désormais chacun est dans son monde, sur son smartphone : Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, le cul, le Tiercé, 20 minutes. La Pravda de la pensée : ça ne communique plus que virtuellement. Oui, nous coulons tous parce que ce monde de chair nous manque. Ce monde où Ivan Curkovic le gardien de but yougoslave (c’était le temps de l’ex-Yougoslavie) de Saint-Étienne plongeait dans la boue à Split en 1974 et où nous sentions physiquement la neige, le froid dans le brouillard granuleux du téléviseur en noir et blanc. Ce monde-là n’était pas aseptisé, sécurisé - sécuritaire. Ce monde des ouvriers, ce monde des luttes, des enfants, ce monde des odeurs et des jardins, ce monde des terrains vagues et des chantiers, ce monde nous manque.
Il est aussi beaucoup question de chansons dans À Belleville. On fredonne la môme Piaf née dans le quartier, Charles Trenet, La dernière séance d’Eddy Mitchell, hommage au cinéma Le Féerique, au n° 146 de la rue de Belleville : « La photo sur le mot fin / Peut fair' sourire ou pleurer / Mais je connais le destin / D’un cinéma de quartier / Il finira en garage / En building supermarché / Il n’a plus aucune chance / C’était sa dernièr' séance / Et le rideau sur l’écran est tombé ». Le lecteur se promène dans Belleville avec le narrateur qui, muni de son carnet, regarde, note, observe. C’est un livre d’écrivain-photographe et de chanteur des rues. Le livre de la seule culture qui mérite d’exister et que la promotion économique s’emploie à détruire : la culture populaire. Marcher dans les rues, aller au hasard. Les temps changent – oui – mais il reste à écrire le poème qui demeure en scrutant les signes, les restes, les façades, les visages.
En littérature, seules les drogues dures font battre le cœur. Comme dans les chansons d’Alain Bashung, dans le récit de Ferrini, on prend le bus et en avant, on fonce ! Les images apparaissent puis s’envolent à travers le viseur de l’écrivain. Dans À Belleville il y a le noir et blanc années 1950 de Willy Ronis ou de Jacques Becker (Simone Signoret dans Casque d’Or), il y a la couleur Kodachrome des images encore trop méconnues de François-Xavier Bouchart. On goûte aux parfums oubliés des DS et des Dauphine, ces bagnoles des albums de famille seventies et de l’Instamatic Kodak. Mais désormais en 2021, les appareils photo, devenus numériques, ne se contentent plus d’enregistrer des images fixes et Jean-Pierre Ferrini peut adopter un mode vidéo pour balader sa caméra dans son quartier : « VIDÉO. Dans la rue, un Africain parmi la foule regarde anxieux les pompiers qui éteignent l’incendie d’un immeuble. Une banderole réclamait le relogement. VIDÉO. Dédé assis sur le trottoir avec son acolyte insulte les dealers de la Rose des sables, braille en grasseyant des « connards ». Il habitait au bout de la rue. » Dans cemalström, chaque lecteur pourra, à travers le récit,générer ses propres images ou méditer avec Ibsen, Bernanos ou Baudelaire sur le progrès, la laideur, le triomphe des imbéciles, les machines à bourrer le crâne, l’inquiétude ou le réchauffement climatique. Ferrini note à la fin de son livre, dans sa Coda, une réponse de James Joyce à W. B. Yeats à propos de l’extension des villes et de la laideur du monde moderne : « Les généralisations ne sont pas faites par les poètes ; elles le sont par les hommes de lettres ; elles ne servent à rien. » C’est le rôle de poètes que de sauver les mondes engloutis, préserver, transmettre ce qui reste d’une humanité, de la vie des hommes, de l’Histoire et des vaincus.
Il faut lire À Belleville comme un livre furieux, un livre de désabusement et de colère, un livre d’amour et de nostalgie, un livre qui dépeint toutes les palettes d’un quartier et des états d’âme du narrateur. Désormais il faudra foutre le camp, partir. Oui, mais où, où, où ?
Nous attendons désormais la prochaine étape de Ferrini, son prochain camp de base, son nouveau feu. À Belleville nous laisse une belle empreinte, un tatouage au cœur et je pensais en refermant son ouvrage – les associations mentales sont ce qu’elles sont – à l’émouvante version de la chanson Always on my mind reprise par Elvis Presley et le Royal Philarmonic Orchestra en mars 1972. Les beaux livres sont comme les histoires d’amour, ils restent toujours dans notre esprit.
[Daniel Challe est photographe.]
Daniel Challe
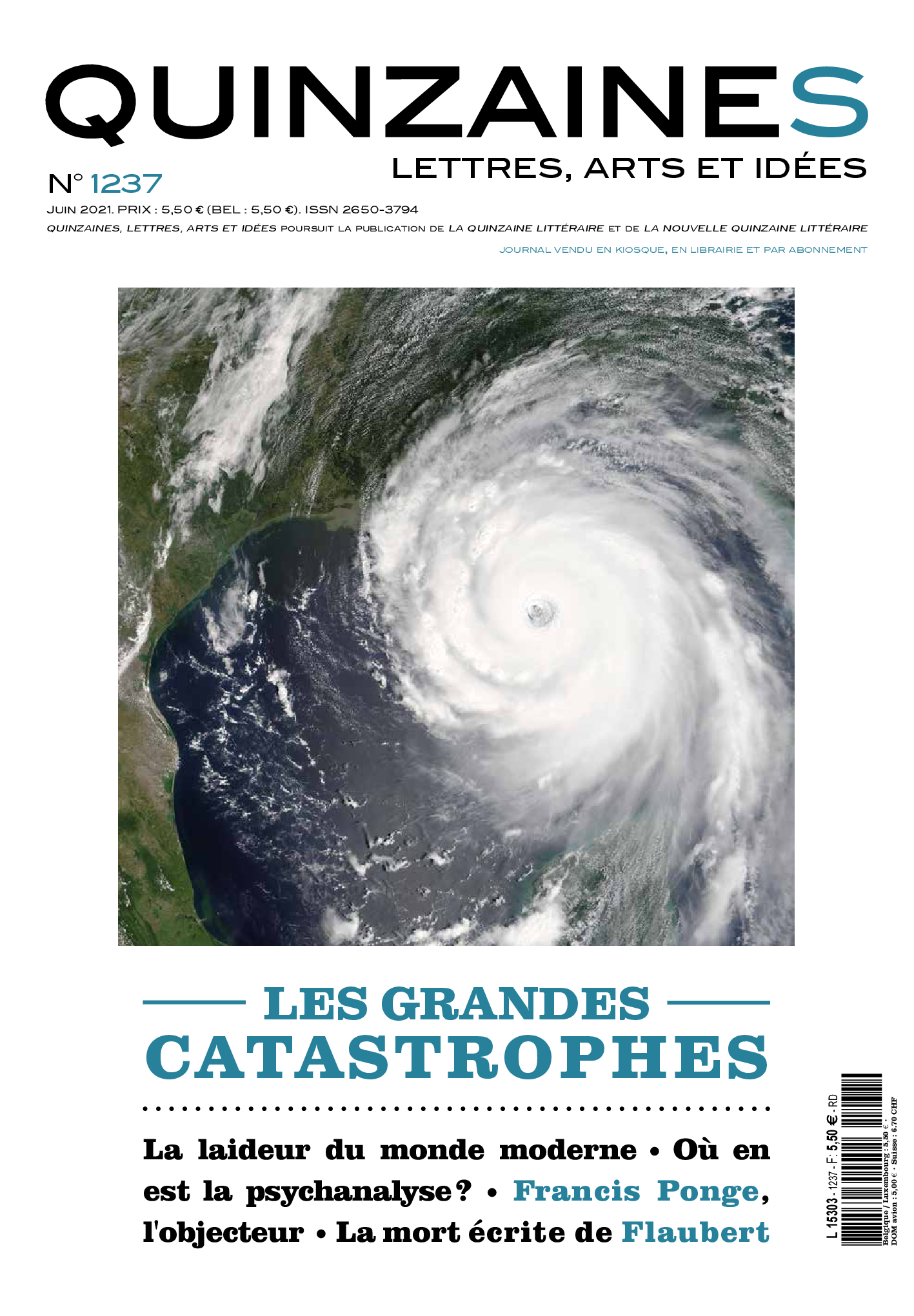

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)