Au terme d’une semaine d’entretiens que nous avions eus, en 1975, dans son atelier de Palma, Miró me disait : « Ma peinture ce n’est pas du tout un journal secret. C’est une force d’attaque qui s’extériorise (1). » Qui s’extériorise en mouvements, en figures, en signes. Parmi ces derniers, les plus constants, à partir du milieu des années 20, l’échelle, le sexe féminin et l’oiseau. Ce sont les éléments figurés du langage de Miró, l’art poétique d’un peintre qui se reconnaissait chez les poètes, qui chaque jour revenait à Rimbaud. En treize salles (treize, chiffre magique pour Miró qui l’a peint), salles de dimensions favorables au regard et à la réflexion est bâti le parcours de Miró : œuvres climatériques et chefs-d’œuvre se recouvrant.
Parmi ceux-ci, neuf des Constellations dont la série, dispersée aux quatre coins du monde comptait vingt-trois de ces petites peintures sur papier, à la gouache et à l’aquarelle, composées par Miró, qui y attachait une importance extrême, en 1939-1940, d’abord à Varengeville, puis en Espagne. Les deux premières Constellations de cette série célèbre lèvent le voile sur le regard de Miró, le sien et la façon dont la peinture – où l’œil est une figure quasi constante – nous regarde. Les deux premières Constellations s’enchaînent : Le Lever du soleil et L’Échelle de l’évasion. Le Lever du soleil est à la naissance de la lumière, du noir initial au vert final, dans l’exploration de ces paysages tragiques. Dans la gouache, le soleil est noir, nervalien. Un soleil répété trois fois, trois soleils noirs dont deux réunis, comme l’écrira en 1958 Breton, par un « ménisque d’interférence », dessinant, en rouge la forme d’un sexe féminin devenu le signe héraldique régnant sur tout un œuvre que Miró désignait d’un mot, « coït ». Un coït généralisé, de la terre et des étoiles, un coït qu’il retrouvait chez Georges Bataille dont il inscrit le nom sur un tableau avec celui de Michel Leiris et le sien (1927).
L’Échelle de l’évasion, deuxième constellation, est rouge et noir. Elle pointe vers une lune marquée de bleu. Le bleu de la tache que désigne le tableau Ceci est la couleur de mes rêves (1925). L’échelle s’élève parmi une pullulation de gnomes, de monstres, de larves. Et en bas de la feuille, minuscule, la reprise du ménisque-sexe de l’œuvre précédente.
Le sexe féminin, né d’une racine en germination, et l’œil coexistent depuis 1924. Dans un dessin du MoMA, intitulé La Famille. Les signes du langage de Miró y sont là à l’état naissant. Y compris le plus fréquent et le plus ambigu des signes de ce langage : la moustache, issue, me semble-t-il, de la photographie du père de Joan Miró, moustache qui deviendra galbe des seins, bras levés, corps de la femme…
On trouvera à la Tate une peinture, de 1917, Nord-Sud, qui est l’œuvre la plus chargée de références, de rencontres, de voies ouvertes à la lecture, aléatoire, d’un art poétique : une syntaxe à déchiffrer.
Plusieurs lectures à la fois. Des objets divers apparentés par une même structure : le double cercle, qui unit fleurs, ciseaux, mangeoires d’une cage à oiseaux. Une grande inscription en majuscules barrant le centre du tableau, « Nord-Sud » : la ligne de métro qui joint Montmartre et Montparnasse et, le nom donné par Pierre Reverdy à sa revue. Une pomme, cézanienne. Une cruche ornée d’une arabesque où l’on peut reconnaître le chemin du regardeur passant d’un objet à un autre, d’une vue à une autre.
Mais aussi deux pierres d’achoppement déposées par Miró sur notre chemin. Un livre jaune dont la couverture porte le nom de Goethe. On peut reconnaître dans la mention de ce nom l’auteur du Traité des couleurs et des Affinités sélectives. On peut aussi y lire une référence à l’opposition de Miró au néoclassicisme méditerranéen.
Deuxième pierre d’achoppement, « l’objet » qui sous l’inscription Nord-Sud occupe le centre de la peinture : un étrange objet, un objet sans nom, un objet elliptique – ellipse de la forme, ellipse du sens. Tout son corps est composé d’une gamme de couleurs pures alignées. Comme la réponse, en peinture – comme disait Cézanne – à toute langue. Dans la revue Nord-Sud, Apollinaire écrivait alors :
« Ô bouches l’homme est à la recherche d’un nouveau langage
Auquel le grammairien d’aucune langue n’aura rien à dire. »
Le langage de Miró dès ses débuts déconcerta. La Ferme, tableau célèbre qui appartint à Hemingway, est à l’exposition. Miró avait beaucoup travaillé à La Ferme (1921-1922). Achevé, le tableau est refusé partout. Un marchand avait trouvé une solution. Soixante ans plus tard Miró en resté marqué : « Je vous ai parlé de cet imbécile de Paul Rosenberg qui avait eu l’idée de couper la ferme en quatre ! Il m’a dit ça ! »
La Ferme est une étape fondamentale. Mais aussi un nouveau départ. S’il avait répété ce qui avait été acquis il serait, selon ses mots : « Devenu un virtuose, cette virtuosité que je critique chez Picasso malgré la grande admiration que j’ai pour lui. »
Pas de Guernica chez Miró. Mais à l’exposition La Nature morte au vieux soulier (1937), dont Jacques Dupin a précisé les raisons de l’étrangeté et de l’importance de cette œuvre : « La Nature morte au vieux soulier est le Guernica de Miró. Elle n’illustre pas un épisode de la guerre civile, elle ne représente pas les horreurs de la guerre, mais elle exprime cela, tout cela, telle que la conscience en est affectée jusque dans ses rapports avec les objets quotidiens » (Miró, p. 210).
En 1944 la série de gravures Barcelona est fondée sur l’horreur de la guerre montrée par les bourreaux à visages découverts. Trente ans plus tard, dans les triptyques, le visage des bourreaux n’apparaît plus. Sont réunis à la Tate, réunion exceptionnelle, L’Espoir du condamné à mort de la Fondation Miró à Barcelone, les trois Bleus de Beaubourg, les trois peintures murales jaune-orangé, vert, rouge, que parcourt une trace linéaire. De 1968 date Peinture sur fond blanc pour la cellule d’un solitaire, une ligne animée par le tremblement de la main. En 1974, tout au contraire, l’éclat, le faisceau de lignes et de taches Feux d’artifice.
Il avait jadis, pour un timbre ou une affiche, tracé une figurine dans Aidez l’Espagne. Sous le personnage brandissant le poing Miró avait écrit cette phrase : « Dans la lutte actuelle, je vois du côté fasciste des forces périmées, de l’autre côté le peuple dont les immenses ressources créatives donneront à l’Espagne un élan qui étonnera le monde. » Bien des années plus tard, en 1974, le combat n’est pas terminé. Miró peint L’Espoir du condamné à mort. Il avait retracé pour moi la genèse de cette œuvre dont il a fait don à la Fondation Miró pour qu’elle reste à jamais à Barcelone :
« Il y a des années, sur une grande toile, j’avais peint un trait, un petit trait blanc ; sur une autre un trait bleu. Et puis un jour c’est venu… Au moment où on a garrotté, ce pauvre garçon, catalaniste, Salvador Puig Antich. Je sentais que c’était ça. Le jour où il a été tué. J’ai terminé cette toile le jour où il a été tué. Sans savoir. Sa mort. Une ligne qui allait s’interrompre. Ce n’est pas du tout une coïncidence intellectuelle. Une coïncidence un peu magique… Ou je ne sais comment dire. »
1. Miró, Ceci est la couleur de mes rêves, entretiens avec Georges Raillard, Le Seuil, 1977, réédition 2004.
Georges Raillard

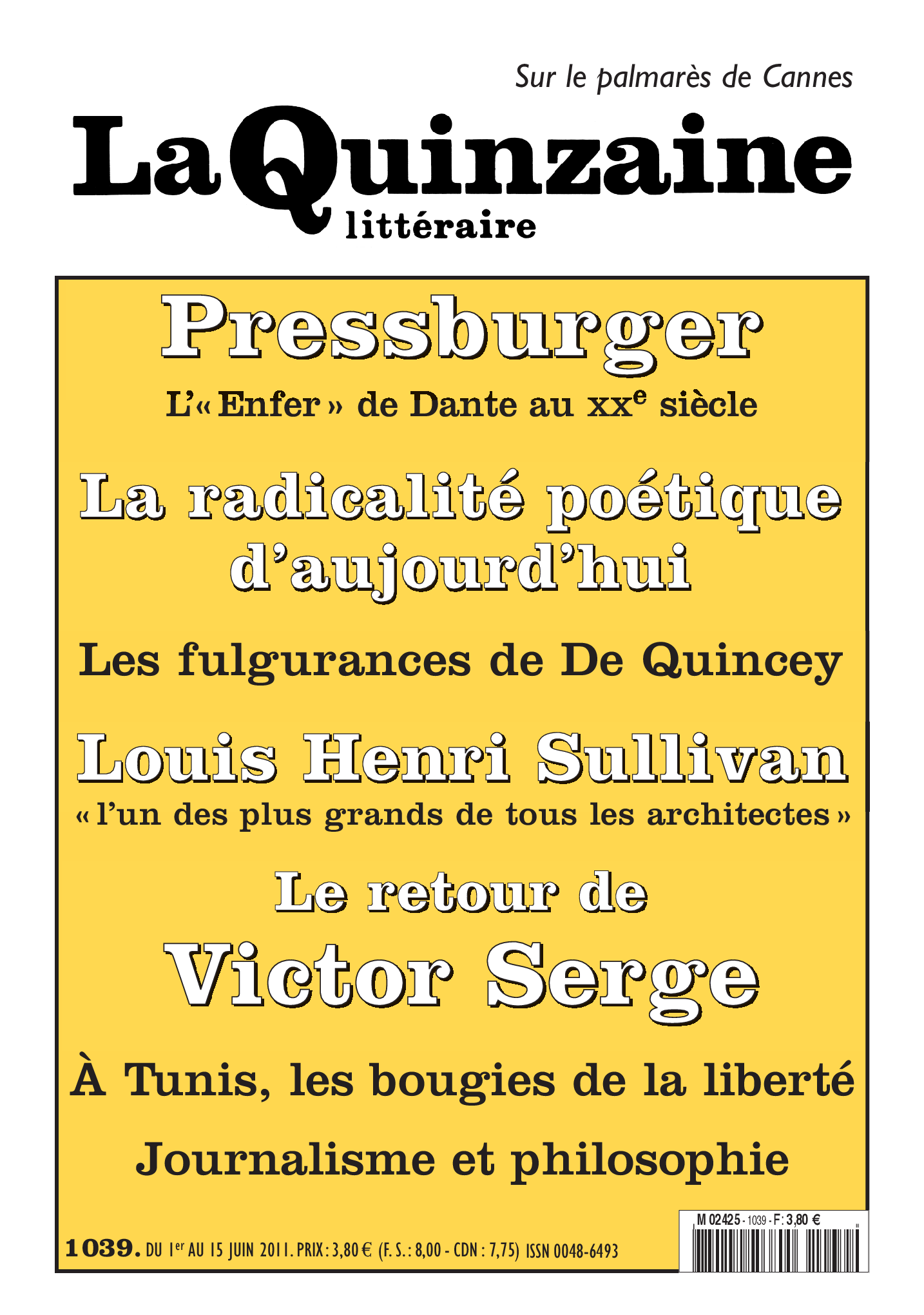

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)