Si nous citons ces films, c’est parce que, vus une seule fois en janvier 2003, leur puissance et leur beauté (celle de Room est plastiquement magnifique) nous ont laissé un souvenir intact – ce qui n’est pas l’apanage de beaucoup parmi les quelques milliers consommés depuis. La Commissaire n’était pas, sauf erreur, dans le programme, tous les blockhaus n’ayant peut-être pas encore été ouverts. Nul doute, sinon, que le film d’Alexandre Askoldov aurait figuré parmi les grandes découvertes, au même titre que La Porte d’Ilytch (1963) de Marlen Khoutsiev (1), chef-d’œuvre longtemps amputé, ou Le Nœud serré (1957) de Mikhaïl Schweizer.
L’interdiction des films en URSS ne date pas de Jdanov et du réalisme socialiste, puisque dès 1926 des œuvres furent modifiées puis bloquées, pour cause de « mauvais point de vue de classe » ou de « propagande anarchiste occultant le rôle du Parti ». Pas plus qu’elle ne prit fin avec le dégel khrouchtchévien ou la publication en 1962 d’Une journée dans la vie d’Ivan Denissovitch – au contraire, c’est même à partir de 1966 que « les films furent “mis sur l’étagère” (interdits) non plus un par un, mais par paquets » (2) et que Serguei Paradjanov, Ivan Tarkovski, Elem Klimov ou Gleb Panfilov eurent à subir les tracasseries de la censure – coup de froid que connurent au même moment quelques cinématographies « socialistes », comme la polonaise ou la tchèque. Et c’est en 1967 que La Commissaire passa à la trappe, en principe définitivement.
Mais c’était sans compter une organisation bureaucratique bien rodée, lumière dans le désastre. En 1948, avait été créé officiellement le Gosmofilmfond, responsable de la conservation et de l’enrichissement des collections – en réalité l’organisme fonctionnait sous un autre nom depuis 1937. Car Staline se faisait projeter des films chaque soir et voulait toujours du nouveau. Il fallait donc alimenter la machine, et le Gosmofilmfond récupérait tout le matériel tourné, autorisé ou non – on peut même imaginer que Staline se délectait, dans la solitude, de films « déviants ». Ainsi que le déclarait son directeur en 2002, « la majeure partie des films interdits n’a pas été détruite, pas davantage les films qui avaient été critiqués durement. Chacun se rendait compte que la situation pourrait changer un jour. Personne ne pouvait dire ce qui arriverait dans l’avenir. À tout hasard, il était plus intéressant de conserver… ». Et il ajoutait : « En principe, on cherchait à ne pas interdire les films, parce que c’était toujours une sale affaire : pour le ministre, pour son vice-ministre, pour le directeur du studio… et personne n’y tenait. On faisait autre chose : le film était formellement distribué, mais on ne tirait pas de copies. Dans le cas de La Commissaire, il y a eu une véritable interdiction, avec ordre du ministre. Tous les éléments, y compris les doubles, ont été déposés chez nous. Et nous avons conservé ces centaines de bobines (2). »
Ce qui a permis au film d’Askoldov, venu le temps de la perestroïka, d’émerger de son placard (3) (selon les témoignages, grâce à une intervention directe de García Márquez auprès de Gorbatchev) et, présenté au Festival de Berlin 1988, d’y décrocher l’Ours d’argent. Malheureusement, un succès berlinois n’est pas toujours suffisant pour justifier une exploitation (on le voit en ce moment, avec La Poussière du temps, de Théo Angelopoulos, qui a mis quatre années pour parvenir de Berlin jusqu’à nos écrans) et La Commissaire est demeuré inédit en France. Cette première édition en DVD est donc un événement – enfin pouvoir savourer ce brûlot !
La première réaction est l’étonnement : quelles raisons profondes ont pu conduire les censeurs de 1967 à tuer le film (on a annoncé au cinéaste que la copie avait été pilonnée) ? Le prétexte avancé – La Commissaire était prosioniste – est effarant. Le fait de montrer une famille juive heureuse et dévouée à la protection de la commissaire du peuple placée chez eux durant quelques mois, le temps qu’elle accouche et nourrisse son enfant avant de rejoindre les troupes – nous sommes en 1922, à la fin de la guerre civile – était donc une attitude si condamnable, au lendemain de la guerre des Six Jours ? Ou la phrase dite par Yefim, le rétameur : « Un pouvoir est parti, l’autre n’est pas encore là. Ni contribution, ni pogrom » ? Ou les quelques plans très courts de raflés porteurs de l’étoile jaune et de déportés en tenue rayée (un flash forward d’ailleurs inutile, seul moment trop insistant du film) ? Qu’est-ce qui a valu à l’auteur une telle excommunication ? Car l’interdiction s’est doublée d’un brevet « d’incompétence », d’un procès pour dilapidation des finances de l’État, d’une exclusion du Parti et d’une radiation de l’Union des cinéastes – Askoldov n’a jamais pu retravailler et a d’abord survécu comme ébéniste, avant de s’expatrier, d’écrire des romans et de refaire surface pour accompagner la résurrection de La Commissaire.
La stupeur passée, on peut apprécier le film pour ce qu’il est : une œuvre superbe, d’une simplicité et d’une intelligence narrative rares, qui sait allier sans solution de continuité réalisme et lyrisme, scènes intimes et scènes guerrières – et parfois les réunir à l’intérieur d’une même séquence, comme dans cet instant assez terrifiant des enfants jouant à la guerre et recréant peu à peu un véritable pogrom. La nouvelle d’origine est signée Vassili Grossman, elle pourrait aussi bien venir d’Isaac Babel, et la scène d’ouverture, lent défilé de cavaliers dans un paysage désert, semble sortie de Cavalerie rouge. La guerre est là, constamment présente, et jamais vraiment montrée, réduite à une stylisation, des soldats qui marchent, des chevaux non montés qui galopent, une charge à l’ancienne en courant sabre au clair, un canon que l’on s’échine à sortir du sable (avec un mouvement de caméra digne du Mikhaïl Kalatozov de Soy Cuba) – en définitive, ce sont les enfants qui en fabriquent la plus juste représentation. La commissaire (Nonna Mordyukova, revue beaucoup plus tard dans La Parentèle de Nikita Mikhalkov) est parfaite, dure, large, mutique, avec le glamour d’une kolkhozienne de choc, et son humanisation, lorsqu’elle se promène au marché, son nourrisson dans les bras, découvrant qu’il existe un autre univers que celui des combats, est touchante. Attendrissement fugace : elle laissera son enfant à la famille d’accueil – quand il y en a pour six, il peut y en avoir pour sept – et rejoindra sa compagnie, aux sons de L’Internationale, dans le noir et blanc inoubliable des années soixante. La fin pourrait être édifiante, replacée dans l’Ukraine de 1922, elle est plausible : la Révolution n’attendait pas.
On peut rêver sur les autres films qu’Alexandre Askoldov aurait pu tourner, en des temps plus cléments. Quoique… Il déclare, dans un des bonus : « J’étais naïf. Je croyais que l’art peut changer le monde. Les gens allaient voir mon film et se mettre à vivre autrement. » Fraîcheur sympathique – mais on comprend, interdiction ou pas, qu’il n’était pas formaté pour faire carrière.
- Ou Huciev, selon la forme désormais adoptée dans les travaux universitaires, transcription que nous persistons à ne pas utiliser : Sklovskij reste Chklovski et Cuhraj reste Tchoukhraï.
- Vladimir Dmitriev, in Gels et dégels, Une autre histoire du cinéma soviétique, 1926-1968, sous la direction de Bernard Eisenschitz, Centre Pompidou/Mazzotta, 2002
- Encore que difficilement : Askoldov raconte, dans un des suppléments du DVD, comment, alors que des dizaines de films étaient autorisés en 1986, la sortie du sien fut refusée par Serguei Bondartchouk.

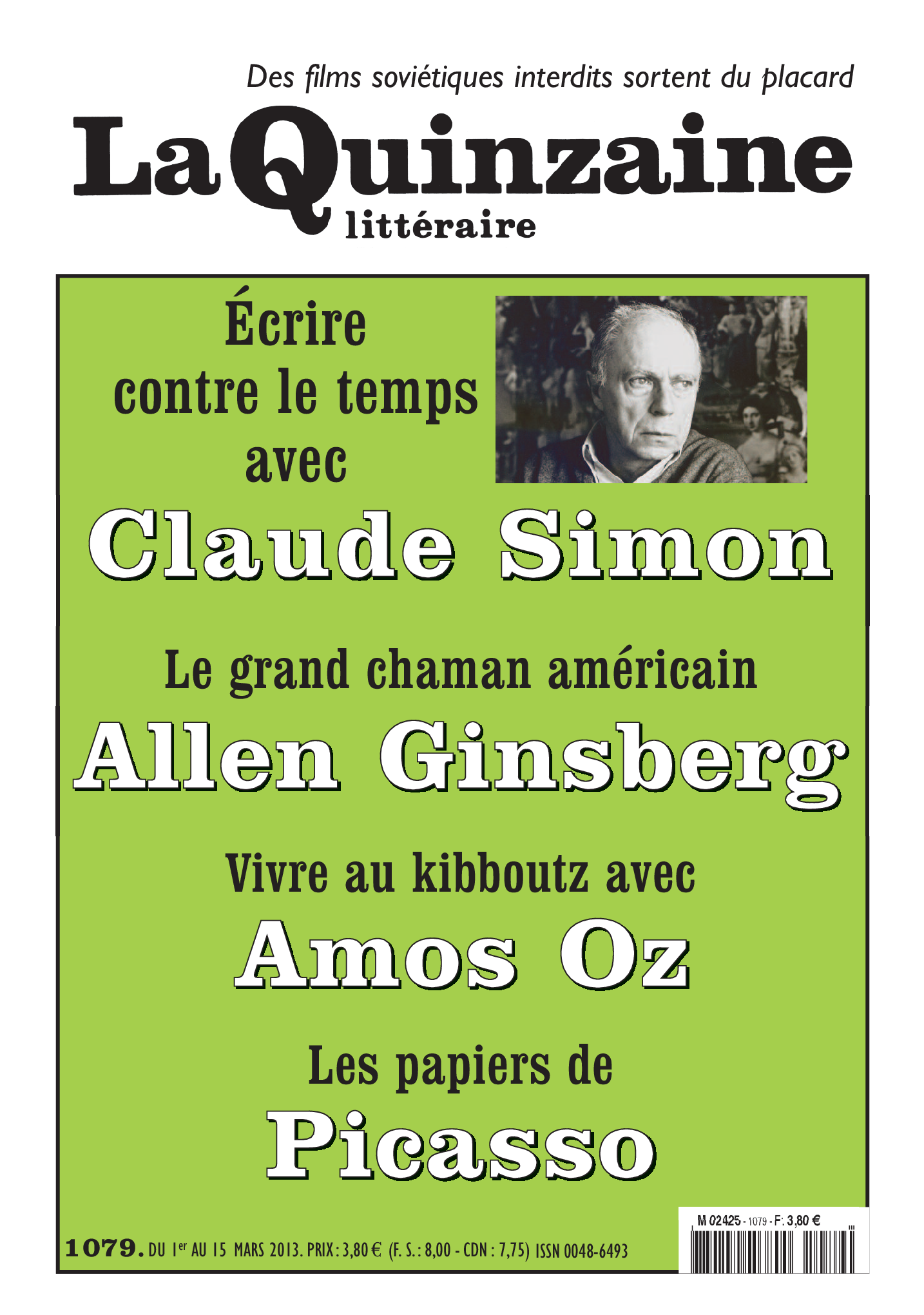

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)