Annie Franck : Votre histoire, avec ce qu’elle comporte d’un héritage de la grande histoire, vous a personnellement sensibilisée à la présence des fantômes. Comment ceux-ci se sont-ils manifestés pour vous ?
Janine Altounian : Les enfants des survivants, nés dans l’ombre d’une catastrophe qui a englouti un million et demi d’êtres humains et leur culture, vivent sous la présence écrasante de fantômes, qui les affecte au plus intime d’eux–mêmes. C’est une histoire qui, comme celle de toutes les exterminations, exige d’être pensée à la fois dans sa portée générale et dans sa dimension la plus singulière… C’était un poids qui, dans ma famille, poussait à une énergie agressive, à la volonté de se créer une sécurité à tout prix, à la nécessité de travailler pour combattre et tenir à distance la présence des fantômes. Pour moi, par exemple, aller à l’école de la République et en profiter au maximum représentait une chance inestimable et un devoir incontournable sur fond d’une catastrophe.
AF : Parlait-on directement de ce cataclysme humain dans votre famille ? Comment en avez-vous pris conscience ?
JA : Non,on ne parlait pas directement des épreuves et des massacres… Mon père et ses amis parlaient parfois de certains épisodes de leur « exode » dans une langue (le turc) que je n’étais pas censée comprendre : les écouter était, pour moi, enfant, comme entendre un récit d’aventures extraordinaires dans des déserts, avec des dromadaires, dans un ailleurs et un passé presque fabuleux… Pourtant, l’héritage traumatique était omniprésent : l’histoire se manifestait en continu par une certaine austérité et par cette violente énergie à travailler ; mes parents travaillaient énormément ; toutes nos forces devaient être mobilisées pour contrer le passé, recréer une existence « normale », ici, en France. « Il faut, il faut » était le maître-mot… qui laissait apparaître en creux une réalité – énigmatique, car il n’y avait pas de mots possibles – dont il « fallait » se défendre, à laquelle il « fallait » échapper… Une menace inconnue, qui avait autrefois pesé dangereusement sur les parents, là-bas, d’où ils venaient, était toujours présente.
AF : Des fantômes innombrables entouraient ainsi votre vie familiale, agissant silencieusement, puisque les mots ne leur donnaient pas directement place. Les mots de ces fantômes pour témoigner directement de la terreur et du meurtre de masse ne pouvaient être ni hérités ni transmis par les rescapés, vos parents, car ces mots n’existent pas : cette horreur échappe à la possibilité d’être représentée, symbolisée, puis d’aller se loger éventuellement dans l’inconscient, refoulée ; elle demeure intacte, encapsulée. Sur le chemin pour vous approprier cet héritage qui vous avait été, néanmoins, en creux, transmis (je pense à la phrase de Goethe, citée par Freud : « Ce que tu as hérité de tes pères, pour le faire tien, acquiers-le »), il y a eu un tournant décisif : celui de la rencontre, assez tardive pour vous, avec le manuscrit laissé par votre père concernant son exode, alors qu’il avait 14 ans. Pouvez-vous dire en quoi cette découverte a été déterminante pour vous ?
JA : C’était en 1978, dix ans après le début d’une première psychanalyse, terminée alors. Ce fut un bouleversement pour moi. Ce manuscrit – écrit sur un cahier d’écolier, abandonné au hasard de son destin au fond d’une armoire, puis donné par ma mère huit ans après la mort de mon père – était rédigé en caractères arméniens, dans un dialecte turc parlé par les Arméniens turcophones d’une partie de l’Anatolie ; je réussis à trouver un traducteur. Le manuscrit s’intitulait Tout ce que j’ai enduré de 1915 à 1919. Il relatait, au plus près des événements, dans la langue d’un tout jeune homme dont les études avaient été interrompues brutalement et sans la présence d’une réflexion subjective, le périple de plus de 2 500 km, à partir du 10 août 1915, de cet adolescent, son plus jeune frère et leurs parents. Ce périple est ponctué de moments de terreur et de souffrance, évoqués entre les lignes d’un récit quasi factuel, qui ne fait que mentionner la faim, la boue, les exactions autour d’eux et le décès rapide du père, mon grand-père.
Ce texte m’a obligée à réorganiser psychiquement tout ce que j’avais jusque-là réussi à élaborer autour de l’histoire de ma famille. Un nouveau travail de traduction s’imposait, une nouvelle publication et, du fait de l’exposition de ce texte explosif, la constitution d’une nouvelle représentation de mon identité face au monde.
AF : La question de la traduction et du détour par une autre langue – celle du pays d’accueil – est sans doute l’une des idées les plus originales de votre long cheminement pour élaborer cet héritage du trauma de masse, de cet effacement d’une culture. En quoi ce « détour » par une traduction vous semble-t-il indispensable ?
JA : L’anéantissement d’un monde et l’assassinat de masse, avec leur effacement, sont des événements qui échappent radicalement à notre capacité de représentation. Il faut des superpositions de « traductions » pour parvenir à réintroduire cette indicible horreur dans le monde des échanges humains : d’abord, pour passer de la sidération à l’acte de dire l’absence même des mots, puis passer à des mots « factuels », seulement descriptifs, puis enfin à des mots « habités » qui, eux, vont pouvoir faire place aux fantômes. Cette succession de traductions, qui ne peut se faire que dans la langue de l’autre, celle d’une autre génération, d’une autre langue et d’une autre culture, laisse peu à peu apparaître les traces de la disparition d’une culture et de ses lieux, et peut en inscrire l’effacement. Pour résumer, je dirais qu’elle se décline selon les orientations suivantes :
– Une expérience d’effacement demande à être traduite dans la langue de l’autre pour s’inscrire dans le monde.
– C’est par ce travail de traduction que les héritiers d’un crime de masse peuvent subjectiver et transmettre leur histoire.
– Ce travail de traduction requiert plusieurs générations, avant que ce qui a pu être « traduit » au « pays d’accueil » s’inscrive dans le champ culturel et politique de celui-ci.
AF : Dans un texte à paraître, vous citez cette forte phrase de Walter Benjamin : « Les morts, eux aussi, ne seront pas en sécurité devant l’ennemi, s’il triomphe. Et cet ennemi n’a pas cessé de triompher. » Pensez-vous que votre principal moyen de lutte contre le triomphe de cet ennemi consiste à écrire ?
JA : Quelle bonne question ! Quand j’ai commencé à écrire (mon premier article est publié en 1975 aux Temps modernes et se retrouve dans mon livre de 1990), il fallait que je « dise » quelque chose de caché en moi pour qu’on ne se méprenne pas sur l’apparence de personne « normale » que je présentais aux autres. J’ai, depuis, poursuivi d’écrire dans cette posture, chaque fois que je m’y sentais contrainte. À présent, avec un « dernier » livre qui va paraître (« dernier » au sens d’un testament, car je pense avoir dit tout ce que j’avais à dire), je souscris totalement au pessimisme lucide du philosophe : je suis née de migrants des années 1920. Au bout d’une génération, grâce à un travail acharné mais possible, grâce à la laïcité permettant l’intégration et à l’ascenseur social qu’était l’école de la République, leurs enfants ont pu avoir un toit, du pain, un accès aux études, au travail de la pensée, et même le désir d’écrire l’histoire de leurs ascendants dans des livres. À présent, cette situation « privilégiée » est devenue caduque : pour les migrants d’aujourd’hui, la violence de notre temps a trouvé un moyen moins coûteux d’ôter la vie que pendant les exterminations de masse : elle interdit aux humains « en trop » tout lieu où vivre. Cette répétition de l’histoire me rend désespérément pessimiste, et je me contente d’interroger les jeunes générations sur les moyens de lutter contre « cet ennemi qui ne cesse de triompher ».
AF : Vous soulignez aussi que le temps de trois générations est nécessaire pour transformer ces traumas avec, souvent, la reprise effective de ce lent travail psychique par trois générations successives.
JA : Effectivement, très rares ont été les témoignages directs, ou immédiatement postérieurs, des personnes impliquées dans les successions des catastrophes dont le XXe siècle s’est trouvé particulièrement marqué… Ainsi, ce n’est qu’en 1975 – soixante ans après – que la publication du livre de Jean-Marie Carzou, Un génocide exemplaire. Arménie 1915[1], me fit entendre, en moi-même, le silence sur les faits, jusque-là quasi méconnus, dont je sentais confusément les effets à la maison. Pour que l’élaboration psychique du trauma se mette en route, il faut, outre le déplacement dans le temps et l’espace que je signalais plus haut, que s’accomplisse un réveil par un événement dans le pays tiers, soit un événement culturel qu’est la rencontre avec un livre, soit un événement politique : il y eut, en septembre 1981, une prise d’otages au consulat de Turquie. Lorsque cette actualité rompit, dans ce qui était devenu « mon » pays, un silence de plus d’un demi-siècle sur le génocide arménien, il interrogea alors un silence lové en moi, et je sentis subitement que mon père aurait approuvé cet acte, s’il avait été accompli de son vivant…Je n’ai pu publier le texte de mon père aux Temps modernesqu’après cet acte de violence et grâce à lui. Sans l’intérêt éveillé par cet événement qui fit scandale, ce journal de déportation n’aurait trouvé aucun accueil éditorial – ce que je ne manque jamais de souligner pour mettre en évidence l’interrelation du travail psychique et de l’environnement politique.
AF : La question d’un événement qui fait surgir brutalement le passé occulté et lui donne une présence nouvelle est essentielle – vous le soulignez avec force – ainsi que cette interrelation du travail psychique et de la situation politique. Mais, précisément, ne pensez-vous pas aussi que la revue Les Temps modernes a été – grâce à votre lettre à Simone de Beauvoir – en mesure d’accueillir ce document en raison du contexte plus global, où l’interrogation sur le fait génocidaire avait pris une ampleur inédite, dans la suite de la Seconde Guerre mondiale ?
JA : Il y a eu bien sûr un lent travail psychique au fil des générations successives, concernant les génocides, une élaboration qui s’est approfondie, génération après génération. La convergence des traumatismes chez les rescapés de l’Holocauste, qui, eux, ont peu à peu témoigné de cette horreur et de son effacement(surtout après les années 1960), avec ces autres traumatismes mis sous silence, depuis 1915, chez les réfugiés arméniens (et leurs enfants), cette convergence donc a ouvert une réflexion de plus en plus nourrie concernant le travail psychique face au trauma, et face au trauma qui se répète à grande échelle. Les intellectuels français, les écrivains et les artistes ont davantage fait place à cette réalité humaine recouverte par le silence, car inaccessible à la parole dans un premier temps ; ils ont ressenti souvent comme une nécessité d’intégrer à la culture ce qu’implique, pour chacun – directement concerné ou pas –, la destruction acharnée d’une culture et son effacement, et l’effacement de cette destruction.
C’est dans ce contexte général que se déploie l’interrelation du travail psychique et de l’environnement politique. Je le remarque pratiquement chez tous les jeunes chercheurs qui, ayant lu mes écrits, souhaitent me rencontrer en vue d’un travail universitaire ou personnel. En voici un exemple qui m’a récemment frappée : lorsque, à une jeune psychologue qui avait constitué un dossier déjà très fourni sur l’internement dans un hôpital psychiatrique de son arrière-grand-mère, orpheline survivante du génocide arménien, je demandai ce qui l’avait incitée à entreprendre cette recherche, elle me répondit : « L’attaque, en 2005, par un groupe de jeunes militants turcs, de mon père et de mon frère qui tenaient, à Valence, un stand pour exprimer leur opposition à l’entrée de la Turquie dans l’Union européenne. Avant cet événement, qui m’en fit prendre brutalement conscience, je n’étais pas particulièrement attentive à mon héritage et à son histoire. »
[1]. Jean-Marie Carzou, Un génocide exemplaire. Arménie 1915, Flammarion, 1975, rééd. Calmann-Lévy, 2006.
Bibliographie
Janine Altounian, « Ouvrez-moi seulement les chemins d’Arménie ». Un génocide aux déserts de l’inconscient, préface de René Kaës, Les Belles Lettres, coll. « Confluents psychanalytiques », (1990), 2003.
Janine Altounian, La Survivance. Traduire le trauma collectif, préface de Pierre Fédida, postface de René Kaës, Dunod, coll. « Inconscient et culture », 2000.
Janine Altounian, L’Écriture de Freud. Traversée traumatique et traduction, PUF, coll. « Bibliothèque de psychanalyse », 2003.
Janine Altounian, L’Intraduisible. Deuil, mémoire, transmission, Dunod, coll. « Psychismes », 2005.
Vahram et Janine Altounian, Mémoires du génocide arménien. Héritage traumatique et travail analytique, avec les contributions de K. Beledian, J.-F. Chiantaretto, M. Fraire, Y. Gampel, R. Kaës, R. Waintrater, PUF, 2009.
Janine Altounian, De la cure à l’écriture. L’élaboration d’un héritage traumatique, PUF, 2012.

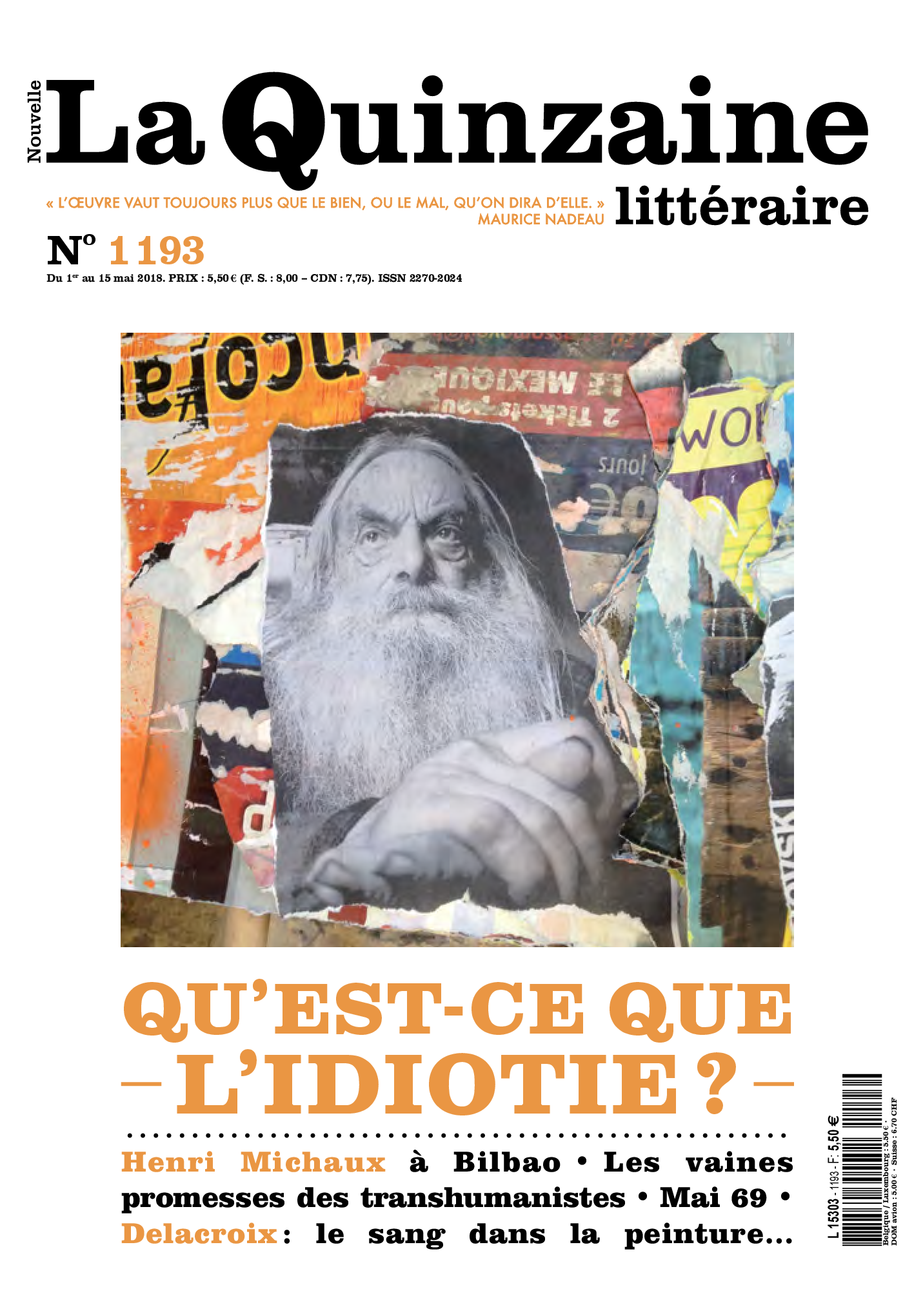

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)