Cette fin de printemps est placée sous le signe de l’Italie : La Cinémathèque de la rue de Bercy nous offre une rétrospective, partielle mais bienvenue, d’un genre, le film noir, que l’on n’associe que peu au cinéma transalpin et Carlotta distribue sur les écrans L’Assassin, un film si rare que l’on ne se souvenait pas, sauf erreur, de l’avoir revu depuis plusieurs décennies. La météo nous interdisant de paresser aux terrasses, profitons-en pour aller savourer quelques bouffées « à l’italienne », pour reprendre une expression qui a beaucoup trop servi.
Paradoxalement, Elio Petri a souffert de ses succès. Après l’Oscar du film étranger pour Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon (1970) et le Grand Prix (pas de palme encore à l’époque) de Cannes 1972 pour La classe ouvrière va au paradis, les quatre titres (dont un pour la télévision) qu’il tourna avant son décès en 1982 furent des échecs, même l’extraordinaire Todo modo (1976), nouvelle adaptation de Sciascia, dix ans après À chacun son dû, qui ne connut qu’une exploitation confidentielle. Au point que son ultime Buone notizie (1979) demeure inédit en France, comme le fut, jusqu’à ces derniers mois, Les Jours comptés (1962), qui n’a mis que cinquante ans pour nous parvenir. Petri est donc un grand réalisateur mal connu, peu fréquenté par les historiens français, à l’exception de Jean A. Gili, qui l’a décrit avec raison comme « un des analystes les plus lucides et les plus désespérés de la schizophrénie contemporaine ».
La schizophrénie n’est pas vraiment la caractéristique du héros inaugural de L’assassino (1961). Elle n’apparaîtra qu’à partir d’Un coin tranquille à la campagne (1968) avant de culminer dans les deux chefs-d’œuvre suivants. Alfredo Martelli, antiquaire sans histoires, brutalement confronté à la police romaine après l’assassinat de sa maîtresse, n’est encore qu’un personnage simple, sans épaisseur autre que celle de sa seule existence et du petit tas de faiblesses qui la composent. C’est l’emprisonnement – une garde à vue de quelques jours – qui, en provoquant un retour sur quelques traits de son passé et l’examen des faits qu’il détermine, va lui donner une dimension véritable. Il se sait non coupable, mais, tel Joseph K., la culpabilité qu’on fait peser sur lui le conduit à s’interroger – effectivement, il est coupable, de presque rien, d’avoir grugé les petites gens démunis qu’il a délestés de leurs objets pour quelques lires, d’avoir traité sa maîtresse avec légèreté et indifférence, d’avoir été incapable d’accorder à sa mère les quelques instants de tendresse qu’elle attendait. Et les larmes qu’il verse à sa sortie de cellule, au petit matin, sur le parapet du Tibre qui n’en peut mais, larmes de soulagement d’être libéré et de tristesse d’avoir compris qu’il n’était que ce qu’il est, sont le signe d’un passage : il ne sera pas exécuté comme le protagoniste du Procès, mais devra désormais faire avec sa culpabilité.
Le dossier de presse présente le film comme un « brillant piège criminel ». Ni piège, ni crime pourtant. Le meurtre a déjà été commis au début du film, il n’y a pas d’enquête, le véritable coupable est un individu anonyme, attrapé par hasard, L’assassino ne joue d’aucune des ressources du genre policier : tout se passe entre le bureau du commissaire (amateur de Morandi, comme le commissaire de Buñuel était amateur de Dalí et de Claudel) et la cellule de garde à vue, entre les interrogatoires feutrés des bureaucrates et les agressions des codétenus. Les seules échappées sont celles qu’effectue Martelli dans ses souvenirs, flash-back achronologiques qui marquent l’époque (le film est contemporain des premiers Resnais). Pas de suspens narratif – que l’antiquaire soit libéré ou non ne change pas le sens de la démonstration. Petri a défini son film comme « post-antonionien, sur un personnage aliéné, un film sur l’incommunicabilité ». On ne saurait mieux dire. Sinon ajouter que Mastroianni, en ce tout début des années 60, était déjà lui-même, et de part en part. Que Micheline Presle (seule actrice française à avoir tourné avec Pabst, Lang et Losey…) est toujours éblouissante. Que la beauté du noir & blanc argentique de ces belles années semble indépassable – les scènes ultimes dans la brume de l’aube romaine sont aussi belles que leurs équivalentes chez le Bolognini des Garçons ou le Fellini de La Dolce Vita.
Les amateurs de Petri pourront retrouver avec profit À chacun son dû, que la Cinémathèque a inclus parmi les 36 titres de son cycle « Films noirs à l’italienne ». Nous avons suffisamment renâclé devant certains programmes sans surprises de l’institution pour ne pas la féliciter lorsqu’elle s’aventure ainsi sur des sentiers moins balisés – il est vrai que les semaines qui précèdent la fermeture estivale sont souvent réservées aux goûteurs du second rayon : l’an dernier, les « Perles noires » américaines, en juillet prochain, tout Edgar G. Ulmer, qui va rassembler le carré de ses fanatiques. Le polar italien n’a été que peu étudié et répertorié, sinon par les spécialistes du cinéma bis – encore ceux-ci se sont-ils plutôt intéressés aux gialli sanglants des années 70 et 80, signés Sergio Martino ou Umbert Lenzi. Pas de dégoulinures ici, on reste en bonne compagnie, entre Visconti (Ossessione, 1943) et Michele Placido (L’Ange du mal, 2011), entre Alberto Lattuada (Le Bandit, 1948) et Giuseppe De Santis (Chasse tragique, 1946), entre Antonioni (Chronique d’un amour, 1950) et Francesco Rosi (Le Défi, 1958), entre Carlo Lizzani (Bandits à Milan, 1968) et Luigi Comencini (La Traite des Blanches, 1952), entre Pietro Germi (Le Témoin, 1945) et Pietro Germi (Traqué dans la ville, 1951). Mais outre ces grands noms certifiés (souvent avec des films très peu connus, comme ceux de Germi (2)), on trouve dans la liste des cinéastes un peu négligés aujourd’hui, tel Mario Soldati (Rapt à Venise, 1954) ou même oubliés, comme Gianni Franciolini (Phares dans le brouillard, 1942). De quoi prendre la dimension d’un genre que l’on assimile couramment à la seule Amérique – alors qu’il y a des joyaux dans le cinéma noir britannique de ces mêmes années (les films de Robert Hamer, par exemple). Parmi les œuvres que l’on connaît, recommandons La Fille du lac (Andrea Molaioli, 2006), avec un Toni Servillo remarquable, L’Étrange Monsieur Peppino (Matteo Garrone, 2002) et Deux grandes gueules (Sergio Corbucci, 1974) qui vaut mieux que la vulgarité de son titre. Et nous nous réjouissons de découvrir Jean-Louis Trintignant et Gina Lollobrigida dans La mort a pondu un œuf (Giulio Questi, 1968), assurément tiré de derrière les mêmes délectables fagots que L’Île des péchés oubliés et Les Mille et Une Filles de Bagdad que l’hommage à Ulmer nous offrira en juillet…
- L’auteur de Tintin en Syrie se plaint (Les Inrockruptibles, 6 juin 2012) d’être attaqué par le Syndicat de la Critique (combien de divisions ?) qui détruit ses films avant même de les voir. L’accusation est cocasse, eu égard au tsunami audiovisuel à la gloire du Maître qui nous submerge depuis quelques laps. Rassurons-le : à titre individuel, nous avons vu tous ses films (et même parfois lu les livres qu’il a signés), ce qui explique notre bonne santé, le rire étant une excellente thérapie – vive Botul !
- Regrettons cependant que, du même Germi, n’ait pas été retenu également Meurtre à l’italienne, belle adaptation de L’Affreux Pastis de la rue des Merles de C. E. Gadda.

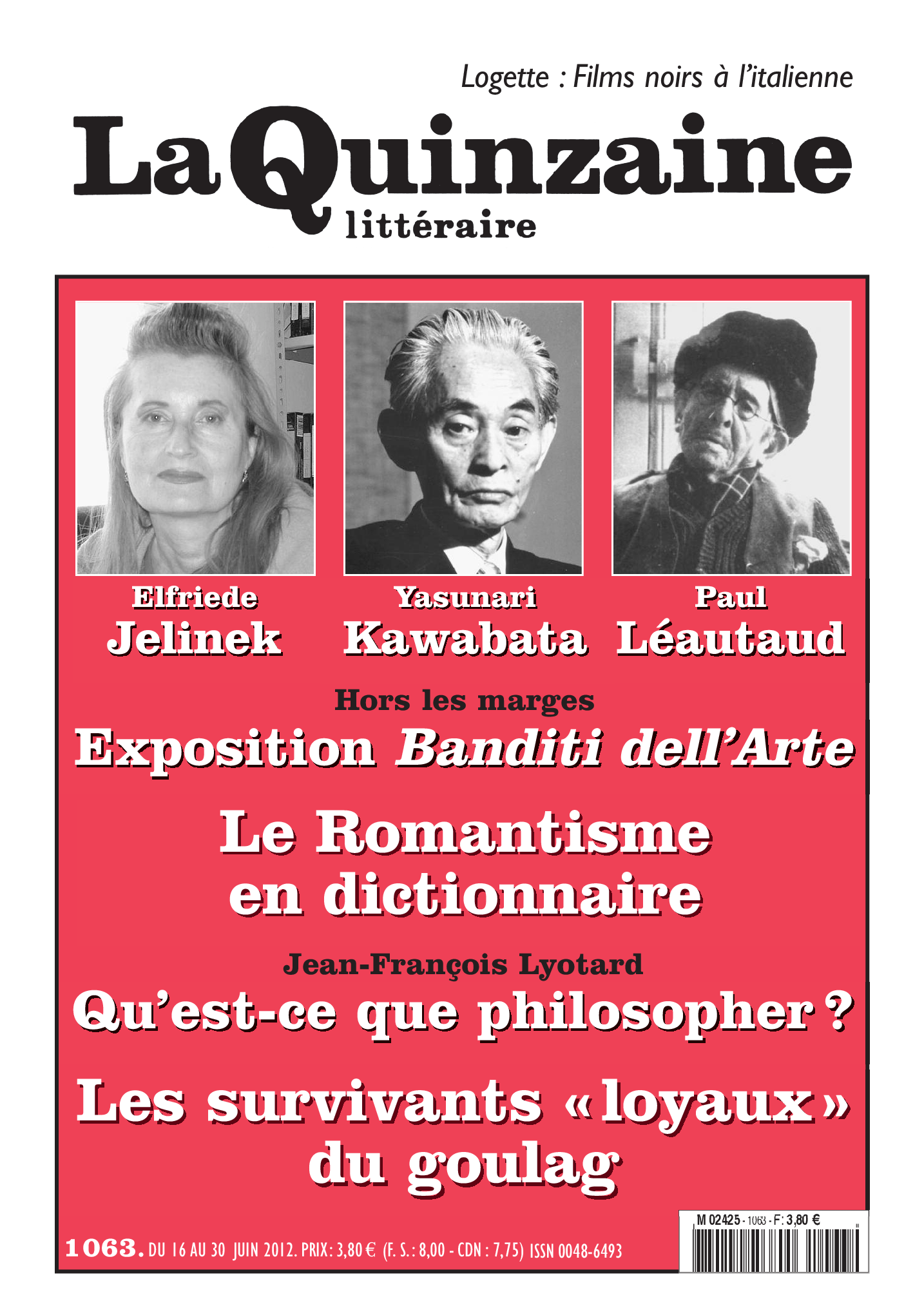

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)