Le responsable de l’exposition, Jean-Hubert Martin, sous le titre Ephemeralia, Actions et Performances en dresse l’inventaire. Il commence en 1935 : Bal onirique. À New York. Six ans plus tôt, André Breton présentait la première exposition de Dalí à Paris : « C’est, peut-être, avec Dalí la première fois que s’ouvrent toutes grandes les fenêtres mentales. » De ces fenêtres la vue ne cessera de surprendre. Dalí l’avait prévu et voulu. Au Bal onirique il porte un soutien-gorge, Gala, vêtue d’une robe en cellophane rouge, et coiffée d’un landau avec un bébé en celluloïd, le ventre est couvert de fourmis, la tête enserrée par les pinces d’un homard. On pourra suivre à la trace dans les œuvres les pas de ce premier bal. En 1955 Dalí prononce une conférence sur les « Aspects phénoménologiques de la méthode paranoïa-critique ». Il s’était fait conduire à la Sorbonne dans la Rolls, bourrée de choux-fleurs, de son ami Mathieu, le seul peintre proche de lui pour sa pratique théâtrale de l’art.
Le mot convient-il encore ? En 1933 dans le premier numéro de la novissime revue Le Minotaure, attachée à la reconnaissance de « nouveaux territoires », on pouvait lire de Dalí « Interprétation paranoïa-critique de l’image obsédante de l’Angélus de Millet », du Dr Lacan « Le problème du style et les formes paranoïaques de l’expérience ». En tête de la livraison, un ensemble de photos, par Brassaï, des œuvres les plus cassantes de Picasso présentées par André Breton.
Jean-Hubert Martin revient sur la « rivalité » Dalí-Picasso. Un match de boxe en trois rounds. Au premier round Dalí serait « gagnant auprès du public » comme « créateur d’images de rêve sur une structure traditionnelle ». Deuxième round : « Picasso, qui a toujours été gagnant sur le marché, l’emporte auprès du public grâce à la diffusion du mythe de l’artiste moderne qu’il a mis en place et à l’adulation de la critique ! » Troisième round : « Et si le dogme de la modernité n’apparaissait que comme une parenthèse laissant place à l’image et à l’allégorie de l’installation ? Dalí suscite aujourd’hui plus d’émulation et de stimulation auprès des jeunes artistes que Picasso. Les paris sont ouverts. »
Qui sera l’arbitre dans cette affaire où l’art tient moins de place que l’appréciation en dollars ? Avida Dollar, le surnom que Breton donna à Salvador Dalí, s’appliquerait aussi bien à la médiatisation de l’art et à son évaluation.
Miró, que j’interrogeais sur ses rapports avec Picasso, me répondit : « Nous habitions le même quartier. Le même quartier intellectuel, c’est beau, ça ! » (Ceci est la couleur de mes rêves, Seuil, 1977). Dalí a constamment fait état de son admiration pour Miró, bon dessinateur de poils, précisait-il… Miró, lui, avait été séduit par ce jeune homme : « son intelligence m’avait tout de suite frappé. Brillant, étincelant ». Mais en 1975 il me disait que Dalí, « très intelligent, n’avait pas un caractère à la hauteur de son intelligence. Il n’a pas de force humaine. Sa peinture m’intéressait jusqu’à un certain moment. Et puis, il y a eu la chute verticale, par manque de dignité humaine » (Ceci…).
L’exposition – organisée par Beaubourg et le Museo Reina Sofia (où se trouve Guernica) – est introduite au catalogue par un essayiste espagnol connu en particulier pour ses analyses de Miró et de Tàpies. Pere Gimferrer revient sur les réserves concernant Dalí : « Je ne peux pas ne pas comprendre les rejets de Saura, de Tàpies, de celui, très différent, de Miró. » Mais ce rejet de l’homme passe, dans la continuité, du comportement à l’œuvre. Dalí flatte le goût du public pour la peinture traditionnelle. Gimferrer revisite l’œuvre. Il met en valeur la composante kitsch : « L’obsession du kitsch et le désir d’être pompier occupe une grande place dans son œuvre. » En 1991, présentant à Paris les œuvres récentes de Tàpies, il écrivait : « L’art de Tàpies a gagné depuis longtemps cette région où il n’est plus tributaire que de lui-même : tout comme Miró naguère, il ne répond que devant son propre répertoire de signes, dans un dialogue autonome du langage qu’il a fondé avec son code de références » (Repères-Cahiers d’art contemporain n° 80).
Le répertoire de signes de Miró, de ceux de Tàpies est connu. Une écriture qui s’adresse à nous, où nous pouvons nous reconnaître. Pas de signes chez Dalí. Des figures à déchiffrer. On le fait le plus souvent à partir de ce que Dalí a écrit sur lui-même : Comment on devient Dalí, le titre d’un livre dont il est l’auteur et le personnage en 1973. Et toute une librairie dalinienne. L’inspection des obsessions y règne.
L’exposition est bâtie, comme en rêvait Dalí, sur une très longue salle, seulement marquée en son milieu par des kiosques où se trouve souvent le meilleur de Dalí : des petits formats, des dessins plus attirants que les peintures où s’offrent les composantes éparses d’une scène qui n’a pas lieu. Le spectateur, quoi qu’on en dise, est exclu en dépit des rappels de Dalí. Ainsi Le Grand Masturbateur (1929) peut devenir « l’icône » de l’art de Dalí. De la même année Jeu lugubre (absent de l’exposition) : dans les deux peintures, à la place du sexe féminin une sauterelle dont des fourmis font leur proie. Phobies anciennes de Dalí, roman familial, Gala, comment lire cette sauterelle ? Un dessin préparatoire montre un couple allongé, les jambes écartées, des sexes exposés. C’est le sexe féminin qui a disparu dans la peinture de Jeu lugubre à moins qu’on ne pense qu’il fait retour par un triste jeu de mots « sauter/elle ». Elle, Gala, la mère, la sœur… ? La sauterelle de l’empêchement, du déplacement. Dans Dalí les fesses abondent. Quant au sexe féminin, on le repère, minuscule, dans Deux figures sur une plage. Les désirs inassouvis (1928). Une amande rouge et noire qui fut un signe dans le vocabulaire de Miró, une des pièces majeures de sa syntaxe. Cette amande, Dalí l’a recopiée et lui a tourné le dos ou a rusé avec elle par une occultation transparente : les Roses ensanglantées sont l’exemple, en peinture et en mots, des manœuvres de Dalí autour du sexe de la femme.
Dalí peut aussi se lire moins dans l’historique de l’art que dans ses rapports avec des écrivains qui furent, pour lui, un temps nourriciers et vers lesquels, plus ou moins obliquement, il nous conduit.
Appartenant au fonds de Beaubourg une encre sur toile collée sur carton : au trait la silhouette du Christ, le Sauveur (Salvador) délimite une surface où s’étale, signée Salvador Dalí, l’inscription : « Parfois je crache par plaisir sur le portrait de ma mère » (1929). Le blasphème me conduit ici à la scène du début de la Recherche du temps perdu où le narrateur de Proust est le spectateur d’une scène où la fille de Vinteuil, enlacée avec son amie, se livre à des « profanations rituelles », sur le portrait du musicien décédé. Elle recule devant la suggestion de cracher sur cette « vieille horreur ». Son amie réplique : « Je n’oserais pas cracher dessus ? Sur ça ? » Le plaisir doit en être accru. La description de cet orgasme reste cachée derrière des rideaux opportunément tirés.
Raymond Roussel était aussi une lecture de Dalí. Ce jeu sur la représentation du sexe féminin apparaît dans un étrange passage de Locus Solus « où un chat rose, chat véritable entièrement épilé, est présenté sous le nom de Khong-dek-lèn. Deux écritures, deux figures du Con d’Hélène. J’imagine Dalí admiratif de ce jeu sur une figuration refusée ou impossible. Le néologisme barbare, hérissé de signes typographiques, de Roussel dame le pion aux figures de Dalí. Dalí a peint Impressions d’Afrique (1938). Il emprunte le titre de Raymond Roussel, il le citait. Et lui-même, comme Vélasquez pour les Ménines, peint un tableau dont nous ne voyons pas le sujet. Le peintre est Dalí, Dalí est Vélasquez, Dalí est Roussel, un habit d’Arlequin » (La Quinzaine n° 317). Mais Roussel lui-même s’était ostensiblement masqué et démasqué, déguisé et révélé dans le long poème intitulé « L’âme de Victor Hugo », qui est celle de Raymond Roussel. On lit :
« À cette explosion voisine
De mon génie universel
Je vois le monde qui s’incline
Devant ce nom : Victor Hugo. »
Salvador Dalí ne rime pas plus que Hugo avec cet universel. À moins qu’il ne faille à l’un et l’autre trouver comme lien, un nom commun : Ego.
à noter : Un autre point de vue sur Salvador Dali.
Georges Raillard
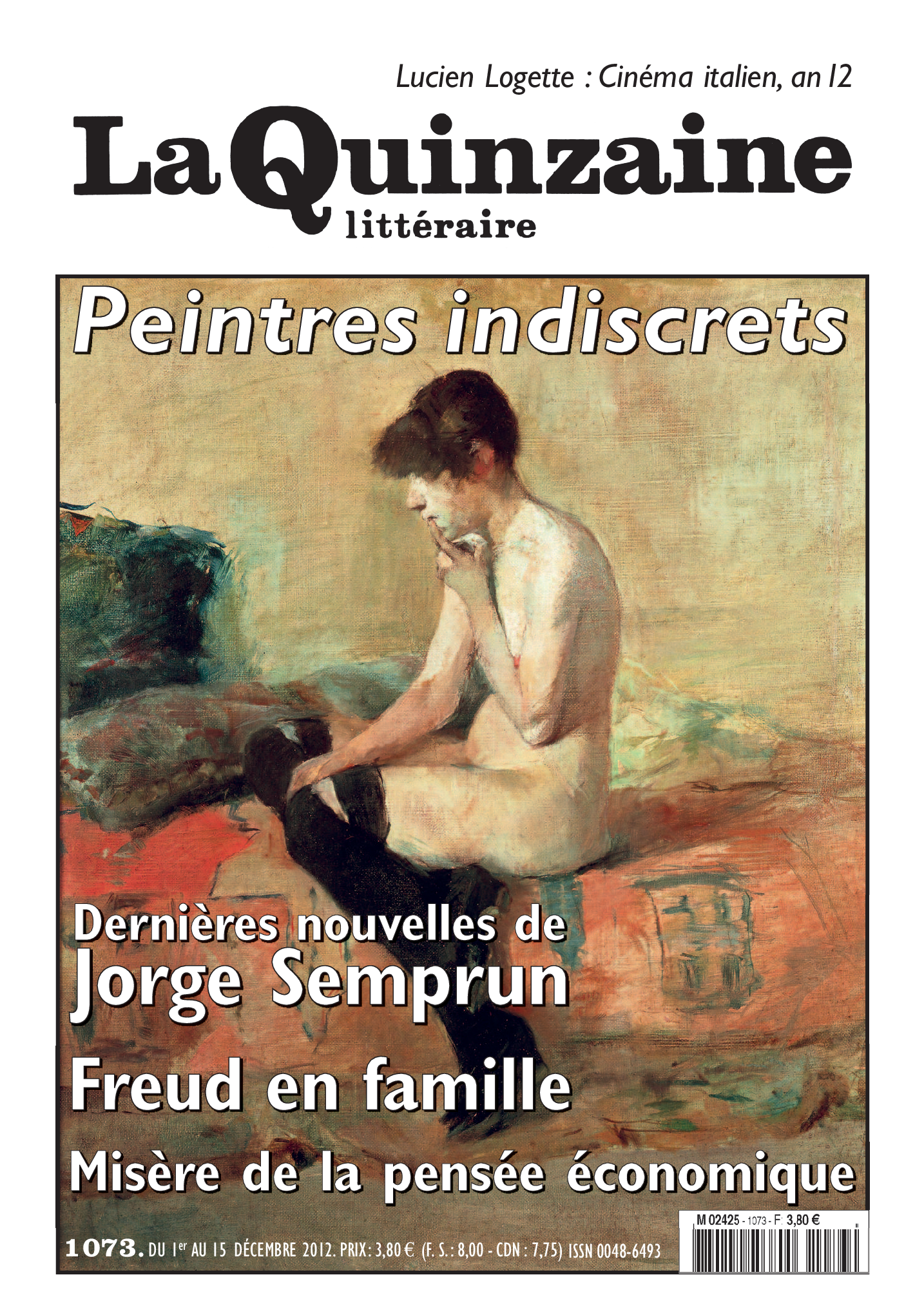

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)