Il avait six ans à peu près quand sa mère lui a rapporté des courses un disque de ce concerto, dans l’interprétation de Jascha Heifetz. Ce fut « le choc absolu », « un sentiment incroyable, comme si le corps s’arrête ». Depuis lors, Amoyal nous dit avoir été « littéralement possédé par le violon ». Plus prosaïquement, cela tombait d’ailleurs très bien car le logement était trop petit pour accueillir le piano auquel on avait d’abord pensé.
Si le terme de « vocation » est galvaudé lorsqu’on parle de musiciens, il semble approprié dans le cas de Pierre Amoyal. Au bout de trois leçons, il demande à son premier professeur ce que peut bien signifier une croix placée devant une note (c’est un « double dièse ») : une question qu’aucun débutant n’a jamais posée. C’est qu’il avait obtenu, de haute lutte, que sa mère lui achète la partition du Concerto de Tchaïkovski ! Une autre fois, il se met à jouer debout sur la table, pour se préparer à la position du soliste.
Il entre à neuf ans au Conservatoire de Paris, dans la classe de Roland Charmy – célèbre, notamment, pour avoir été le mari de la harpiste Lily Laskine. Il a douze ans quand il empoche son premier prix. Charmy propose de continuer à le faire travailler sans se faire payer (autres temps…). Songeant à son enfance, Pierre Amoyal aujourd’hui « peine encore à comprendre comment [il a] pu en une année et demie passer du stade des cordes à vide au final de la Symphonie espagnole de Lalo ». Il s’apprête, à dix-sept ans, à suivre l’enseignement de David Oïstrakh au Conservatoire de Moscou, mais c’est le moment où Heifetz…
Heifetz s’était déjà manifesté dans la préhistoire d’Amoyal, qui se présente comme Russe par sa mère et juif par son père. Son grand-père maternel était né à Odessa, comme quelques-uns des plus grands violonistes du XXe siècle (Oïstrakh, justement, ou encore Nathan Milstein), et n’avait jamais oublié le jour où il y avait entendu Heifetz : l’auditeur avait huit ans et l’exécutant douze ! Ce grand-père, arrivé de Russie en France en 1917 après avoir fait le chemin à pied, était devenu « le plus fameux traiteur russe de Paris ». Amoyal a donc dix-sept ans. Il reçoit un coup de téléphone de son aîné Ivry Gitlis, qui lui propose mystérieusement d’auditionner le lendemain « pour quelqu’un qui ne joue pas trop mal ». Sans autre avertissement, Amoyal se retrouve en présence de Heifetz, qui, pendant deux heures, lui fait subir une terrifiante épreuve, en lui demandant systématiquement de lui jouer ce qu’il n’a pas étudié. Quelques semaines plus tard, un télégramme lui fait savoir que Heifetz l’attend à Los Angeles.
Heifetz, c’est ce jeune garçon dont Fritz Kreisler avait dit : « Messieurs, nous n’avons plus qu’à prendre nos violons et à les briser sur nos genoux. » Il avait été, à Saint-Pétersbourg, l’élève du légendaire Leopold Auer, lequel avait été celui de Joseph Joachim, le créateur du Concerto pour violon de Brahms. Selon Amoyal, Auer avait transmis à Heifetz « une attitude de respect absolu face aux chefs-d’œuvre dont l’interprète n’est que le passeur éphémère ». Et avec Heifetz il valait mieux ne pas oublier cette exigence : « vous faisiez un rubato là où il n’est pas écrit ou pensé et vous étiez jeté dehors ». La filiation prestigieuse dont Heifetz pouvait se prévaloir lui permettait même de connaître les endroits où une partition ne doit plus être observée : dans le premier mouvement du Concerto pour violon de Tchaïkovski, plusieurs indications de ralentissement du tempo ont été arrachées au compositeur par Auer, qui – dans un premier temps seulement – avait jugé certains passages injouables sans ces aménagements.
Voici donc Pierre Amoyal à Beverly Hills, où, sous la férule de son idole, il va travailler son violon dix heures par jour pendant cinq ans. Heifetz conduit la Bentley qu’il a rachetée à Gary Cooper. Il est toujours tiré à quatre épingles. Il parle mieux le français qu’un Français (« je n’y entrave que pouic », pouvait-il dire). Le premier enregistrement auquel participera Amoyal se fera en quelque sorte par surprise, avec le concours, entre autres, de Gregor Piatigorsky, ce violoncelliste qui, quarante-cinq ans plus tôt, avait été repéré par Furtwängler alors qu’il se produisait en trio dans un café russe de Berlin.
Ce qui importait pour Heifetz, c’était l’expression, le phrasé, la sincérité avant tout : le caractère personnel de l’interprétation, à condition que le texte fût respecté. Il ne parlait jamais de la justesse, dont Pierre Amoyal s’étonne – et déplore – qu’elle soit devenue une priorité absolue. Cela m’a fait penser à un livre rouvert par hasard il y a peu : « Aujourd’hui […] on accorde une grande importance à l’intonation juste. J’ai pour ma part appris à ne lui en accorder aucune. Car rien ne se forme de soi-même d’une manière plus aisée et plus sûre que l’oreille, pourvu que l’on sache par ailleurs affiner la sensibilité de l’élève » (1).
Leur amitié s’est terminée sur une note triste et belle à la fois. Heifetz avait fait promettre deux choses à son élève : ne jamais aller manger chez Maxim’s à Paris et ne jamais jouer sous la direction de Karajan. Amoyal n’a pas réussi à tenir la seconde promesse, espérant d’ailleurs que Heifetz ne se souviendrait plus de ce serment. Dès lors, Heifetz ne l’a plus pris au téléphone, montrant qu’en plus d’être un grand artiste il accordait du prix à la parole des autres (2).
- Walter Howard, Musique et culture : Contribution à la psychologie et à la philosophie musicales, Puf, 1963, p. 147 (c’est l’auteur qui souligne).
- Heifetz est mort en 1987, l’année même où Amoyal a vécu une mésaventure dramatique : on lui a volé son stradivarius, qu’il a retrouvé quatre ans plus tard. Il raconte cet épisode dans Pour l’amour d’un stradivarius, Robert Laffont, 2004.

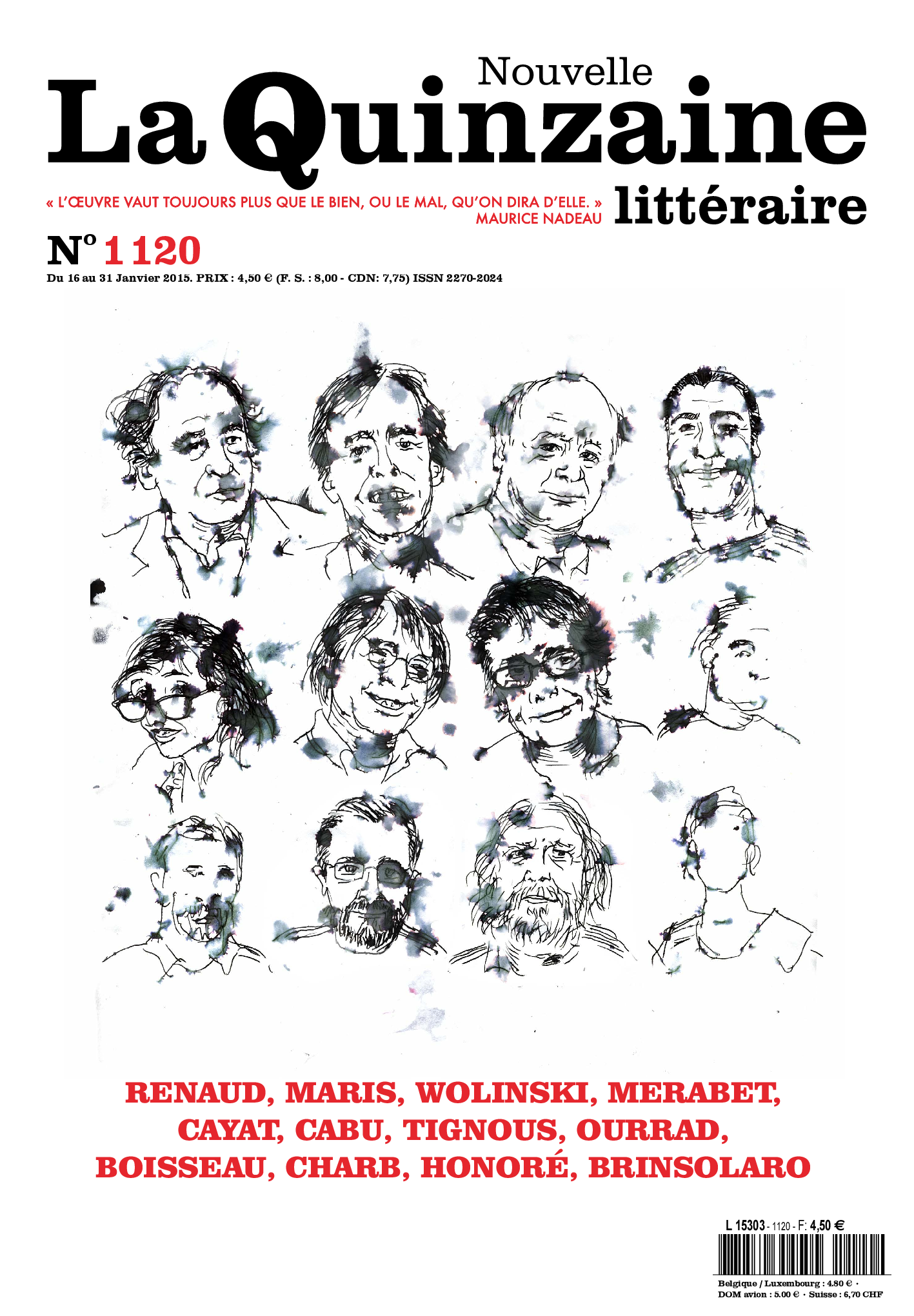

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)