Neuropsychologie, neurobiologie, neuroéconomie, neuroéthique, neuroesthétique, neurophilosophie, neurosciences « sociales », les neurosciences sont partout. Cette ubiquité engendre des enthousiasmes, mais aussi suscite pas mal de scepticismes.
Neuromanie et neurophobie
Les neuromanes voudraient tout expliquer de ce qui relève de l’esprit humain par les neurones – et en ce sens le modèle de l’esprit comme assemblée neuronale a remplacé celui de l’esprit comme ordinateur, qui fit florès il y a quelques décennies –, et les neurophobes, qui se rétractent à la vue d’une équation comme l’âme selon Musil, dénoncent la maladie des premiers. Mais comme avec Tweedledum et Tweedledee, on doit les renvoyer dos à dos.
Denis Forest, qui est historien de la psychiatrie et philosophe de l’esprit, distingue trois types de « neuroscepticisme » (1). Le premier naît de l’examen des prétentions des neurosciences cognitives à expliquer l’intégralité de l’activité mentale et les contenus mentaux par les techniques d’imagerie fonctionnelle. Forest montre combien sont indéterminées les données, si riches et nombreuses qu’elles soient, qui prétendent établir par IRM une identité entre des activités neuronales observées dans une certaine région cérébrale et des activités mentales. Il nous enjoint à la prudence en rappelant qu’il existe des contraintes méthodologiques fortes, notamment quant au couplage neurovasculaire et aux cartographies de fonctions cérébrales : ne pas confondre corrélation et causalité, avoir des moyens de distinguer la spécificité des phénomènes étudiés et leur congruence avec d’autres facteurs. Denis Forest ne prétend nullement que les méthodes d’imagerie ne sont pas pertinentes pour établir la dépendance de l’esprit vis-à-vis du cerveau, mais il estime qu’elles prennent des formes bien plus complexes que des corrélations, et qu’il faut définir d’abord ce que l’on cherche. Quand un grand neurobiologiste comme Jean-Pierre Changeux, par exemple, annonce qu’il va faire une « physiologie de la vérité » (2), on peut froncer le sourcil.
Une deuxième sorte de scepticisme vient des philosophes inspirés par Wittgenstein, comme Vincent Descombes, qui dénoncent l’erreur de catégorie consistant à identifier notre vie mentale avec notre activité cérébrale : c’est nous qui pensons, calculons ou lisons, pas notre cerveau ou nos neurones. Pour ces neurophobes, toute explication causale d’une activité mentale, a fortiori neuronale, est par nature illusoire. Denis Forest nous rappelle que ce sont ceux qui dénoncent les confusions qui sont confus. Ils infèrent de ce que le cerveau n’est pas condition suffisante de l’activité mentale qu’il n’en est pas une condition nécessaire. Quand ils attaquent l’identité de l’esprit et du cerveau, ils confondent le « est » de l’identité avec celui de la composition : une statue n’est pas le bronze dont elle est faite, mais elle en est composée. Quand ils dénoncent le discours métaphorique qu’on emploie en disant que les assemblées de neurones « voient » ou « infèrent » quelque chose, ils oublient que les neurones sont néanmoins le véhicule de ces fonctions : il y a bien des neurones spécifiques impliqués dans la vision ou d’autres capacités. Quand on rétablit la différence entre l’analyse fonctionnelle de ce que c’est que penser, calculer ou percevoir, et l’analyse causale des processus qui sont responsables de ces activités mentales, la confusion disparaît, et certaines analogies se révèlent parfaitement légitimes.
Une forme plus subtile de neuroscepticisme vient de ceux qui s’enthousiasment pour l’idée de plasticité du cerveau et nous disent, à la manière du poète : « Quand j’aurai du vent dans mon crâne, il me manquera mon élément plastique, plastique tique ». La plasticité du cerveau montrerait qu’il est plus déterminé que déterminant pour nos aptitudes, et donc en fait dépendant de notre liberté bien plus qu’il ne la contraint. On aime à citer l’exemple du cerveau des chauffeurs de taxi londoniens, qui se modifie du fait de leur compétence particulière. Il ne s’agit pas de nier l’épigénèse, mais celle-ci est souvent exploitée dans le sens d’une sorte de néo-lamarckisme revisité par des idées douteuses sur l’auto-organisation du cerveau, qui n’est en fait plastique que dans la mesure où il est conditionné par son anatomie et sa physiologie (3).
Une troisième grande source de neuroscepticisme vient de ceux qui soutiennent que l’esprit n’est pas à l’intérieur du cerveau, mais « au dehors », dans une extériorité qui tient non pas seulement à l’environnement physique, mais au corps et à son insertion dans le monde. On parle alors d’énaction, de cognition incarnée ou « étendue » : mon esprit n’est pas dans mon crâne, mais répandu dans le monde et les artéfacts techniques qui m’entourent (comme mon i-phone). De là, on peut passer à une forme de pragmatisme et de contextualisme radicaux, puis à l’idée qu’il peut y avoir des « neurosciences sociales », expliquant nos capacités à avoir des interactions sociales par des configurations neuronales spécifiques (comme les « neurones miroirs », supposés être à l’origine de nos comportements d’imitation d’autrui) ou des modules tels que la « théorie de l’esprit » des enfants. Forest montre combien ces transitions du neurologique au social sont aventurées et avec quelle précaution il faut les manier (4). Il nous convie à une approche plus équilibrée et plus prudente, qui remette les neurosciences à leur place, qui est centrale, mais qui ne les transforme pas en panacée. Son essai est un modèle de prudence épistémologique et de tempérance théorique. On regrettera seulement qu’il faille aller chercher la bibliographie et les index du livre sur le site internet de l’éditeur : c’est abuser de la cognition étendue.
- Dans Neuromania, Il mulino, 2009 (trad. anglaise, 2011), Legrenzi et Umilta dénonçaient la neuromanie.
- C’est le titre de la traduction anglaise de son Homme de vérité, Odile Jacob, 2002.
- Denis Forest cite ici Catherine Malabou, Que faire de notre cerveau ?, Bayard, 2011.
- Pour une analyse récente, voir Christian Schmidt et Pierre Livet, Comprendre les interactions sociales : Une perspective neuroéconomique, Odile Jacob, 2014.

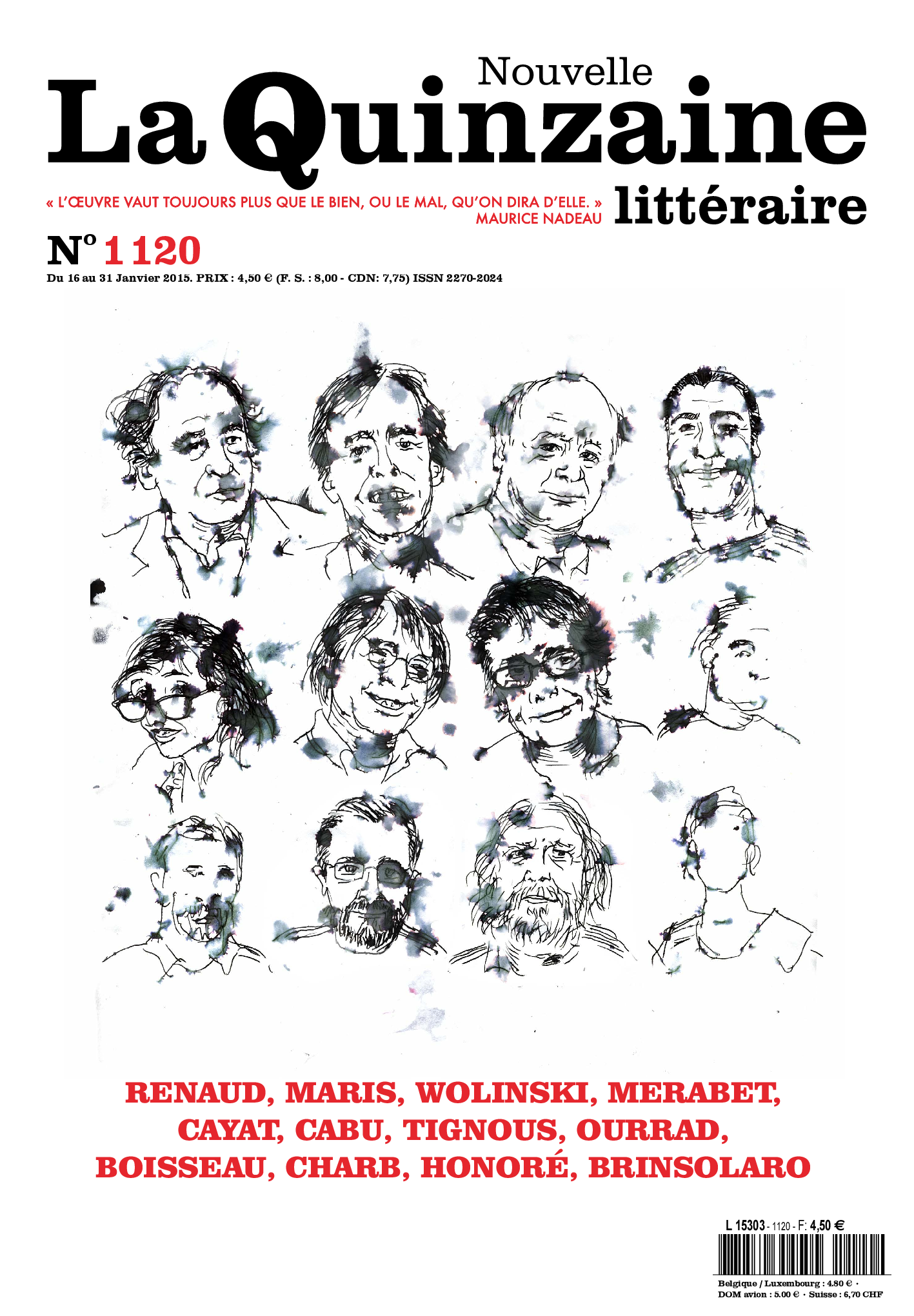

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)