Son problème n’est qu’en apparence le même que celui de Weber. Il distingue trois sortes de sécularisation : la séparation de l’Église et de l’État et la laïcisation de l’espace politique ; le déclin de la croyance religieuse ; la construction d’un « cadre immanent ». C’est dans le troisième moment que Taylor loge le désenchantement proprement dit. Celui-ci est rendu possible par l’opposition de l’homme et de la nature, conçue à partir de l’avènement de la science moderne comme dépourvue de sens et de dessein intrinsèque.
Taylor entend dissocier sa conception de la sécularisation de ce qu’il appelle les « histoires de soustraction », où l’on suppose que le monde divin s’est retiré de la nature et a laissé un vide, celui du monde désenchanté, perçu soit comme orphelin, soit comme libéré de son joug religieux. Au contraire, selon lui, le « grand désengagement » non seulement est bien antérieur à la Réforme, mais est plutôt une sorte de changement de paradigme qui produit une nouvelle conception de l’homme et de sa relation à l’univers. C’est celle de l’individu isolé moderne, libre et responsable, maître de son moi et de la nature, dont Taylor a fait l’histoire et la critique dans Les Sources du moi et dans toute son œuvre.
Ce récit de la sécularisation a deux conséquences. La première est que ce n’est pas l’avènement de la science moderne et du capitalisme qui conduit à ces déplacements tectoniques de la croyance, mais bien un changement de vision du monde de nature bien plus éthique qu’épistémologique et ontologique. La seconde est qu’avec le passage au cadre immanent Dieu ne se retire pas du monde : il y reste présent sous la forme d’une « ouverture » et d’une aspiration au spirituel qui n’a pas quitté le monde moderne, où Dieu reste, selon G. M. Hopkins, la « forme intérieure » du monde. On est ici aux antipodes de Weber, qui parlait d’une « nuit polaire d’obscurité glacée » et nous invitait à contempler le vide sans crainte ni tremblement.
Le long récit de Taylor, même si l’orchestration est différente, sera familier aux lecteurs des autres récits philosophiques de la sécularisation, de Heidegger à Rémi Brague, de Schmitt à Blumenberg, de Foucault à Gauchet. Je ne sais pas si son livre, même si l’érudition historique en est impressionnante, sera bien utile aux historiens et aux sociologues de la sécularisation. De plus, il ne dit mot sur l’islam, ce qui, si l’on veut penser la modernité contemporaine, limite sérieusement la perspective. Le problème principal, pour ceux qui comme moi ne sont pas très impressionnés par les approches herméneutiques de la religion, est de comprendre comment il peut soutenir sa thèse principale, selon laquelle on ne peut pas aborder le problème de la croyance religieuse d’un point de vue épistémologique, à la manière de la philosophie des Lumières, c’est-à-dire en se demandant quelles raisons – preuves et données suffisantes – on peut avoir de croire.
Il voit dans ce point de vue le produit même de la conception individualiste qu’il rejette. De William James à Luc Ferry, de Gianni Vattimo à Ratzinger, on nous demande de sortir de cette conception étroite et rationaliste de la croyance, et de mettre l’éthique à la racine de l’épistémologie, en concevant la foi, à la manière pragmatiste, comme un engagement actif et volontaire.
Mais, d’une part, il est loin d’être évident que l’éthique gouverne l’épistémologie, que nos raisons de croire ou de ne pas croire soient (et doivent être) gouvernées par nos choix éthiques, et par les choix éthiques et les valeurs de l’époque dans laquelle nous vivons. Ces valeurs, comme le montre Taylor, changent, et il est vrai qu’elles affectent nos attitudes vis-à-vis de la foi religieuse. Mais pourquoi devraient-elles affecter en dernier ressort nos jugements sur ce qui est ? Est-ce que nos valeurs cognitives, telles que la vérité, la preuve et l’objectivité, sont des « constructions » induites par la lente émergence du point de vue « désengagé » ?
D’autre part, il est loin d’être évident que nos croyances puissent et doivent être gouvernées par notre volonté. Qu’on ait envie de faire le saut de la foi est une chose, qu’on puisse y parvenir en est une autre. Tant qu’on ne nous l’aura pas montré, on sera comme Russell qui, parvenu au Paradis, et à qui Dieu demande pourquoi il n’a jamais cru en Lui, répond : « Pas assez de preuves, Dieu, pas assez de preuves (1). »
1. Le travail du traducteur, qui réussit à rendre lisible la prose verbeuse de Taylor, est admirable. Mais pourquoi donc traduit-il agency par « agence » ?
Pascal Engel
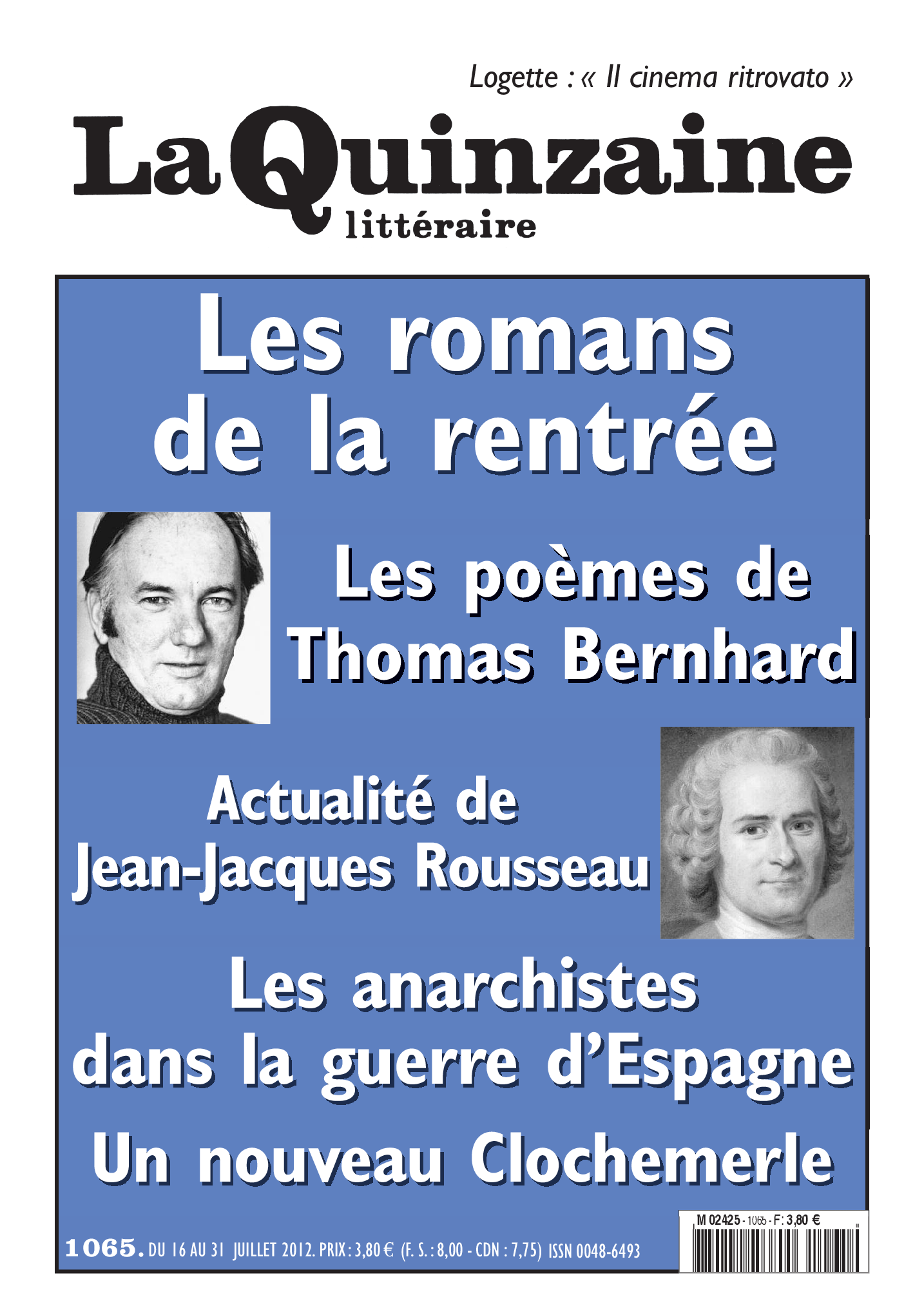

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)