La baignoire verte d’Union Square
En 1978, un jeune Italien, photographe d’architecture, séjourne à New York. Il y loue à bon marché un local en mauvais état, un grand volume encombré d’objets disparates dont il va tirer parti. Il donne un soin particulier à une baignoire à quatre pieds. Il la peint en vert. Face au lit, monté sur des palettes et des poubelles, à côté d’une table-bureau, d’un fauteuil américain, d’un téléviseur, d’un bac-toilettes, la baignoire est devenue la pièce cardinale de l’appartement.
Aujourd’hui le locataire d’Union Square, Matteo Piazza, considère que son séjour au « loft » a été formateur pour lui. Il a aménagé à Milan un loft sans portes. « J’aime les espaces ouverts, dit-il, ce loft d’Union Square est toujours l’idée que je me fais d’une maison. »
(S’il y a transporté cette baignoire verte générative, mes sources (Lofts, Seuil, 1999) me le laissent ignorer.)
Privacy et community
L’architecte Hector Horeau (1801-1872) est célèbre pour l’inventivité de ses projets d’architecture publique. Ainsi, en vue des grandes expositions permanentes, l’édification de deux immenses pavillons à l’entrée des Champs-Élysées.
En 1864, il accepta la commande d’un pavillon au Vésinet. À une condition particulière. Le pavillon était destiné à deux amis. Ils devaient pouvoir, selon leur humeur, vivre ensemble ou séparés. Leurs chambres étaient donc desservies, chacune, par un escalier avant et un escalier arrière.
Cependant le plan montre ce que cette gémellité avait de fallacieux : le « privacy » était réduit aux chambres, la « community » se déployait avec ostentation.
La chambre de Mar/cel
En 1912 Marcel Duchamp dessine le Passage de la Vierge à la Mariée. Dans un espace ouvert. Les organes stylisés de la Mariée (« cylindre sexe », « guêpe ») ont été rendus célèbres par Le Grand Verre. Mais le lieu de cette « mise à nu » et de ce qui s’en suit n’y est pas représenté. À la chambre classique s’est substituée la machine duchampienne, « célibataire ».
On sait que le titre exact et complet du Grand Verre est La Mariée mise à nu par ses célibataires, même. La transparence du Verre a pour effet que derrière sa paroi translucide c’est tout ce qui passe qui entre dans la « chambre ». Devant, les figures depuis longtemps nommées. En haut du Verre, l’espace de la Mariée : la chenille, l’inscription restée blanche, etc. En bas, l’espace des CELibataires (prêtre, livreur de grand magasin, croquemort, chef de gare, etc.).
Séparant les deux espaces, une ligne d’horizon, celle des vêtements de la mariée (non figurés). La chambre absente, ou multiple, mobile est en même temps désignée anagrammatiquement par le résultat de la perversion du nom de l’architecte MAR-CEL Duchamp.
Tout, et son contraire, a été écrit sur Le Grand Verre. Et aussi, après 1944-1950, sur Étant donnés qui lui fait suite, a contrario : une femme nue, au sexe glabre, est bien visible à l’intérieur d’une boîte, une chambre à l’extérieur de laquelle le voyeur est invité à prendre place.
Jean-François Lyotard, au début de son essai sur Les Transformateurs DUchamp, exprime cette « plainte » (bientôt suivie d’un « amendement ») : « Je proteste qu’il n’y a pas à être plus sentencieux que ne l’est M. Marcel. Il a atteint le comble du sentencieux, chacune de ses phrases énigmatiques fait sentence, chacun de ses produits bizarres mouche. Telle est sa dureté. (…) Il nous a eus avec une phrase dure et sentencieuse. Il nous a asphyxiés. On ne peut plus rien dire. Mais voir ? Voir pas davantage. Le Verre, rien à voir, transparent. Étant donnés, rien qu’une vulve à voir, et pour cette raison rien qu’un con pour voir. »
La fenêtre de Rolla (1878)
Rolla est le jeune homme désespéré du poème d’Alfred de Musset. Il se jettera par la fenêtre. En 1878 Henri Gervex avait proposé au Salon une grande huile sur toile dont le sujet était une prostituée. Il y avait des précédents : Olympia de Manet, ami de Gervex, est de 1864. Mais les temps ont changé. Manet voulait, dit-on, faire reconnaître la sexualité de la femme. Michel Leiris la dévêt en trois mouvements : « fille de son temps », « fille vénale à n’en pas douter » et « plus réelle de ce fait », « bibelot sans âme autre que son charme ».
Cependant Michel Leiris nous a conduits de la chambre (suggérée) de la prostituée à une autre chambre. Celle où dans L’Homme au sable, Nathanael, le héros du conte d’Hoffmann, découvre par la fente de la boiserie d’une chambre à la porte close, le « visage merveilleux », « la beauté céleste » d’une jeune fille. Lèvres glacées, mains glacées, la jeune fille, nommée Olympia, découvre peu à peu à Nathanael sa réalité : un automate, une poupée, « aussi froide que l’indique son nom ». Du réalisme de la chambre notre regard est passé au « pouvoir d’illusion de l’art ». Deux chambres en superposition (même si les chercheurs de la vérité des sources sont moins sensibles que Leiris à la multiplicité d’Olympia) : le corps réel de Manet et la chambre-atelier où a été construite l’Olympia d’Hoffmann.
Gervex peint donc une prostituée. Le titre du tableau n’est pas donné à la femme mais à l’amant, au client, qui, impécunieux, va se suicider. Rolla jette un dernier regard sur la prostituée : un corps que l’on dirait peint par Cabanel. Et tout, dans cette chambre, est composé en dégradés, de blancs, de roses, de bleus clairs.
Le sujet du tableau, sa force disruptive, est passé du corps de la femme, à la chambre, à la ruelle le long du lit, où notre regard vient s’attacher au déchiffrage du tas de vêtements de Marion, un cryptogramme de tissus autour d’un corset liseré de rouge.
Les chambres de Proust
Grâce à une donation récente au musée Carnavalet, due à M. et Mme Seligmann, on pénètre dans le monde de Gervex, qui est aussi celui de M. Proust, même si dans La Recherche le nom du peintre est absent.
La suite des tableaux nous conduit à deux chambres. À gauche, celle d’Anna de Noailles, lit étroit et étonnamment court. À droite, la chambre de Proust. D’une frugalité ascétique. Arrêté devant la paroi absente, notre regard inventorie la chambre de Proust. Le même écart ici qu’entre la maison d’Illiers et celle de Combray. Cependant cette chambre reconstituée nous conduit, une fois de plus, aux vraies chambres proustiennes.
La chambre, à l’incipit de La Recherche, ouvre la série des chambres-ateliers du roman. Rappelons l’identification du narrateur à sa lecture d’avant-dormir : « ce dont parlait l’ouvrage : une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint ». Le rôle joué dans La Recherche par cette rivalité est moins net que celui des églises ou de la musique (La Pléiade suggère que cette Rivalité serait un emprunt « probable » à un livre d’un dénommé Mignet… Cellule incertaine.)
Dans la suite des chambres, les Chambres d’hiver dévoilent un procédé de construction qui sera exposé explicitement deux fois : celui de la nidification. « Quand on est couché on se blottit dans un nid qu’on se tresse avec les choses les plus disparates : un coin d’oreiller, le haut des couvertures, un bout de châle, le bord du lit, et un numéro des Débats roses qu’on finit par cimenter ensemble selon la technique des oiseaux en s’y appuyant indéfiniment. »
Cette chambre, faite de collages, ou, architecturalement, chambre-loft, on en retrouve la forme et la formule au revers de l’épisode de la madeleine qui capte sur elle toute l’attention. L’hétérogénéité de La Recherche, la disparate de ses éléments constitutifs, est décrite au fond de la tasse d’infusion : « les feuilles ayant perdu ou changé leur aspect, avaient l’air des choses les plus disparates, d’une aile transparente de mouche, de l’envers blanc d’une étiquette, d’un pétale de rose, mais qui eussent été empilées, concassées, ou tassées comme dans la confection d’un nid ».
La chambre-loft, ouverte, a pour horizon rassurant la clôture de la chambre-nid.
La chambre de monsieur Delouit
Des deux récits majeurs du XXe siècle, l’un, La Recherche commence par une chambre, matrice du roman tout entier, l’autre, Nadja, s’achève par une chambre, au terme d’un récit ouvert qui, après des séries de points de suspension, de plages à sens suspendu, rencontre in fine la formule érotique célèbre : « La beauté sera CONVULSIVE ou ne sera pas. »
C’est à elle, sans qu’il s’en doute d’abord, que le lecteur a été conduit, dans ce livre « battant comme une porte ». À elle l’histoire de M. Delouit, la « si sombre, si émouvante histoire de M. Delouit » que je reproduis en conclusion :
Un monsieur se présente un jour dans un hôtel et demande à louer une chambre. Ce sera le numéro 350. En descendant quelques minutes plus tard, et tout en remettant la clé au bureau : « Excusez-moi, dit-il, je n’ai aucune mémoire. Si vous permettez, chaque fois que je rentrerai, je vous dirai mon nom : Monsieur Delouit. Et chaque fois vous me répéterez le numéro de ma chambre. – Bien, monsieur. Très peu de temps après, il revient, entr’ouvre la porte du bureau : Monsieur Delouit. – C’est le numéro 350. – Merci. » Une minute plus tard, un homme extraordinairement agité, les vêtements couverts de boue, ensanglanté et n’ayant presque plus figure humaine, s’adresse au bureau : « Monsieur Delouit. – Comment, Monsieur Delouit ? Il ne faut pas nous la faire. Monsieur Delouit vient de monter. – Pardon, c’est moi… Je viens de tomber par la fenêtre. Le numéro de ma chambre, s’il vous plaît ? »
Georges Raillard
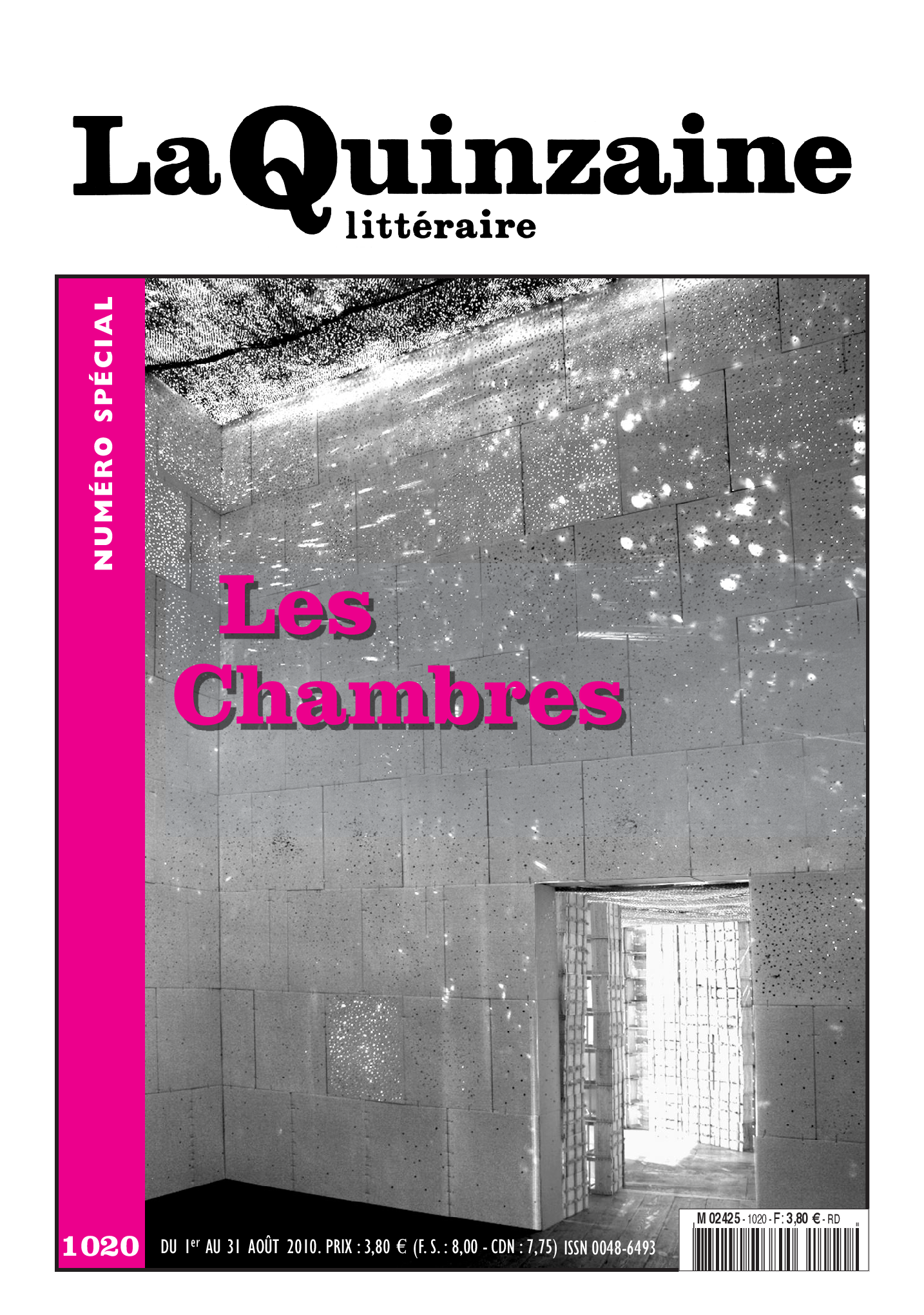

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)