Parmi les lectures d’été que nous avions indiquées (QL 1064), une fois dégustées les éblouissantes chroniques de Pascal Pia et les gaillardises obsessionnelles de Pierre Louÿs, les Écrits critiques de Jean José Marchand ont pris la place de Cingria, selon la règle infrangible qu’il convient toujours de découvrir un continent inédit plutôt que d’arpenter un territoire familier – même si, dans le cas de Charles-Albert, le nouvel ordonnancement des textes peut provoquer des éclairs neufs. L’approche plurielle de J.J.M. effectuée dans la même QL 1064 ne pouvait qu’affûter notre désir de découverte, d’autant qu’une bonne partie des textes recueillis dans le volume I était consacrée au cinéma, art qui n’a jamais intéressé Cingria.
Le principal a été dit sur l’amplitude critique de Marchand, capable d’aborder poésie, cinéma, littérature, peinture, non en touche-à-tout mais en spécialiste. En érudit, même, et précoce, capable à 21 ans de reprocher à l’anthologie poétique de Marcel Arland d’avoir oublié Guillaume Colletet et Petrus Borel ou d’apprécier en amateur la promotion de Nicolas Héroët par Larbaud. Cette connaissance pointue, on la retrouve dans ses chroniques cinématographiques, puisqu’il y évoque, au hasard, des titres aussi rares que Tragédies foraines de Tay Garnett ou Solitude de Paul Fejos, datant de 1928 et peu visibles depuis les débuts du parlant, L’affaire est dans le sac, des frères Prévert, dont l’exploitation avait été écourtée en 1932 ou L’Âge d’or, interdit depuis 1931. Preuve qu’il avait déjà exploré des sentiers peu battus. Lorsqu’il se lance, via Volontés de Ceux de la Résistance, dans la critique de films, il le fait avec la même méthode que lorsqu’il traitait de littérature dans Confluences : précision et clairvoyance – et une clarté de vues qui n’était pas alors la chose la mieux partagée ; ainsi, dénoncer, quelques mois après la Libération, la haine déployée contre Clouzot et Le Corbeau en y voyant le triomphe de l’esprit de Vichy, n’était pas une position dans la norme. Tout au long de ses chroniques, entre décembre 1944 et mai 1947, c’est une parole libre qui s’affirme et un refus du prêt-à-penser appliqué par d’autres périodiques : le cinéma américain n’est pas systématiquement attaqué, le russe pas systématiquement exalté, le français pas systématiquement défendu.
Il faut reconnaître que la période était délicate. Les accords Blum-Byrnes, qui offraient sur un plateau les salles françaises aux films américains, étaient considérés par la profession comme un coup de poignard dans le dos. Après cinq ans de continence, Hollywood vidait ses placards, balançant diamants et rouille dans le plus complet désordre, ce qui ne facilitait pas la compréhension historique. Soutenir le cinéma français devenait un devoir national. Marchand ne s’embarrasse pourtant pas de drapeau. Et, dans la difficile opération de séparer dans la batée le sable et les paillettes, il ne fait guère d’erreurs, ou en tout cas bien moins que certains (1). Les six décennies écoulées permettent une vision plus simple : on sait maintenant ce qui méritait de durer. Le nez sur l’événement, le tri était moins aisé. Il fallait oser écrire que Le Cavalier du désert, de William Wyler, était une plus grande œuvre que Mrs. Miniver, du même – un western, plus estimable qu’un drame couvert d’Oscars ! S’il se trompe sur Laura, dont la postérité est justifiée (à vérifier lors de la rétrospective Preminger en septembre à la Cinémathèque), il perçoit la beauté inhabituelle de Rien qu’un cœur solitaire, du trop oublié Clifford Odets, et défend Deux nigauds dans une île, l’excellent film d’Erle C. Kenton (alors qu’aucun duo comique n’est plus mal considéré qu’Abbott et Costello). Pas aveuglé par le renom de John Ford, il invente à propos de Qu’elle était verte, ma vallée, le concept pratique de « très mauvais grand film », que nous nous promettons de réutiliser – mais il ne s’agit pas d’un coup de patte gratuit : ses deux pages d’analyse explicitent la grandeur en plaqué du film et la mystification sociale qu’il dissimule.
S’il salue d’abord, comme tout le monde, Rome, ville ouverte et Païsa, en novembre 1946, il y revient, quelques mois plus tard, pour regretter qu’« une critique se pâme d’admiration sur les produits faiblards du vérisme, parce qu’ils flattent ses deux péchés mignons : la peinture des humbles et la résistance », en se permettant de rappeler que Roberto Rossellini était « le scénariste de Luciano Serra, film de Vittorio Mussolini ». Même si le fils du Duce n’était que superviseur sur le film de Goffredo Alessandrini, il n’empêche que l’« éminent metteur en scène de la Résistance » n’avait pas refusé de tourner des films au parfum douteux – à défaut de L’uomo dalla croce ou d’Un pilota ritorna, Marchand aurait pu citer Le Navire blanc, sorti à Paris en 1941. Bien peu s’en souvenaient à l’époque, ou préféraient l’oublier pour des raisons circonstancielles – il était plus simple d’interdire Clouzot ou Albert Valentin (2). « Nous vivons dans l’oubli de nos métamorphoses », comme disait le poète…
Sur le plan du cinéma national, Marchand manifeste une circonspection digne d’éloge, même si, par contre-coup, peu de cinéastes échappent à sa moulinette, excepté le René Clair ancien – il reste justement dubitatif sur ses titres hollywoodiens. Avec raison, il devine que Renoir (« qui n’a réussi à donner sa mesure qu’en des morceaux d’une plénitude parfaite qui accusent d’autant plus l’insuffisance du reste de l’œuvre ») ne fera jamais mieux qu’Une partie de campagne. Dans un bilan français de 1946, il écrit : « De tout ce fatras, il se dégage une impression lamentable de prétention démesurée, alliée à une pauvreté très réelle. » S’il a raison en ce qui concerne La Symphonie pastorale, Un ami viendra ce soir ou Petrus, et les brouettées de titres que-ça-n’en-vaut-pas-la-peine, on le suivra plus difficilement dans sa démolition d’Un revenant, qui demeure le meilleur film de Christian-Jaque, bonifié par chaque vision. En revanche, on partage l’intérêt qu’il manifeste pour des productions sans noblesse, comme les films de Jacques Daniel-Norman (3), L’aventure est au coin de la rue ou 120, rue de la Gare et on applaudit à son commentaire du Père tranquille, dans lequel il est un des seuls à déceler le premier volet de la mythification du peuple français comme tout entier résistant. On aurait aimé trouvé une formule aussi joliment définitive que « c’est un film très hexagone harmonieux »…
Il est fort dommage que Marchand n’ait pas continué, parmi ses multiples interventions, à traiter du cinéma. On aurait souhaité qu’il continue à jeter sur les écrans des années 50 le regard dénué d’œillères, intact après tant d’années, qu’il a promené ensuite sur d’autres paysages.
- Ce qu’il écrit à propos de Renaissance du cinéma français, de Georges Charensol, pourrait lui être retourné : « Si nous acceptons ce livre pour ce qu’il est, c’est-à-dire un recueil d’articles, nous possédons là un document d’époque, la photographie des réactions d’un bon critique en face de l’actualité. Il sera curieux de rouvrir ce dossier en 1960. »
- Qui avait vu son film La Vie de plaisir condamné à la fois, en 1944, par les occupants et par la Résistance.
- Qu’il écrit d’ailleurs Jean-Daniel Norman, orthographe fautive, qui conduit l’index à le ranger à la lettre N – comme Pierre Richard-Willm, classé à W.

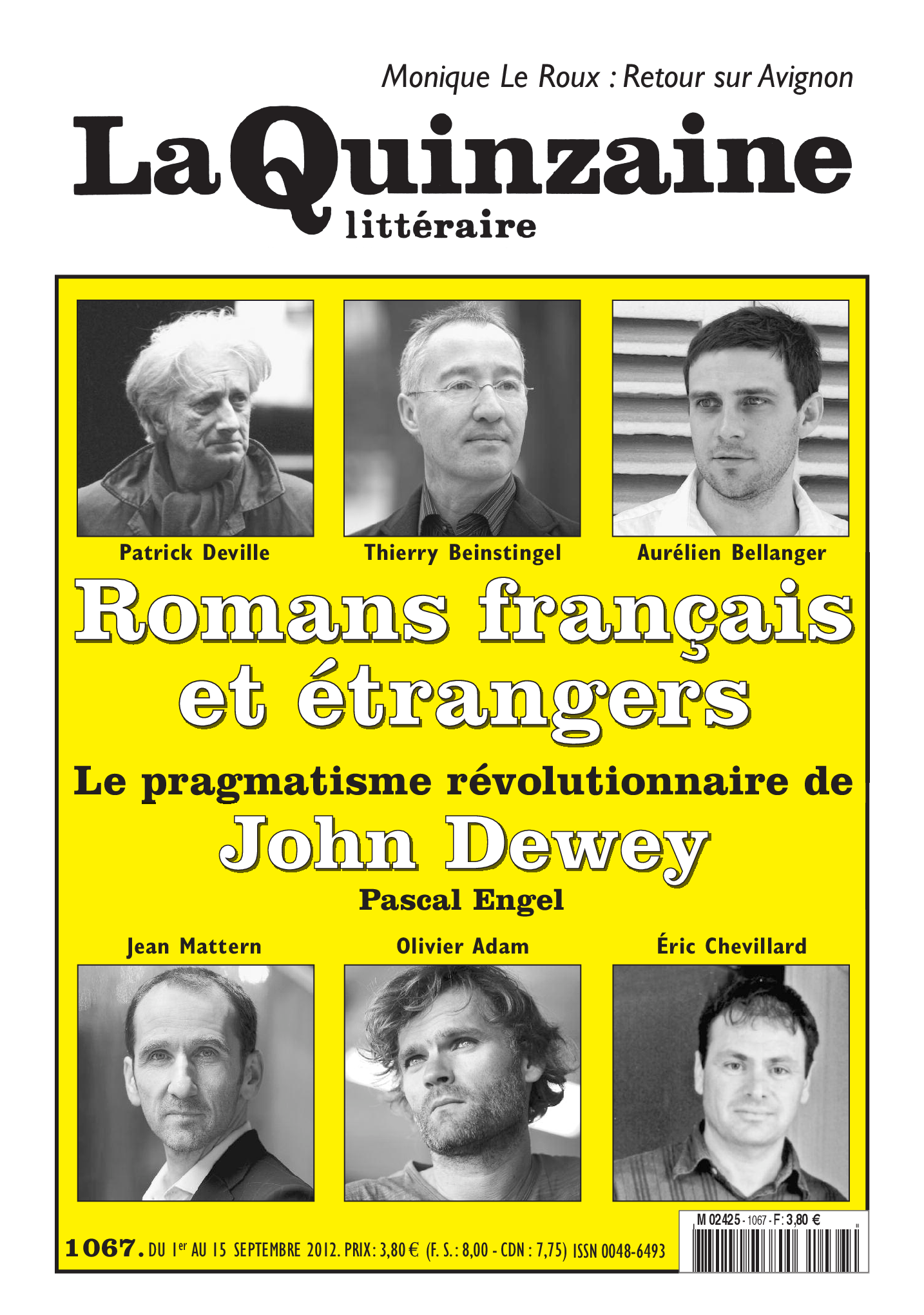

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)