Thierry Laisney – On dit qu’un interprète, en musique, doit « respecter le texte » et, en même temps, faire autre chose que de « jouer seulement les notes » ; comment comprendre ces deux exigences ?
Pascal Rophé – C’est là toute la difficulté. Ces deux aspects ne sont pas aussi antinomiques qu’ils en ont l’air, ils sont très complémentaires en fait. Les deux sont nécessaires pour qu’une interprétation soit à la fois vivante et intègre. Il faut ces deux paramètres, mais peut-être pas en même temps. La chose essentielle, c’est de partir de la partition et de toujours y revenir. C’est le travail de tous les interprètes honnêtes, qui ont ce sens de l’éthique qui veut que le génie, ça reste le compositeur et pas l’interprète. Il faut partir du texte, et le plus possible sans a priori, c’est-à-dire sans être « pollué » par les écoutes, en particulier récentes, qu’on peut avoir eues de la pièce en question. Quand je dois diriger une partition classique, j’évite absolument de l’écouter parce qu’on est fatalement touché – si ce n’est influencé – par ce qu’on entend. Et ce n’est jamais neutre, ceux qui disent que c’est neutre soit mentent, soit ne s’en rendent pas compte.
Mais si l’interprète n’est pas le génie, en musique il est le passage obligé : notre métier, c’est de transmettre un texte qui ne parle à personne. Pour qu’à partir d’une partition le public puisse comprendre, ressentir et vibrer, il faut un interprète qui agit comme un filtre, un filtre vivant qui a sa culture, son histoire, son énergie, son déterminisme propres. C’est la seconde phase en quelque sorte, après celle de la lecture du texte : comment vais-je servir le compositeur de mon mieux, avec mes qualités, mes défauts, les musiciens que j’ai, le nombre de répétitions que j’ai, tout ce qui relève de la circonstance et qui fait que ce n’est jamais la même chose évidemment. De toute façon, une interprétation est forcément personnelle : à partir du moment où un pianiste, par exemple, appuie sur une note, il n’y a que lui qui peut le faire à ce moment-là de la façon dont il le fait. Le sens qu’il donnera à cette note n’appartient qu’à lui-même, mais il faut que ce sens soit habité par un vrai travail en amont sur le texte.
Th. L. – Le compositeur, cependant, ne peut pas tout noter sur la partition.
P. R. – Mais il peut donner beaucoup d’informations en un minimum de temps : en un coup d’œil, vous avez la hauteur de la note, le rythme, le timbre, mais aussi le caractère de cette note, s’il faut la jouer de façon nerveuse, amoureuse, retenue, etc. Tout cela peut être indiqué. Après, l’émotion, chacun trouve sa façon de la rendre. Évidemment, c’est très difficile de savoir exactement quel tempo Beethoven souhaitait, et même si nous le savions, nous ne saurions pas à quelle couleur correspondait ce tempo, c’est-à-dire de quel type d’orchestre Beethoven disposait. Et puis, savoir dans l’absolu le tempo de Beethoven… Ce qui est important, c’est de savoir quelle dynamique il veut pour sa pièce.
Th. L. – À propos du tempo, justement, comment expliquer de telles variations entre différentes versions d’une même œuvre ?
P. R. – Pour le tempo comme pour le reste, la liberté de l’interprète doit être modérée par l’œuvre écrite. On peut légèrement sortir du chemin, mais il faut en être conscient, l’assumer et ne pas s’éloigner du texte dans des disproportions absolues. Allegro, ce n’est pas adagio. Quand Beethoven indique 60 (un battement par seconde), c’est 60 à son époque comme aujourd’hui. Dès lors, on peut être à 58 ou à 65, mais être à 40 ou à 90, ça me paraît extrêmement orgueilleux. Certes, il y a quelques cas difficiles : le Finale de la VIIIe Symphonie à 92 à la mesure, c’est trop, on ne peut pas jouer. Mais pour les sonates pour piano par exemple, les tempi que Czerny a mis sous le contrôle de Beethoven sont tous faisables. Je ne vois pas pourquoi on s’en éloignerait dans des proportions déraisonnables, si ce n’est par un égocentrisme tel qu’on en oublie l’auteur. Je ne vois pas pourquoi dans le Finale de la IXe Symphonie de Beethoven, au moment où entre le chanteur, on a des versions dix fois plus lentes que le mouvement, alors qu’il est écrit : quasi recitativo ma sempre in tempo. Cela peut s’expliquer par le rôle social que certains chefs d’orchestre ont acquis au cours du XXe siècle, et qui a donné libre cours à un égocentrisme surdimensionné. C’est comme si dans une tirade de Racine vous disiez un mot tellement lentement que ce mot prendrait un autre sens. Une telle réécriture de la partition a quelque chose d’horriblement prétentieux.
Th. L. – Que pensez-vous de l’exigence d’authenticité, telle qu’elle se manifeste notamment chez les « baroqueux » ?
P. R. – Il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Si, pour soi-disant restituer l’original, on doit obtenir quelque chose qui ne peut être joué que par une poignée de musiciens sur des instruments très spécifiques (par exemple, la musique pour clavier de Beethoven sur pianoforte ou sa musique symphonique avec des instruments à cordes en boyau), ça devient extrêmement restrictif, réducteur. L’intégrisme intellectuel en ce domaine me gêne énormément. On doit pouvoir jouer également avec des cordes métalliques, pas forcément au même tempo : les cordes en boyau rebondissent mieux. J’ai d’ailleurs rencontré un musicien formidable (quand j’ai fait l’intégrale des concertos de Beethoven avec lui), le pianiste Robert Levin, qui passe du piano au pianoforte, joue avec des orchestres baroques comme avec des orchestres modernes, tout cela sans aucun état d’âme. Mon cher camarade Jean-Guihen Queyras, un des plus beaux violoncellistes de notre époque, joue aussi bien sur cordes en boyau que sur cordes métalliques. En musique comme en religion, il ne faut jamais tomber dans l’intégrisme.
Th. L. – À votre avis, peut-il exister des interprétations radicalement neuves ?
P. R. – Une interprétation est forcément radicalement neuve parce que l’interprète en cause est le seul à pouvoir être lui-même. Sauf si vous avez des clones qui s’amusent à jouer comme tous les autres. Prenez un interprète qui joue une sonate de Beethoven ; quand il la rejoue le lendemain, il ne la joue plus de la même façon puisqu’il s’est enrichi de l’interprétation de la veille. Une interprétation est toujours neuve ; elle n’est peut-être pas toujours inventive, révolutionnaire ou intéressante, mais elle est toujours nouvelle.
Th. L. – Au lieu de « neuve », j’aurais peut-être dû dire alors « novatrice ». Si l’on pense à Gould…
P. R. – Glenn Gould, c’est autre chose : un martien, avec une aura et un charisme incroyables, et qui s’est construit son monde à lui, pas toujours d’ailleurs proche de la partition, quelqu’un de tellement puissant qu’il a marqué tous ceux qui l’ont entendu. Regardez sur You Tube Leonard Bernstein arrivant seul sur scène avant un concerto pour piano où son partenaire est Gould, et faisant une annonce où il explique qu’il va diriger le Ier Concerto de Brahms mais qu’il ne cautionne pas du tout ce que son public va entendre ce soir-là. Bernstein, musicien intègre, ne peut admettre que Gould fasse du Gould dans cette œuvre de Brahms, même si, par respect pour le pianiste, il a tenu à jouer quand même avec lui. Ce genre de dérives égocentrées pouvait se rencontrer aussi chez Celibidache, par exemple. Quand il dirige les Images de Debussy, la habanera du 2e mouvement d’Iberia dure 18 minutes au lieu de 9 en moyenne. Il y a un problème de nombrilisme : le chef se regarde plus qu’il ne regarde la partition. Il cherche à prendre le pouvoir sur le compositeur.
Th. L. – Peut-on dire que le chef d’orchestre détermine l’interprétation et que les instrumentistes en sont les exécutants ?
P. R. – Ce n’est pas aussi radical que ça. Le rapport chef/orchestre a beaucoup changé, c’est moins unilatéral. Les musiciens d’orchestre, de plus en plus formés, attendent beaucoup du chef c’est vrai mais donnent aussi beaucoup en retour. Aujourd’hui, les orchestres et les chefs communiquent beaucoup plus, et, arrivé avec ses convictions, le chef les voit remises en cause par ce qu’il entend, la qualité de l’orchestre, celle de la salle, par ce qui se passe (ou ne se passe pas) entre lui et les musiciens, etc. On n’a jamais de certitudes. Le chef est là pour faire converger les énergies, faire que les musiciens en face de lui jouent le mieux possible dans la même direction, c’est-à-dire en donnant le même sens aux mots ou aux notes. Il est là surtout pour indiquer comment il faut phraser les choses, quelle couleur sonore convient à telle ou telle pièce, les plans, les reliefs, etc. On ne peut faire ce travail qu’à double sens.
Th. L. – L’interprétation de la musique d’aujourd’hui pose-t-elle des problèmes particuliers ?
P. R. – Elle peut en poser si le compositeur maîtrise mal son écriture, ce qui est de moins en moins le cas. Ou s’il y a mésentente (musicale ou humaine) avec lui : un compositeur peut vous rendre insupportable le travail en répétition. Mais, en général, ça se passe bien. Je commence par lire la partition, puis je soumets mes réflexions au compositeur (il peut y avoir des fautes, des choses qui m’intriguent). Je suis totalement adepte de la présence du compositeur à mes côtés lors des répétitions, je cherche à aller le plus possible dans le sens qu’il m’indique. Le compositeur contribue ainsi à la restitution de ce qu’il a écrit, aux bonnes fondations de l’interprétation, mais l’interprétation elle-même, ce sont les musiciens sur scène le soir du concert qui la font.
Th. L. – Pouvez-vous nous parler de la phase de la lecture de la partition, avant toute réalisation sonore ?
P. R. – C’est le moment où je construis mon interprétation. Je travaille une partition à la table ; je parcours d’abord la pièce pour voir les proportions, la forme, l’énergie, je la feuillette rapidement. Ensuite, je plonge le nez dedans plus en détail, je lis tout de A à Z, mouvement par mouvement ou, en tout cas, forme par forme. Je me fais une idée auditive intérieure de l’œuvre, qui sera mon guide, mon modèle au moment des répétitions avec l’orchestre, qui sera la pré-vision de l’œuvre. J’essaie de la restituer quand je suis devant l’orchestre, c’est la courbe de ce que je vais chercher à obtenir avec lui.
Th. L. – Je voulais vous demander ce que vous pensiez de la notion d’« œuvre ouverte » en musique ?
P. R. – C’est un parti pris auquel je n’ai jamais adhéré. Le compositeur s’en remet à l’interprète, lui demandant de prendre la plume à sa place. On a beau parler de pistes et de jalons donnés à l’interprétation… Il n’y a rien de moins efficace qu’un orchestre mis dans une telle situation. Ou alors on fait du jazz, de la musique improvisée, mais c’est autre chose. C’est vrai que cela a été surtout pratiqué à une époque où on était en rupture avec tout, l’époque post-années 50, une sorte de Mai 68 musical. Et, comme le disait Pierre Schaeffer lui-même, pour s’apercevoir qu’une grande partie de ces voies-là étaient des impasses, il fallait d’abord les emprunter. Il y a ainsi des périodes dans l’histoire de l’art où il faut s’engouffrer dans toutes les ouvertures possibles pour pouvoir mieux les refermer après et continuer à avancer. Je ne crois pas du tout au remplacement du compositeur par l’interprète, j’y suis même farouchement hostile : le compositeur doit rester à l’initiative de ce qui est dit.
Thierry Laisney
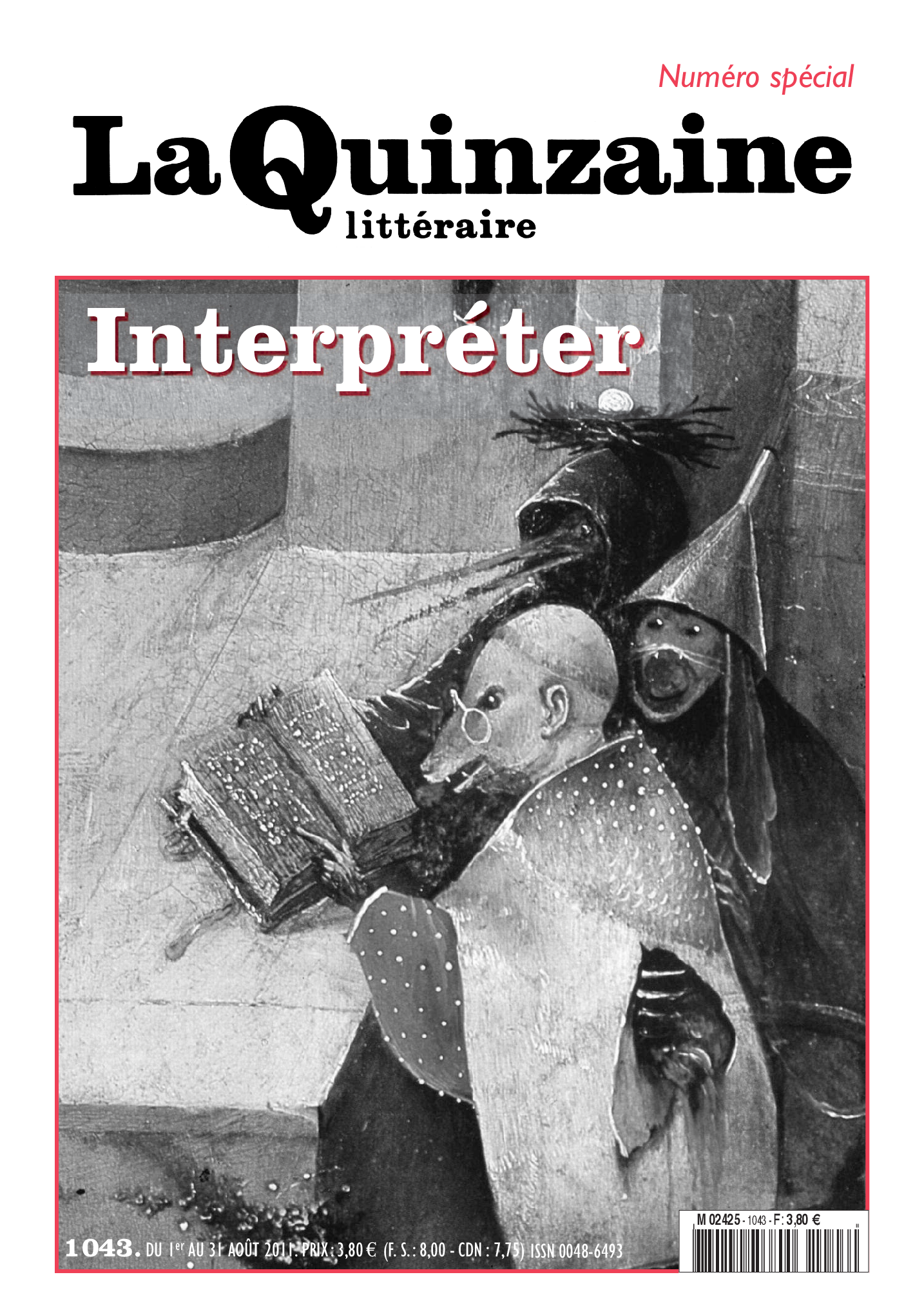

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)