Mais tout peut arriver. La preuve : la sortie de trois films, deux péruviens et un chilien, d’auteurs inconnus, et sans grands appâts pour ferrer des chalands peu nombreux, en plein cœur de l’été parisien. Deux documentaires sur des sujets a priori peu appétissants, un groupe de musiciens chiliens dans le désert, un village des Andes péruviennes qui enterre les morts d’un massacre survenu vingt ans plus tôt + une fiction sur les adolescents d’un bidonville de la banlieue de Lima. Rien là qui donne envie d’aller se perdre du côté de la barrière de Clichy, au Cinéma des Cinéastes, juste après la statue du maréchal Moncey (honneur au courage malheureux), alors qu’il est si agréable de faire des pâtés avec le sable de la plage de Paris. Et pourtant le voyage en vaudra la peine pour les amateurs lassés de tant de films « qu’il faut avoir vus ».
La distribution de ces trois titres est une aventure et un pari. René Féret, réalisateur obstiné, qui élabore depuis bientôt quarante ans et seize films (entre Histoire de Paul, 1975, et Madame Solario, que l’on verra en août prochain) une œuvre parmi les plus personnelles et les plus attachantes du cinéma français, à l’écart de toute mode et de toute contrainte, s’est engagé, en tant que président du jury du Festival du cinéma péruvien (Paris, avril-mai 2011), à sortir les deux longs métrages primés, dans les sections du documentaire et de la fiction. Il aura fallu un peu plus d’un an pour qu’il y parvienne, via sa société de distribution, JLM. Sortie modeste (10 copies, à la limite du confidentiel), à la mesure des moyens dont dispose ce franc-tireur tenace. Mais sortie tout de même, ce qui est l’essentiel.
S’ils existent, les amateurs exclusifs du cinéma en provenance du Pérou ne sont pas sur les dents. Entre 2002 et 2012, seulement six productions péruviennes ont été présentées en France, les deux plus notables étant les films de Claudia Llosa, Madeinusa (2006) et Fausta, grâce à son Ours d’or reçu au Festival de Berlin 2009. Ce n’est qu’en 2009, au Festival de Fribourg, que l’on a pu découvrir l’œuvre complète, inédite ici, de Francisco J. Lombardi (dont l’excellent La Ville et les Chiens, d’après Vargas Llosa). Aussi les deux titres signés Héctor Gálvez qui sortent le 25 juillet accroissent-ils considérablement la connaissance que l’on a (ou plutôt que l’on n’a pas) de cette cinématographie lointaine.
Lucanamarca (2008), documentaire coréalisé par Carlos Cardenas, a pour cadre un village perdu dans les montagnes de la région d’Ayacucho, là où prit naissance le mouvement maoïste du Sentier lumineux qui déclara, en 1980, la guerre au gouvernement de Lima. Un des principaux responsables du Sentier, originaire de Lucanamarca, y fut tué par les ronderos (les rondas campesinas étaient des milices paysannes formées pour lutter contre la rébellion). En représailles, les troupes du commandant Abimael Guzmán attaquèrent le village, le 3 avril 1983, et y exécutèrent, à la hache et à la machette, 69 habitants, en majorité des femmes et des enfants. Les cadavres, déposés dans un charnier, ne furent remis au jour que vingt ans plus tard, lorsqu’une commission dite de Vérité et de Réconciliation (?) prépara le procès des chefs du Sentier lumineux. Ouverture des fosses, mise en bière des squelettes retrouvés, construction d’un colombarium pour recevoir les cercueils, discours empli de promesses (évidemment jamais tenues) du Président Toledo – tout a été filmé, ainsi que les témoignages des survivants et leurs dépositions lors du procès de Guzmán. La force du film réside dans la justesse du point de vue, de plain-pied avec les protagonistes : le souvenir du massacre hante encore les habitants, l’identification des restes est une souffrance supplémentaire. On est frappé de découvrir le chef des maoïstes sous la forme d’un petit homme banal, moustachu et rondouillard, à peine crédible lorsqu’il brandit son poing levé en criant : « Communismo » – guère plus sanguinaire en apparence que Douch ou Pol Pot.
La misère et le sous-développement ne sévissent pas que dans les villages andins. Les bidonvilles de la capitale n’y échappent pas, même lorsqu’ils ont pour nom « Jardines del Paraíso », belle antiphrase. Héctor Gálvez, dans Paraíso (2009), choisit comme héros cinq jeunes en galère, entre petits boulots minables (de la réclame pour un fast-food, déguisé en poulet géant, par exemple), petits larcins ordinaires, longues discussions nocturnes pour oublier un avenir sans espoir – sinon la seule perspective de devenir militaire. Familles éclatées, parents inexistants – beau-père ivrogne ou mère traumatisée par un viol ancien –, on pataugerait dans le néoréalisme le plus pesant si, encore une fois, le point de vue adopté n’était aussi juste. Le regard que pose le réalisateur sur son petit monde est tout de tendresse, sans compassion aucune, aidé par le fait que les rôles sont tenus par des jeunes habitants du Paraíso qui portent leurs propres prénoms et « jouent » les situations qu’ils vivent au jour le jour. La vraisemblance, sinon la vérité, est criante. Galvez les capte tels qu’ils sont, dans un mouvement qui rappelle les débuts du Free Cinema anglais – mais Karel Reisz ou Lindsay Anderson, dans leurs courts métrages, refusaient la fiction. Ici la respiration narrative coule de source : on croit à ces adolescents perdus, maladroits dans leurs sentiments, englués dans la survie – seules les filles, lycéennes appliquées, sauront peut-être se fabriquer un futur à la mesure de leurs rêves. À Cannes, La Playa DC (J. A. Arango, Un certain regard) décrivait de manière semblable de jeunes Colombiens des bas quartiers de Bogotá, aussi paumés que les Limeños de Galvez.
La Réverbération (mais l’on préfère le titre original, La banda que busco el sonido debajo, Le groupe qui cherche le son en dessous) est une production franco-chilienne, cosignée par James Schneider et Benjamin Echazarreta (2012), mais qui n’a de français que deux des musiciens du groupe Panico. Notre connaissance de l’électro-rock chilien n’est pas assez avancée pour juger de la célébrité éventuelle du groupe. Mais ce que l’on en voit donne envie d’en savoir plus. On sait qu’ils préparent un album, on les entend jouer un peu, mais l’essentiel de leur activité, 85 minutes durant, est la recherche de sons. Pas n’importe quel son, LE son, tels la note bleue des jazzmen ou le mercury sound dylanien. Un son inouï, à la lettre, qu’ils vont traquer à travers le Chili : le son de la roche du désert d’Atacama réchauffée par le soleil levant, le son du sable qu’ils font glisser sur les dunes, le son « de la colline qui brame », le son du sel gemme qu’ils piétinent. Tout est musique, comme les sons que « taillait » le regretté Yann Parenthoën : un gigantesque pneu de tracteur sur lequel on saute, une cuve de métal que l’on frotte, l’eau du fond de la rivière à travers le préservatif qui protège le micro, l’écho dans les carrières de la plus grande mine de cuivre au monde (avec la belle légende de l’« homme de cuivre », cadavre resté trente ans dans le sol et que l’on a retrouvé couvert de métal). Que faire de ces sons qui sont derrière les choses ? On ne le saura pas, le film s’achevant avant la fabrication de l’album. Mais le voyage est passionnant, et le Chili des hauteurs aussi magnifique que dans Nostalgie de la lumière de Patricio Guzmán. On peut accompagner sans crainte ces chasseurs d’ondes étranges, le dépaysement est assuré.
P.-S. Les pourchasseurs de films hors normes, après les aventures de Bibi Fricotin en Lybie, ne devront pas rater La Clinique de l’amour, d’Artus de Penguern. Prière de ne pas s’arrêter au titre : il s’agit d’un joli détournement des codes du genre « les hommes en blanc » – un peu l’équivalent dans le délire des adaptations de standards qu’exécutait dans les années quarante l’orchestre de Spike Jones & His City Slickers. Les films marxiens ne sont pas si nombreux.
Lucien Logette
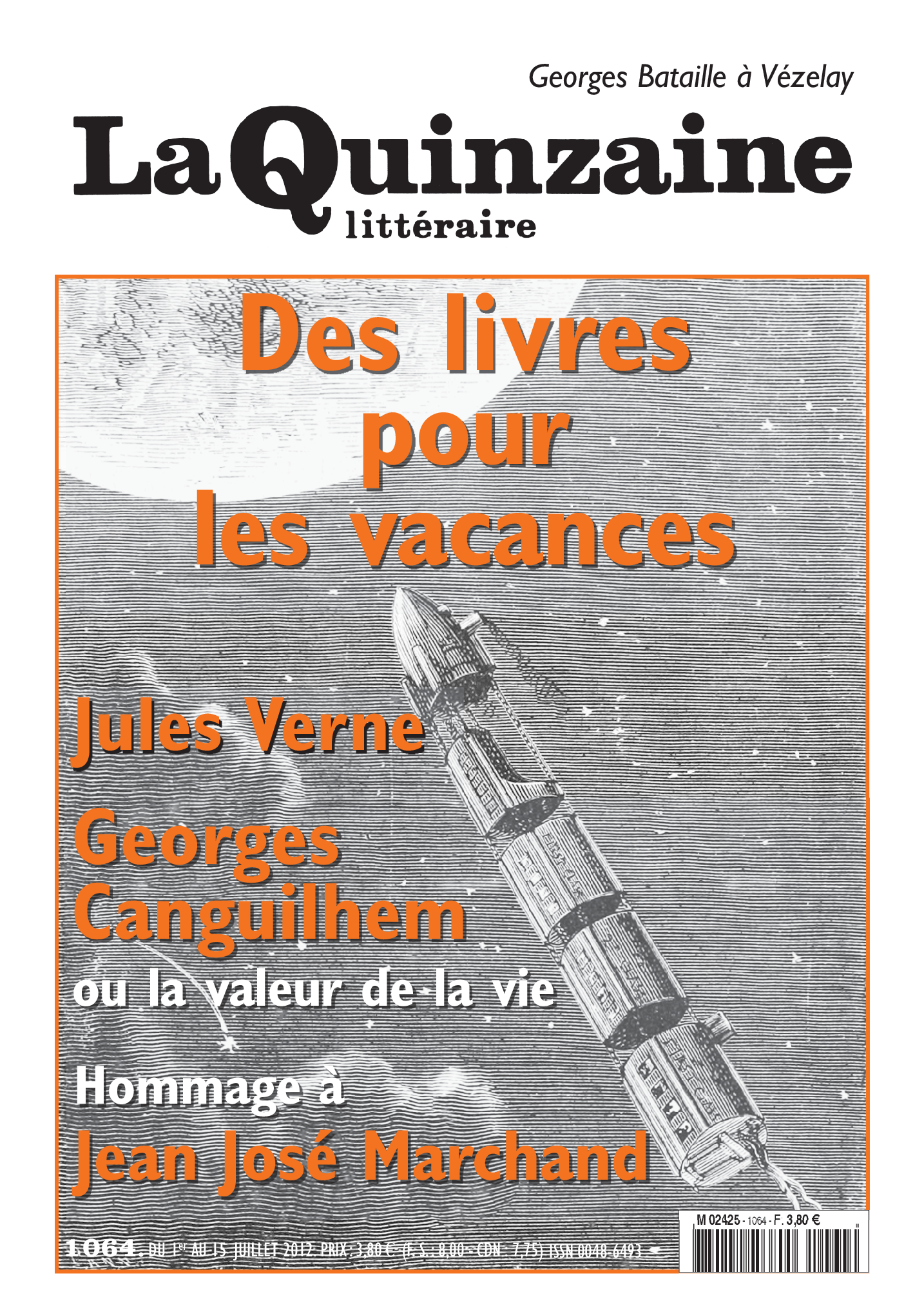

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)