Eh bien, non ! Toutes sortes de procédés rhétoriques (descriptions d’œuvres ; recréations d’« ambiances » : vernissages, fêtes, événements mondains ; interviews ; notices biographiques) sont employés alternativement ou simultanément afin de créer une variété de tons et de points de vue, et l’ensemble parvient à retenir l’attention, un véritable tour de force !
Malgré la part visiblement considérable d’invention pure dans le texte, tant du côté des « œuvres » ou des « performances » répertoriées que des tempéraments esthétiques retenus, il est probable qu’un certain public, celui qu’on appelle « averti », et en l’occurrence celui des familiers du petit monde concerné (peintres, couturiers, ensembliers, galeristes, sculpteurs, critiques d’art, chargés, à quelque niveau que ce soit, d’« affaires culturelles »), prendront un plaisir snob à décrypter les allusions à la réalité actuelle du monde des artistes et des marchands de tableaux ou d’« installations » muséales. Un tel livre appelle une telle lecture. Mais c’était déjà le cas lors de la parution d’À la recherche du temps perdu.
Or, précisément, la référence à Proust est ici omniprésente et foisonnante. Elle ne se cache pas d’ailleurs et, si presque tous les noms des personnages de ce remue-ménage mondain et artistique sont des créations de l’auteur, il en est au moins un, celui d’Elstir, qui signale la filiation directe entre la saga du noyau Verdurin et celle du microcosme scruté par Aram Kebabdjian. C’est dire l’ambition qui anime ce dernier, et l’étendue de sa réussite puisque son livre, même s’il convient d’en limiter la portée à l’analyse in vivo d’un seul des milieux proustiens, parvient à ne pas trop souffrir de la comparaison.
Retour des personnages (largement emprunté par Proust à Balzac) et par là capacité de suggérer le passage féroce du temps, qui transforme Miss Sacripant en Odette de Crécy puis en épouse de Swann, Les Désœuvrés fonde sur ce mécanisme, devenu canonique mais dont la maîtrise exige un doigté peu banal, l’essentiel de son efficacité narrative. Très vite, le lecteur comprend que la fragmentation du livre en mini-récits constitue un leurre, ou plutôt une séduction à mettre au compte de la diversité recherchée comme antidote à l’ennui.
En réalité, tous ces artistes qui paraissent si différents ont été, à un moment de leur carrière, hébergés dans une même vaste institution culturelle qui s’est donné pour mission, à l’image des couveuses informatiques modernes, de faciliter la percée de « jeunes pousses », et dans une intention identique : produire des noms qui seront cotés sur le marché de l’art, deviendront les champions que s’arrachent les galeries les plus connues et rapporteront à leurs « sponsors » directs ou dérivés ce qui les intéresse, à l’exclusion de toute autre considération : du fric.
L’une des dimensions les plus présentes du texte – et les plus savoureuses – est donc la satire. Elle s’exerce surtout à l’encontre des « grandes machines », soit qu’il s’agisse d’objets circonscrits, même si leur dimension nécessite des salles de proportions versaillaises, soit que le spectacle auquel est convié ce qui compte de gratin en matière de cultureux institutionnels ou de richards béats se déroule en plein air et réclame des prouesses ridicules de la part des organisateurs et des clients piégés par leur propre sottise. Séances de rigolade garanties, dans des morceaux de bravoure qui parfois font penser aux séquences échevelées de passages d’Henry Miller, ou du Casanova de Fellini. Les pitreries dorées sur tranche d’un Jeff Koons et l’admiration dégoulinante de ses fans ne sont pas loin.
Pourtant, Les Désœuvrés ne se limite nullement à un jeu de massacre, qui d’ailleurs, découpé en trente-quatre morceaux, deviendrait facile et peut-être fastidieux. Le retour des créateurs sur le devant de la scène à des moments successifs de leur évolution personnelle, non seulement artistique mais humaine, le fait que nous en apprenions un peu plus chaque fois sur leur histoire depuis l’enfance, leurs failles intimes, leurs amours, la profondeur de leur engagement et l’authenticité de leurs angoisses, empêchent qu’ils ne soient pour nous (et d’abord pour leur narrateur) que des fantoches. Le cas est patent pour Dolorès Klotz, qui n’opère pas moins de six réapparitions à l’avant-scène du livre, une demi-folle pathétique dont l’apport esthétique réel dans la foire aux vanités culturelles se réduit à bien peu de chose, mais qui recueille la sympathie du lecteur grâce à l’obstination dont elle fait preuve pour parvenir au bout d’elle-même, c’est-à-dire à rien – comme nous tous.
En fin de compte, « les désœuvrés » est un titre ambigu, qui peut se lire comme antiphrase. Rien de moins désœuvré que ces « horribles travailleurs » qui passent leur temps à œuvrer, le plus souvent menés par une volonté entière, et absurde, d’aboutir au chef-d’œuvre. Bien peu d’entre eux, contrairement à leurs commanditaires – et même chez ceux-là il importe de nuancer –, sont guidés uniquement par l’appât du gain. « Moi, je travaille ! », se rengorge le PDG qui a fait fortune dans je ne sais quel gadget futile. « Moi, je travaille ! », dit l’ouvrier borné. Mais eux aussi travaillent, et furieusement même, et leur désespoir insondable quand ils se trouvent, ayant déroulé le cours de leur vie, privés d’œuvre qui leur survive et en cela « désœuvrés » ne saurait laisser insensible quiconque tente de se perpétuer.
Une preuve formelle que l’auteur de ce beau roman cocasse et triste à souhait ne se moque pas des « cocus du vieil art moderne », comme disait Dalí, c’est le texte consacré à l’unique photographe du livre, Valérie Hornstedt, aux pages 314-336. Aram Kebabdjian, entre autres activités semble-t-il, est photographe et il ne se permet pas de plaisanter avec sa pratique. Tout amateur, tout praticien de ce qui est peut-être un art à part entière – il m’arrive d’hésiter –, trouvera de l’intérêt à lire ces pages passionnées et profondes, et le miracle toujours nouveau de la « révélation » photographique, possible même à notre époque désabusée de triomphe du numérique, lui apparaîtra pour ce qu’il est : un surgissement à jamais inattendu de la Beauté, jaillissant hors du bain telle Vénus anadyomène.
Maurice Mourier
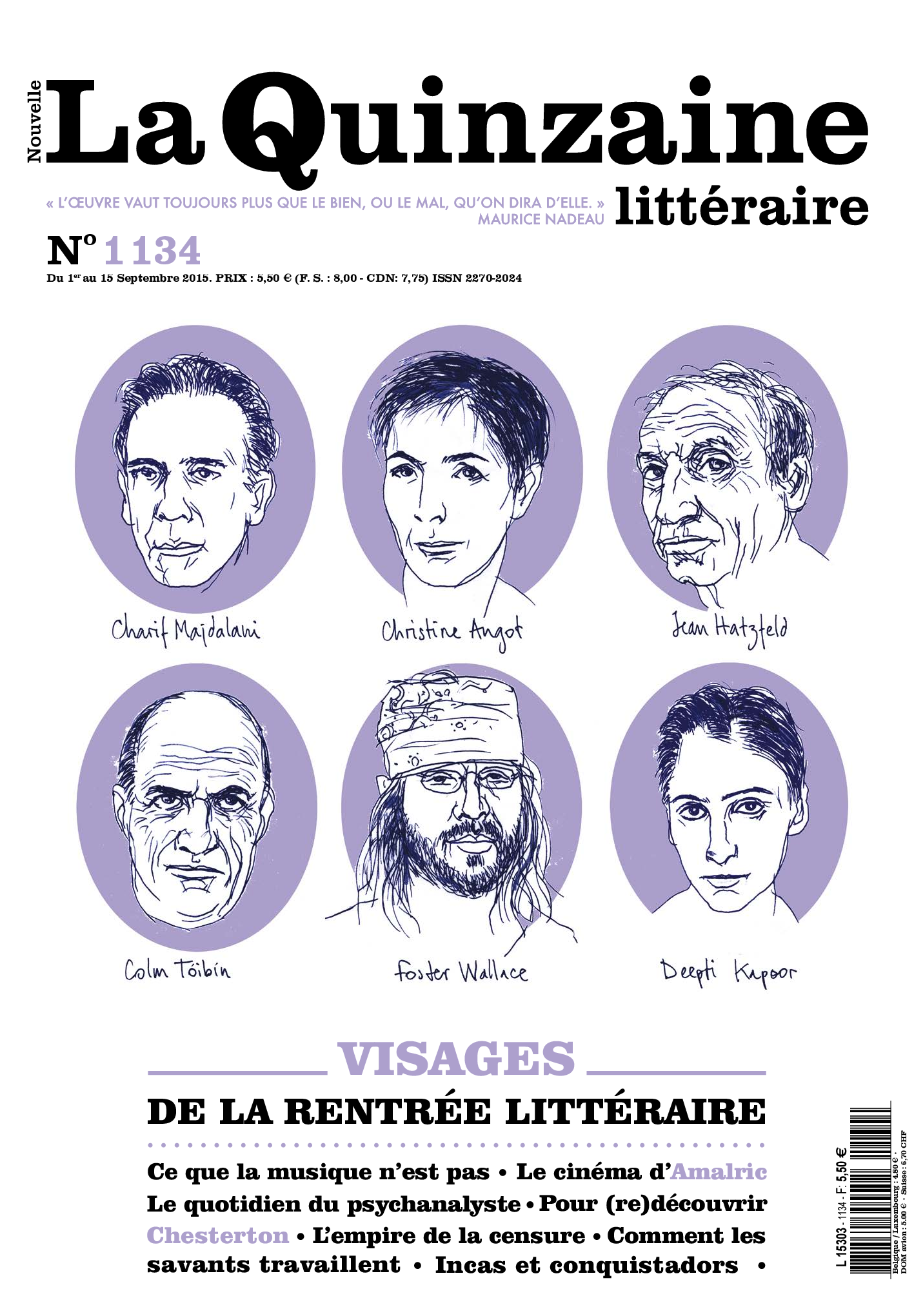

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)