Remarquablement introduite par Alastair B. Duncan, cette seconde série rassemble presque tout le reste, de L’Herbe (1958) au Tramway (2001), opus ultime, en ajoutant à ce nouveau florilège de huit titres deux proses ou perles poétiques de 1973, Archipel et Nord, commandes d’un éditeur danois pour des revues touristiques de luxe publiées annuellement. On est cependant loin encore de posséder, avec les volumes de la Pléiade, les œuvres complètes de Claude Simon. Manquent au minimum les quatre premiers textes : Le Tricheur, La Corde raide, Gulliver et Le Sacre du printemps, dont la parution s’étale entre 1945 et 1954 au Sagittaire puis chez Calmann-Lévy, et que l’auteur a expressément souhaité exclure de sa bibliographie.
Également responsable des éclairantes notices correspondant à chaque ouvrage (les notes résultent de l’apport de ses deux collaborateurs), Alastair B. Duncan souligne l’unité thématique de ce second ensemble, qui repose sur l’utilisation par Claude Simon, comme matériau privilégié de son travail, d’éléments empruntés à la saga familiale, ou plutôt au croisement de deux sagas, celle du père, fils d’un modeste vigneron du Jura, devenu saint-cyrien et officier grâce au dévouement de ses deux sœurs institutrices (après une belle carrière coloniale, il est tué dans la Meuse le 27 août 1914) ; et celle de la mère, issue d’une riche famille propriétaire de vignobles dans le Languedoc et qui compte parmi ses aïeux un brillant général de la Révolution et de l’Empire (passionnément amoureuse de son mari, elle ne se remettra jamais de sa disparition, et mourra en 1925, laissant son fils unique orphelin à un peu plus de dix ans).
Qu’il s’agisse du premier ou du second volume toutefois, Claude Simon, qui disait n’avoir guère d’imagination, aura toujours puisé dans son propre passé de quoi bâtir ce qu’il n’appelle qu’avec réticence des fictions. Cela est vrai dès le début de son activité d’écrivain, mais effectivement le choix opéré par lui dans le premier volume de la Pléiade mettait l’accent sur ses expériences de la défaite au cours de la guerre de 1939-45, expériences centrées sur lui-même et ses traumatismes ultérieurs, l’épicentre de ce premier recueil étant La Route des Flandres (1960), tandis que le tome II élargit considérablement le champ de la remémoration. Convoquant à nouveau, dans ces trois chefs-d’œuvre successifs que sont Histoire (1967), Les Géorgiques (1981) et L’Acacia (1989), les épisodes déceptifs inspirés par les deux guerres mondiales, il y adjoint (dans Leçon de choses notamment, en 1975) des réminiscences ironiques de la guerre de 1870. Mais il emprunte surtout à l’épopée et à l’histoire intime de l’ancêtre Jean-Pierre Lacombe Saint-Michel (1751-1812), régicide en 1793, général la même année, gouverneur de Barcelone en 1810. On lira avec intérêt la vie de ce personnage réel et flamboyant, à la fois sabreur et propriétaire terrien pointilleux, dans la chronologie érudite qui lui est consacrée (pp. 1 515-1 521), en même temps qu’on pourra prendre connaissance d’informations concernant son frère cadet Jean-Marie, militaire lui aussi mais déserteur et fusillé en 1799.
Claude Simon s’appuie donc, pour écrire ses romans, sur des faits avérés. Lorsqu’on peut en retrouver la trace historique, ou compulser les cartes postales envoyées des colonies par son père à sa fiancée, avant leur mariage en 1910, on est frappé – c’est le savant commentateur des textes qui nous le dit – par l’exactitude, souvent scrupuleuse, des citations et des références. Claude Simon ne trompe pas son lecteur, il n’invente rien et c’est paradoxal.
Il convient de se souvenir en effet que sa carrière littéraire véritable, celle en tout cas qu’il avoue pour telle, a commencé à Minuit grâce au manuscrit du Vent, apporté à Jérôme Lindon par Alain Robbe-Grillet, et que cette carrière, presque jusqu’au Nobel décerné en 1985, s’inscrit dans le cadre de la dernière école, le Nouveau Roman, qui ait affirmé bien haut en France des présupposés théoriques purs et durs. Parmi ceux-ci, le mépris affiché à l’égard du document cautionnant une pratique réaliste de l’écriture romanesque, et pas seulement sous son avatar grotesque de réalisme socialiste. La Comédie humaine elle-même, que le héros de L’Acacia entreprend de lire de bout en bout lorsqu’il a échappé à son stalag à la fin du livre, mais plutôt par devoir et sans plaisir, n’échappe pas, non plus que les intrigues linéaires jugées artificielles de Stendhal, aux sarcasmes de « nouveaux romanciers » pour qui, selon le mot de Raymond Roussel, « l’imagination est tout ».
Il s’agit là de récuser la représentation classique du monde et par conséquent de refuser que l’objet littéraire soit une imitation du vrai, du vécu, de la nature. Comme le dit à peu près Robbe-Grillet en évoquant, dans Pour un nouveau roman, son propre travail de description d’une mouette dans Le Voyeur, ce n’est pas l’oiseau réel qui importe en art, mais celui qu’on a dans la tête.
Au sein de cette promotion d’une poétique du langage (qui doit une partie de sa virulence critique à l’exemple de Francis Ponge et de sa « rage de l’expression »), une poétique qui vient s’opposer frontalement au roman traditionnel et à ses prétentions figuratives, Claude Simon, ancien « apprenti cubiste », joue une partition décalée. Un fameux colloque de Cerisy tenu dans les années 1960 après la parution de La Route des Flandres permet de toucher du doigt la singularité du romancier. C’est l’époque où, dans le groupe des jeunes loups de l’écriture « objectale », Jean Ricardou, par ailleurs exégète subtil de certains textes (d’Edgar Poe par exemple), incarne l’orthodoxie anti-référentielle la plus dogmatique. Il affirme alors avec aplomb que la scène époustouflante au cours de laquelle, dans le livre, un colonel à cheval entraîne comme à la parade, en mai 1940, trois cavaliers hébétés et vaincus droit dans le guet-apens que les ennemis ont tendu à l’armée française, et se laisse stupidement abattre par un tireur allemand embusqué, ne peut être – cela va de soi dans la théologie néo-romancière – qu’entièrement inventée. Ce à quoi, en un complet et moqueur désaveu, Claude Simon oppose la lettre d’un ancien compagnon d’armes authentifiant toute l’affaire dans ses moindres détails. Est-il donc, lui qui intègre sans état d’âme la réalité historique la plus factuelle à ses fictions machinées, un traître à la cause sacrée de la nouvelle école ?
Ce serait d’autant plus absurde de le soutenir qu’il est lui aussi un adversaire acharné de la narration réaliste ou, pis encore, naturaliste, et qu’il partage, en expérimentateur-né, les ambitions communes à un groupe où quelques autres talents de premier ordre (Robbe-Grillet, mais aussi Claude Ollier, Robert Pinget et, quoique « à distance », Marguerite Duras) s’efforcent de dire le monde sans s’inféoder aux formes vieillies, déjà raillées par Valéry, que les romanciers « engagés » avec qui ils ne cessent de croiser le fer, Sartre en tête, ont adoptées par conformisme esthétique.
Deux des textes de ce second volume constituent les témoins les plus éclatants de cette fièvre d’expérimentation qui informe plus ou moins visiblement la totalité de l’œuvre : Les Corps conducteurs (1971) et Leçon de choses (1975). Le premier, qui incorpore la majorité d’Orion aveugle, superbe éclaircissement de la méthode simonienne (Skira, 1970), célèbre dès son titre quasi abstrait la pulsion théoricienne latente d’une écriture juxtaposant, sans en expliquer la raison, par un effet de « collage » saisissant, plusieurs séquences de « choses vues » en différents lieux, dont New York. Chacune des séquences traverse de part en part l’ensemble du roman et, comme dans certains films underground américains de la même époque (ceux de Dwoskin en particulier), s’emploie souvent à décrire des parcours urbains en progressant avec une extrême lenteur à coups de phrases courtes apparemment dépourvues d’affects.
Quant à Leçon de choses, texte jubilatoire, il résulte d’une gageure, développer sous forme de roman deux pages écrites pour Maeght et destinées à susciter une réaction picturale d’Alechinsky. Pari tenu : à partir de la description minutieuse de travaux de rénovation en cours dans la propre maison de l’auteur (ravalement d’une pièce), s’élaborent trois fictions qui reposent la première sur la réalité matérielle des gestes d’ouvriers (un jeune, un compagnon) qui causent tout en détruisant de leurs masses le plâtre des murs ; la deuxième sur une scène de la guerre de 39-40 tissée de souvenirs vécus mais attribués à la reconstruction mémorielle du vieil ouvrier ; enfin la dernière sur des tableaux impressionnistes inventés où figurent des jeunes femmes, ce qui suscite, comme rebondissement récurrent, une séquence très crue de coït nocturne.
Exemple de maîtrise éblouissante, ce joyau a pour mérite annexe de permettre le détourage pédagogique à peu près complet de la méthode d’un écrivain inventeur d’écriture, non de faits, qui a sans doute porté le Nouveau Roman au faîte de sa spécificité artistique. Montage, chevauchement, imbrication, inclusion, superposition : appartenant à tous les registres du monde inanimé ou animé, les objets avec lesquels jongle le narrateur, et qui sont pour lui, en leur qualité signifiante de mots totipotents, autant de « générateurs » textuels, ne cessent – faute de quoi une gratuité s’installerait, qui tuerait à la racine l’émotion – d’entretenir des rapports étroits avec lui, avec son humeur et son humour, ses sensations, avec le flot mal endigué de ses souvenirs.
Bien avant Robbe-Grillet qui, devant les contresens commis à propos de son œuvre (qui en pâtit aujourd’hui), fut obligé d’avouer, à l’orée d’un de ses plus beaux livres, Le Miroir qui revient, « Je n’ai jamais parlé que de moi », Claude Simon assénait dès 1962 à ses détracteurs hostiles au « formalisme » du Nouveau Roman : « Je ne peux parler que de moi » (Les Nouvelles Littéraires, n° 1 809, 3 mai 1962).
Proust n’aurait pas dit autre chose (ni Balzac, ni Chateaubriand, et l’on pourrait, de ce dernier à Simon, en passant par Balzac, Proust et le Céline du Voyage, dessiner une assez grandiose trajectoire vectorisée de génies qui, s’étant lus les uns les autres, ont balisé la route royale de notre prose ou de notre poésie romanesque – Balzac se disait à juste titre poète). De quoi parlent tous ces gens-là ? D’eux-mêmes, puisque ainsi ils parlent de nous, c’est-à-dire de leurs souvenirs, et tous s’acharnent à ressusciter leur passé qui s’enfuit, donc à sauver autant que faire se peut leur vie et par ricochet la nôtre.
Chez Claude Simon, cette tentative éperdue – perdue d’avance – de fixer le passé friable crée l’objet d’art non par la continuité d’un récit aux articulations chronologiques patentes, mais au contraire par la mise en lumière d’une fragmentation, d’une pulvérisation du moi dont il s’agit de tenter, comme l’enterrée de Oh les beaux jours !, de perpétuer dans et par un texte les labiles possessions. Parti de la longue phrase enveloppante, sécurisante, de Proust, qu’il réutilise largement, il la disloque, en disperse les morceaux, essaye de les rabouter, construit ainsi, contre le temps inexorable – qu’il espère moins avoir vaincu que Marcel, en pessimiste radical qu’il est –, « l’aboli bibelot d’inanité sonore » mallarméen qui métaphorise l’inutilité matérielle et sociale de la Beauté, tout en constituant néanmoins, dans la débâcle universelle des jours et des rêves, le seul talisman qui nous reste.
Maurice Mourier
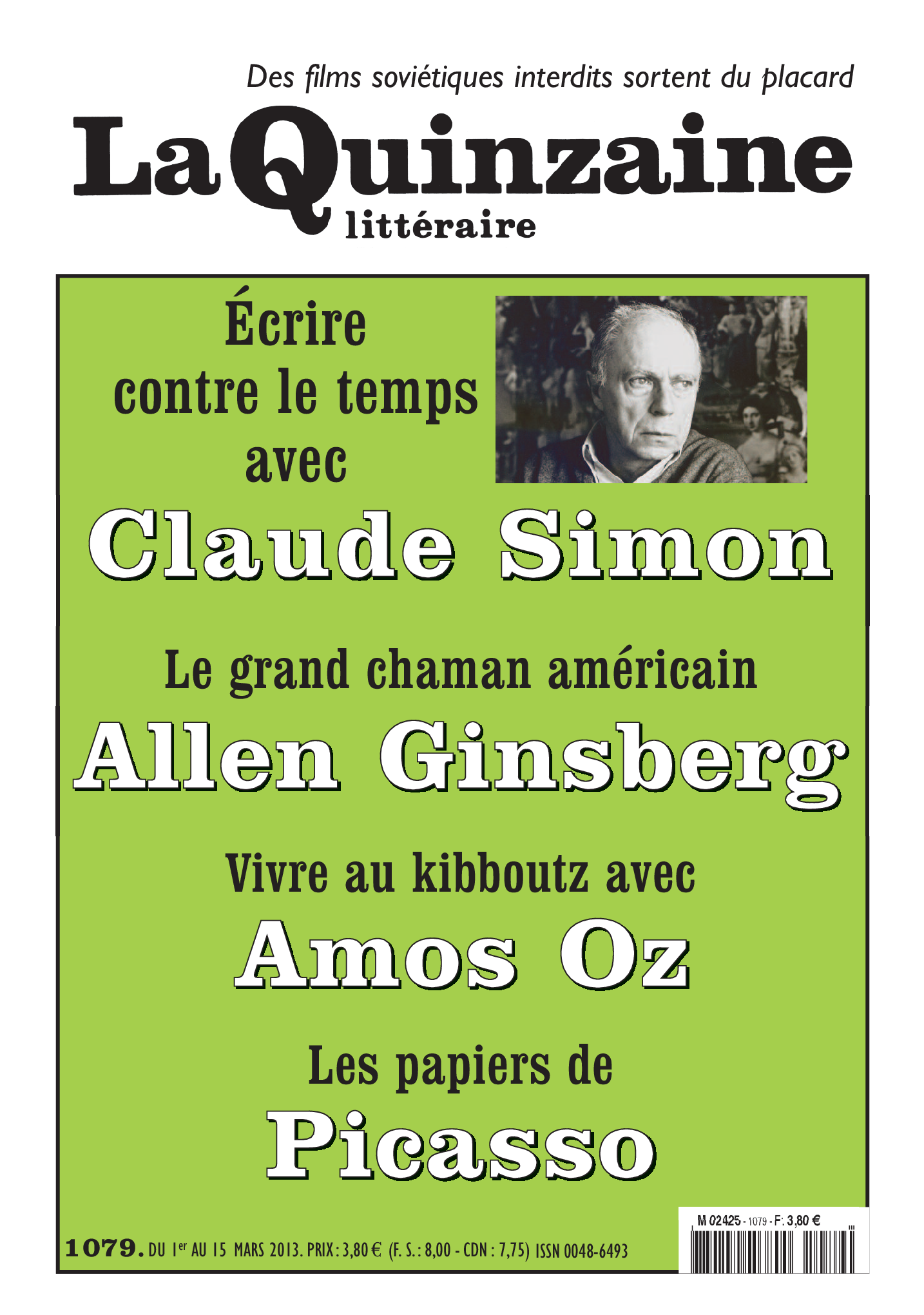

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)