Augmenté d’un index et d’une abondante bibliographie, Rouge sang est constitué d’un ensemble de textes tirés de divers auteurs de l’Antiquité grecque et romaine, que les historiennes Lydie Bodiou et Véronique Mehl ont réunis et présentés dans un ouvrage introduit par un long entretien avec l’anthropologue Françoise Héritier, successeur de Claude Lévi-Strauss au Collège de France, et titulaire de la chaire d’« étude comparée des sociétés africaines ». Dans ses travaux, Héritier s’est beaucoup appuyée sur Aristote, qui a apporté des éclairages décisifs sur la « valence différentielle des sexes » : chez ce philosophe, la notion de monstruosité commence dès que l’homme engendre une fille. Avec un certain amusement, Françoise Héritier se plaît à rappeler un fait marquant : Aristote constate que le pire s’observe quand les trois puissances de l’homme sont toutes en défaut et que naît une fille ressemblant à sa grand-mère maternelle !
Dans Retour aux sources (Galilée, 2010), Françoise Héritier, qui s’est toujours intéressée à l’autrefois et à l’ailleurs, essaie d’expliquer le fondement même de la structure de pensée – présente chez les Grecs – de la sympathie existant entre les registres cosmologiques du monde, le monde social et le monde biologique, cette sympathie impliquant que les mondes doivent être en équilibre ou en harmonie. Françoise Héritier revient également sur la notion d’« invariant », c’est-à-dire sur le lien qui existe nécessairement entre deux concepts, même si une société et une autre offrent des réponses diamétralement opposées. Dans le cas de l’anthropologie du corps, c’est la pratique du terrain qui a amené Françoise Héritier à s’interroger sur certains phénomènes liés au système de parenté. Elle constate ainsi que, quelle que fût la différence d’âge, il y avait une infériorisation du statut féminin.
Enfin, l’anthropologue note que, pour les Anciens, le sang est ambivalent : il a des connotations très positives – vie, rouge éclatant – mais est associé aussi à la mort, à la maladie : « Le sang est donc porteur de la chaleur, de la vie, du mouvement, de la forme, la forme humaine purement et simplement, de la pensée, de toutes les idéalités, le nom, etc., tout dépend du sang ». En effet, chez les Grecs, le sang véhicule la notion de corruption dans la mesure où il est « échauffant ». Françoise Héritier ne perçoit cependant pas l’Antiquité, contrairement à l’idée reçue, comme noyée sous l’aspect sanguinaire de la brutalité pure. Le sang, selon elle, reste toujours un sujet politique et contemporain, ses représentations étant liées encore aujourd’hui à des craintes, à des inquiétudes (sida, sang contaminé). Suscitant la fascination, le sang est omniprésent, par exemple, dans les séries policières, où la victime se résume souvent à une tache de sang sur le sol, dans les journaux, où il fait les gros titres, dans le goût des adolescents pour la « bit-lit » (« littérature mordante »), la mort et la maladie étant, a contrario, aseptisées dans notre quotidien.
Articulé en quatre grandes parties qui s’appellent les unes les autres et se complètent – « Voir rouge », « Le sang fait le corps », « Communauté de sang » et « Les grands sanguinaires » –, le volume de Lydie Bodiou et Véronique Mehl adopte une démarche essentiellement textuelle, puisqu’une large part est accordée aux nombreux extraits recueillis. Présentés en quelques lignes éclairantes, ces derniers constituent autant d’illustrations documentaires des différentes catégories abordées par les auteures. Qu’en est-il du sang au quotidien ? Du champ d’honneur se transformant, dans un bain de sang, en champ d’horreur ? Que se produit-il quand le sang se fait spectacle ? Les Anciens voyaient-ils la vie en rouge ? Ces questions servent de cadre à la première partie de l’ouvrage, qui s’attache ainsi aux lieux et aux temps attendus pour faire couler le sang, comme les batailles et les campagnes militaires, ou les sacrifices nécessaires à la communication avec les immortels et qui rythment le calendrier des fêtes. Dans le cadre militaire, le sang est celui de l’âpre combat qui confère la gloire au héros, mais suscite l’effroi, comme en témoignent par exemple les passages de Plutarque (Marius, 21, 3-8), d’Eschyle (Les Perses, 412-432) et de Thucydide (La Guerre du Péloponnèse, VII, 84-85). Ainsi, certains noms témoignent pour la postérité des batailles passées. De « la mer rouge de sang » à Samos qui suggère des épisodes meurtriers, légendaires ou réels, au « Thermodon béotien », dont le vrai nom est « Haimon », dérivé de « haima » (« le sang »), la toponymie garde la mémoire du passé, glorifiant les combats et mettant en garde contre de funestes destins. À cela s’ajoutent un certain nombre de considérations ayant trait à la gamme de couleurs à laquelle le sang renvoie, et qui trouve écho dans l’intimité et l’ordinaire de la vie. Les extraits sélectionnés (comme Achille Tatius, Leucippé et Clitophon, II 11, 2-8 ; Darès le Phrygien, Histoire de la destruction de Troie, 12-13) montrent que la palette peut être étendue du plus intime au plus anecdotique, du plus commun au plus singulier. En définitive, « le sang, c’est le quotidien qui palpite, de la vie à la mort ».
Dans « Le sang fait corps », les deux auteures avancent l’idée que le sang est l’humeur du corps la plus facilement identifiable. Son éruption alarme, sa provenance et sa fabrication intriguent. Il chemine dans le corps par les veines et les artères jusqu’aux organes, selon un schéma que les médecins ont cherché à établir pendant toute l’Antiquité. En outre, le sang sert d’élément classificatoire, permettant de distinguer les espèces animales, les hommes et les dieux – dans les veines desquels coule l’ichôr –, et dénonce les femmes qui ne savent pas le maîtriser. Enfin, il singularise certains héros et isole les morts. Comme le montrent les passages choisis, tant que le sang reste à l’intérieur du corps il ne cause pas véritablement de problème, indépendamment du sang féminin. À la fois signe et symptôme d’une effraction du corps, d’un dysfonctionnement ou d’une maladie, il permet au praticien (voir Hippocrate, Du régime des maladies aiguës,appendice, 31) de poser un diagnostic et de proposer une thérapie. Le sang se dompte, mais demeure une substance aussi prodigieuse que menaçante car corruptible. Le corpus de l’ouvrage met par ailleurs en évidence le fait que le rouge est la couleur des sentiments, révélant l’état psychologique – la timidité, l’indignation, la pudeur, la retenue – mais aussi les excès du corps et le débordement des passions incontrôlées. De l’effervescence qui enflamme l’esprit ou le cœur à la blancheur qui fait blêmir les traits, c’est la vie intérieure qui est ainsi donnée à voir.
Qu’en est-il de la communauté du sang ? Durant toute l’Antiquité, le sang est au cœur de la compréhension de la reproduction et des liens familiaux. Ainsi, aux liens du sang et aux sentiments qui cimentent le groupe, s’ajoutent des pratiques sociales communes, la recherche d’alliances renforçant les mariages – autant d’aspects qui constituent l’objet de la troisième partie de l’ouvrage. Dans la tragédie (par exemple, Œdipe de Sénèque) ou dans le roman (La Pharsale de Lucain), le sang paraît primer sur tout autre lien, et bien des héros revendiquent leur appartenance à une lignée, clament leur amour pour leurs enfants, recherchent la douceur d’une mère ou pleurent un frère trop tôt disparu. Que l’on soit à Athènes ou à Rome, des rites renforcent le groupe, accompagnant ses moments de rupture, d’entrée et de repli. La grande crainte de l’Antiquité est en effet le déchirement de la famille, de la cité ou de l’empire. Les crimes intrafamiliaux sont les plus sévèrement punis, les guerres civiles sont honnies.
En outre, le sang, qui permet de tisser des liens avec les dieux ou le monde infernal, peut être utilisé dans des rituels magiques. Dans certains mythes, il est même générateur : de quelques gouttes de sang pouvaient naître des divinités ou des fleurs, la beauté succédant au drame. D’autant plus que l’Antiquité est souvent présentée comme un monde perpétuellement en guerre. Le monde des cités est construit sur l’idéal selon lequel le citoyen doit défendre sa patrie, considérée comme un prolongement de sa propre famille. En témoignent la République romaine et ses conquêtes rapides, de l’Italie puis de la Méditerranée, qui offrent des champs de bataille où les hommes nouveaux peuvent faire carrière, briller par leurs exploits et mourir pour une cause exaltante (Xénophon, Constitution des Lacédémoniens, XI, 3 ; Appien, Les Guerres civiles, II, XIV, 98-99). Comme le soulignent les textes, la souffrance des corps est occultée par les victoires, les cicatrices ne s’exposant que quand elles permettent d’illustrer des combats que beaucoup craignent et envient à la fois.
Un dernier court chapitre est consacré aux « grands sanguinaires » : l’Antiquité fantasmée est rouge – couleur du sang dont on imagine qu’il coulait en abondance, et de la pourpre qui aurait coloré les parures. Les XXe et XXIe siècles ont repris cette vision et l’ont popularisée, avec par exemple la Médée (1969) de Pasolini ou le péplum de Noam Murro, 300 : La naissance d’un empire (2014). Une Antiquité sanglante est ainsi offerte à l’imaginaire contemporain, comme en témoignent, dans le monde grec des cités ou dans l’Empire romain, les quelques noms qui défrayaient la chronique et assombrissaient les mémoires et au sujet desquels il est parfois difficile de démêler le vrai du faux. Le fait est qu’on n’écrit pas une tragédie avec de bons sentiments, qu’on ne brosse pas des portraits littéraires avec seulement de l’admiration (Sophocle, Ajax ; Euripide, Héraclès). Enfin, dans des sociétés où la guerre est endémique (comme la piraterie ou le brigandage), la violence fait partie du quotidien, et avec elle son lot de blessures, de morts – et son flot de sang.
L’ouvrage de Lydie Bodiou et Véronique Mehl met ainsi en perspective, grâce à sa valeur documentaire et testimoniale, un grand nombre d’extraits d’œuvres connues ou moins connues, permettant au lecteur (spécialiste ou non), non seulement de se replonger dans l’Antiquité, mais encore de l’apprécier et de la comprendre en dehors du seul fantasme sanguinaire qui nourrit l’imaginaire collectif. C’est à la fois à un voyage textuel et à une « revisitation » conceptuelle que nous invitent deux auteures dont la démarche d’explicitation et de déconstruction apporte un regard neuf sur les crimes et les sentiments en Grèce et à Rome.
Franck Colotte
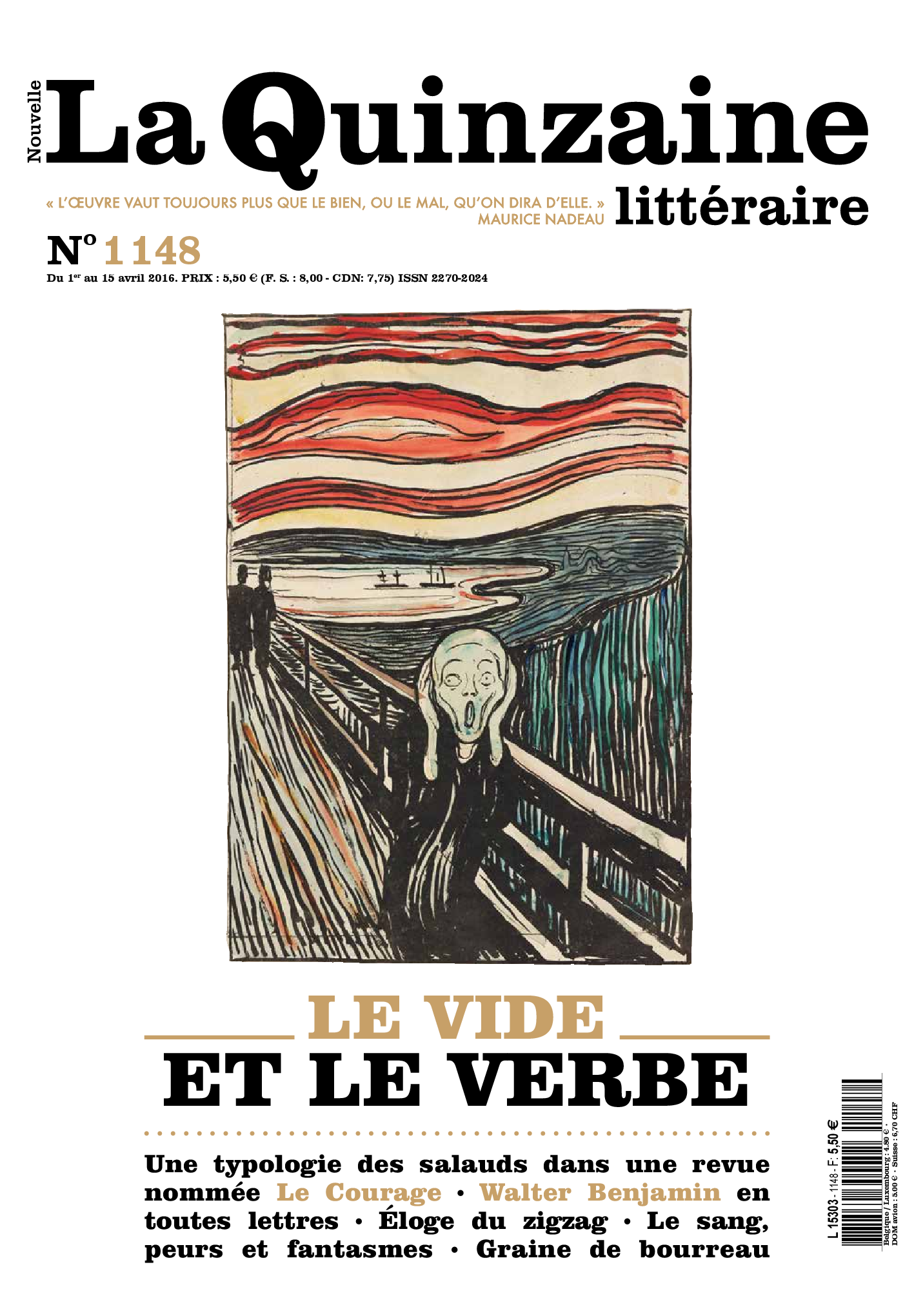

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)