Pour Didier Epelbaum, qui se concentre lui aussi sur ceux qui sont en bout de ligne, on a surenchéri sur ce thème de la banalité du bourreau, au risque de dédouaner les tueurs, ou plutôt de les désingulariser (concept moins moral, plus heuristique), d’en faire les victimes de techniques d’embrigadement et de « circonstances exceptionnelles ». Or, dit Epelbaum, prudent et respectueux des théories qu’il critique, il est essentiel de séparer les victimes des bourreaux, même s’il existe une « zone grise » (exemple de certains kapos ou de Rwandais qui ont à la fois protégé des Tutsi et participé au massacre).
En revenant sur le génocide des Arméniens, la Shoah, le Cambodge de Pol Pot, le Rwanda du Hutu Power, et à travers des exemples en ex-Yougoslavie, Didier Epelbaum, qui ne cache pas son souhait de se rassurer si possible sur l’humanité (sincérité de l’historien qui n’en est pas moins un individu), conteste la théorie du bourreau vu comme une « page blanche » dont les manipulateurs réécrivent le contenu. Ces réflexions peuvent s’appliquer aussi à ce qui se passe aujourd’hui en Syrie et en Irak.
C’est bien au terme d’un processus de sélection, articulé au dressage certes, que les bourreaux deviennent bourreaux. On ne saurait donc les qualifier d’hommes ordinaires. Nous ne pouvons pas tous devenir des bourreaux. Ni d’ailleurs des archanges de la Justice.
Un génocide est toujours dirigé par une « élite » génocidaire. Celle-ci n’a rien de banal. Hitler ne l’est pas. Les chefs génocidaires deviennent ce qu’ils sont au terme d’une vaste préparation idéologique. Les chefs hutu ont mûri leur projet sous l’influence de la société coloniale, très tôt. Au « sommet de la pyramide », on trouve plutôt de l’« extraordinaire ». Les génocides ont été pilotés par des cercles restreints, à la tête de ce qu’Epelbaum nomme une « cidocratie », c’est-à-dire un système ad hoc tourné vers le projet génocidaire, reposant sur une idéologie fanatisée. La direction des Jeunes Turcs, à l’origine du génocide arménien, est un groupe d’une quarantaine de membres. Au Cambodge, neuf personnes détiennent l’autorité absolue.
De trois cent à quatre cent mille personnes ont directement participé à l’extermination des Juifs européens. Au Cambodge, on évalue le nombre des génocidaires à cent cinquante mille. Mais ces chiffres sont sujets à caution.
Les mentors s’appuient sur des « viviers génocidaires », seconde strate très marquée idéologiquement. Là non plus, on ne trouve pas des hommes « ordinaires », comme le montrent les portraits. Ces chefs créent des troupes de choc. Leur première caractéristique est la masculinité, sauf cas minoritaires.
Les bourreaux sont-ils nombreux ? En valeur absolue, il me semble que oui, mais Epelbaum parle en pourcentage de la population, et relativise cet aspect massif. Il souligne que, pour tuer des civils, nul n’est besoin de masses de tueurs. C’est une clé importante, car s’il suffit de peu d’assassins alors on peut s’appuyer sur les volontaires.
Il a été maintes fois constaté que pendant la Shoah des soldats reculaient devant le travail de massacre. On les remplaçait et on ne les sanctionnait pas. Il était admis que c’était un travail pénible. Aussi ceux qui l’effectuaient étaient-ils surtout des volontaires, oscillant entre le sadisme et l’indifférence à la tâche. En réalité, il n’y avait pas grand risque pour un soldat ou un SS allemand à demander une réaffectation. Les officiers étaient compréhensifs. Dans d’autres contextes, ce fut différent, comme au Cambodge où on payait de sa vie l’absence de zèle. Mais les massacreurs créent toujours leur pointe avancée.
Les bourreaux sont jeunes. C’est une constante. Parfois très jeunes. Ils sont sélectionnés sur leur aptitude à la violence, qu’on teste très vite en leur donnant des armes. La capacité à exercer la violence doit aller de pair avec la faculté d’obéissance absolue et l’esprit de sacrifice. Le génocide avance par une sorte d’auto-sélection. Le viol est une composante essentielle du génocide, dans sa dimension de « purification ethnique ». Ce n’est pas un « à- côté » du génocide, mais un outil de destruction de la communauté visée. Le goût du viol est-il si ordinaire ?
Les bourreaux sont cependant différents dans leur absence de banalité. Ils sont parfois sélectionnés, dans la SS, comme élite. Au Cambodge, on place des illettrés à des postes de commandement. Les projets génocidaires ont aussi utilisé des tueurs qu’on exfiltra de prison : ce fut le cas en Turquie, au Rwanda.
Le massacre est planifié. Même dans le cas du Rwanda, Epelbaum ne croit pas à un génocide populaire spontané. Si les Hutu ont été fortement mobilisés, magnétisés par la promesse des terres et des biens des Tutsi, beaucoup se sont contentés de « boucler » les territoires, sans tuer. Les massacreurs étaient, là aussi, volontaires.
Psychologiquement, les différents procès montrent des points communs entre les tueurs, qui ne relèvent pas de psychoses – mais manifestent une incapacité à l’empathie, et même à ressentir la souffrance, y compris la leur. Ils ont une propension au simplisme (« nous et les autres »), détonnent par leur absence de remords, et instaurent des clivages de personnalité. Le tueur d’enfants cruel est possiblement un excellent papa. Un point clé est la mono-appartenance. Le danger réside dans l’identité exclusive, clôturée.
Si les bourreaux sont ordinaires, alors pourquoi les « justes » sont-ils si nombreux ? Car ils le sont. Si une partie importante des Juifs d’Europe a survécu, c’est grâce à la solidarité des peuples, par exemple en Pologne, pourtant caractérisée comme le pays antisémite par excellence. L’empathie a même conduit des antisémites à protéger des juifs (j’ai souvenir de ce film, Le Vieil Homme et l’Enfant, avec Michel Simon). Et si les gens bienveillants étaient finalement plus ordinaires que les bourreaux ? Le peuple arménien a pu échapper à l’extermination totale en trouvant refuge dans d’autres communautés.
Au terme de ce livre, qui s’interroge abondamment sur le mystère de la violence extrême, inimaginable, comme le cannibalisme au Cambodge, on se dit que l’humain porte en lui un éventail inouï. Hitler et Martin Luther King sont de la même époque. Chaque être humain est sans doute d’une grande plasticité. Mais nous ne sommes pas égaux devant la cruauté. Beaucoup savent au fond d’eux, sans aucun doute possible, qu’ils ne pourraient tout simplement pas commettre certaines exactions et rester vivants. Le talent sinistre des génocideurs est de dénicher les personnalités aptes à glisser dans leur projet, et de se servir des leviers pour les radicaliser. À ces compétences odieuses la civilisation doit opposer le désir, tout aussi possible, d’éduquer des humains tournés vers la vie, la beauté, la solidarité. Cette lutte est indécise. Car, au sein même des phases génocidaires les plus intenses, les exemples montrent que la bienveillance survit. Elle est donc indestructible.
Finalement, on en revient à un souci de définition du sujet posé. Qu’est-ce qu’un homme ordinaire ? L’humain, en tout cas, cet être conscient de lui-même, capable de massacrer ses semblables au nom d’« idées » ou de besoins secondaires, n’a rien de banal. Aucun de nous, sans doute, n’est ordinaire. Ni les saints, ni les bourreaux, ni le Monsieur William de Léo Ferré, employé modèle qui un jour se détourne de sa route pour son malheur. C’est la condition humaine qui nous rend, dans un sens non normatif, « extraordinaires ». Indécis, paradoxaux, imprévisibles.
Jérôme Bonnemaison
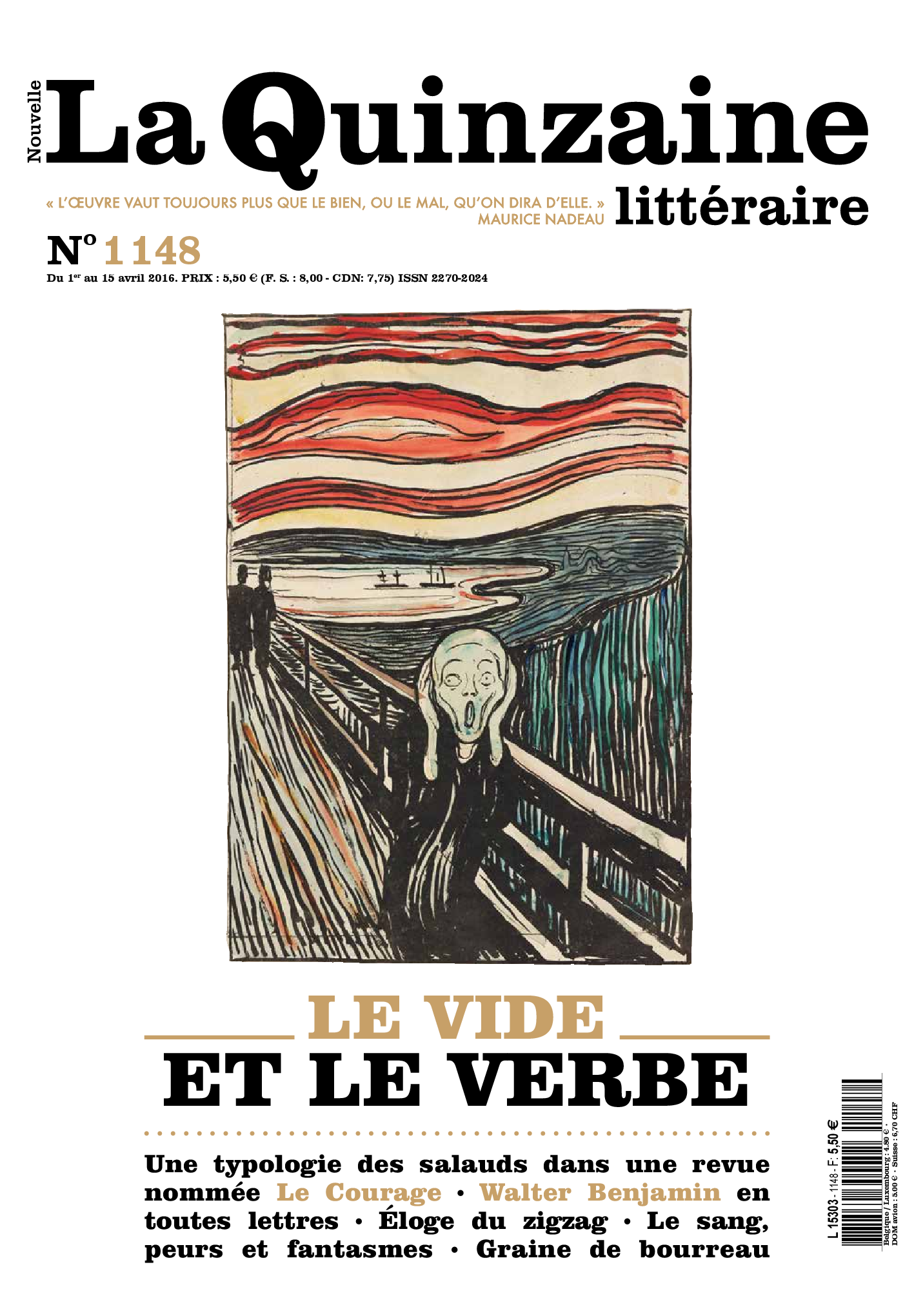

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)