Sabine Haupt vient de prendre sa retraite de l’université de Fribourg où, pendant vingt ans, elle a animé le dispositif d’enseignement de la littérature comparée. Elle vit près de Lausanne dans une maison bâtie à la fin du XXᵉ siècle de façon à susciter chez celles et ceux qui la visitent l’impression qu’elle est plus ancienne. Cette Allemande (née à Giessen) est arrivée en Suisse par amour pour un Genevois rencontré en Israël dans un kibboutz, un être fragile, en délicatesse avec la société, qui n’était pas en mesure de s’installer durablement à Munich, de s’y intégrer et d’y travailler. Elle était très jeune (tout juste la vingtaine), sans argent, dans l’impossibilité de bénéficier du soutien des siens ; elle avait à apprendre le français, à terminer ses études et à opter pour un métier ; et de surcroît elle attendait un enfant de ce garçon pour lequel elle nourrissait l’espoir d’une rédemption par l’amour. Elle confie volontiers que sa mentalité et son caractère procèdent probablement en partie de ces années : comme les émigrés qui endurent des situations pénibles sans trop broncher, parce qu’ils s’accommodent de leurs peines et des opprobres qu’on leur inflige en pensant à leur progéniture, elle-même a œuvré pour la génération d’après. Dans ses propos et ses non-dits, on devine que Sabine Haupt a toujours eu le souci d’arrêter ses décisions et de concevoir son existence avec responsabilité et générosité, en fonction de ses attachements sentimentaux, et d’abord vis-à-vis de ses deux filles (elles n’ont pas le même père). Cette germanophone (depuis des lunes parfaitement bilingue) est portée par une énergie folle : toutes celles et tous ceux qui, à l’université, au sein du champ littéraire suisse, dans la Cité (pendant quelque temps, elle a été élue écologiste au Grand Conseil de Genève), l’ont une fois rencontrée, tous conservent et cultivent d’elle cette image, celle d’une battante, attentive aux sollicitations, au désarroi, à la détresse des autres ; une personne à l’écoute, qui ne baisse jamais les bras ; et qui, sans tergiverser ni indéfiniment douter, sait mobiliser de prodigieuses ressources psychiques afin d’atteindre les objectifs sociaux et personnels qu’elle s’est fixés, et surmonter les obstacles professionnels, les difficultés du quotidien et les déboires de santé – elle s’estime miraculée : les femmes de sa famille meurent d’un cancer (il en a été ainsi pour sa mère et sa sœur cadette) et elle-même en a jugulé deux…
Récemment, son opiniâtreté a fait merveille quand, siégeant au conseil directeur du DeutschSchweizer PEN Zentrum (le DSPZ, le Centre Pen suisse-allemand affilié au Pen international), elle s’est engagée en faveur de nombreux écrivains, professeurs, intellectuels et défenseurs des droits humains afghans, menacés par le régime, afin qu’ils puissent quitter leur pays avec leurs proches et trouver refuge en Europe, principalement en Suisse, mais aussi en Allemagne, en Espagne et en France (pour trois d’entre eux). Tout a commencé un peu avant août 2021 et le retour des talibans à Kaboul, à la suite de l’appel à l’aide lancé par l’auteur et journaliste Atiq Arvand. Depuis, Sabine Haupt n’a pas ménagé ses efforts : contestation de la décision de la représentation diplomatique suisse à Islamabad, au Pakistan, de rejeter la demande de visa humanitaire d’Arvand et celle de sa compagne, la juriste Shabnam Simia ; entrée en relation avec la direction du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) ; sauvetage de ces derniers ; constitution avec eux d’une liste de cent Afghans à soutenir de manière analogue ; plusieurs recours devant le Tribunal Administratif fédéral (TAF) ; une action d’information et de sensibilisation continue des membres du PEN et aussi de ses collègues universitaires et de l’opinion publique (une lettre ouverte réunissant une vingtaine de signatures alémaniques de renom a été envoyée au SEM) ; une étroite collaboration avec l’association AsyLex ; la collecte des fonds pour l’achat des billets d’avion et le premier hébergement dont ont besoin celles et ceux qu’il s’agit de Suisse soustraire aux menaces du gouvernement fondamentaliste, etc. Aujourd’hui, Sabine Haupt est heureuse d’avoir permis à quatre-vingt-dix Afghans de se mettre ainsi à l’abri, loin des persécutions et des périls qu’ils auraient encourus s’ils n’avaient pas fui le pouvoir fondamentaliste.
Il n’est pas impossible que, cette ténacité, Sabine Haupt la doive aux circonstances dans lesquelles elle a grandi. En plus d’un des effets directs des conditions ayant présidé à sa construction en tant que sujet adulte, ne découlerait-elle pas aussi de l’état d’esprit qui prévalait dans la jeunesse allemande autour de 1968 et dans la décennie qui a suivi ? Sabine Haupt juge avoir été « sauvée » par l’école et l’université de Genève. En effet, le secondaire a constitué un « point fixe » de nature à contrebalancer l’instabilité dont elle souffrait : orpheline à neuf ans, en conflit avec le père, fréquentation de communautés et tocades amoureuses dans l’atmosphère ; et, ensuite, le philosophe Manfred Frank, le germaniste Ulrich Stadler et également Jacques Bouveresse ont changé son rapport aux études (« il y avait d’autres choses plus passionnantes à vivre, or, avec eux, c’est devenu central, j’échappais à la cité d’un quartier périphérique affreux, au quatrième étage d’une HLM, en face d’un centre commercial, anonyme, moche, j’avais un bébé et un mari défaillant, je n’avais pas d’autre choix que de tenir »). Ce parcours éprouvant a vraisemblablement été surdéterminé par la Kollektivschuld qui, entre 1960 et 1980, travaille les Allemands abordant l’âge adulte : ils s’interrogent quant à l’attitude de leurs parents durant le IIIe Reich, au degré de complicité (objective et subjective) de leurs aînés avec le nazisme ; sentant sur eux le poids d’une responsabilité et d’une culpabilité collectives, ils cherchent à réparer, moralement et politiquement, les horreurs et les tragédies dont leurs parents ont été les témoins et parfois les artisans.
Tout au long de sa carrière académique menée avec chaleur et passion, Sabine Haupt ne s’est pas départie d’un désir d’écriture qui l’a habitée dès cinq ans et qui est indissociable du souvenir de sa mère : « Quand j’avais cinq ans, je racontais des histoires. Et ma mère, qui à cette époque était encore en bonne santé, les dactylographiait sur son énorme machine à écrire, une Olympia : elle avait été en effet secrétaire et elle était fascinée par l’imaginaire de sa petite fille. Parfois je dessinais ou je découpais quelque chose dans un journal pour illustrer mon récit. Mon premier rêve, cela a été de devenir écrivaine. Étrangement, il m’est remonté à la conscience il n’y a pas si longtemps… » Ses romans et nouvelles, rédigés en allemand, pâtissent d’un champ littéraire clivé selon la langue d’écriture : faute d’être traduites, ses fictions sont peu lues par les Romands et, chez les Alémaniques, elles sont éloignées des critères (implicites) à partir desquels s’effectuent la légitimation et la célébration d’une production. Sabine Haupt en plaisante : le public auquel ses livres s’adressent est, par leur facture, limité ; elle s’en arrange, sa soupe au pain la satisfait pleinement… Sa maison d’édition, verlag die brotsuppe, est basée à Bienne ; Sabine Haupt, tout autant en révolte maintenant qu’en 1980, est une écrivaine irréconciliée avec le monde.
Jean-Michel Devésa
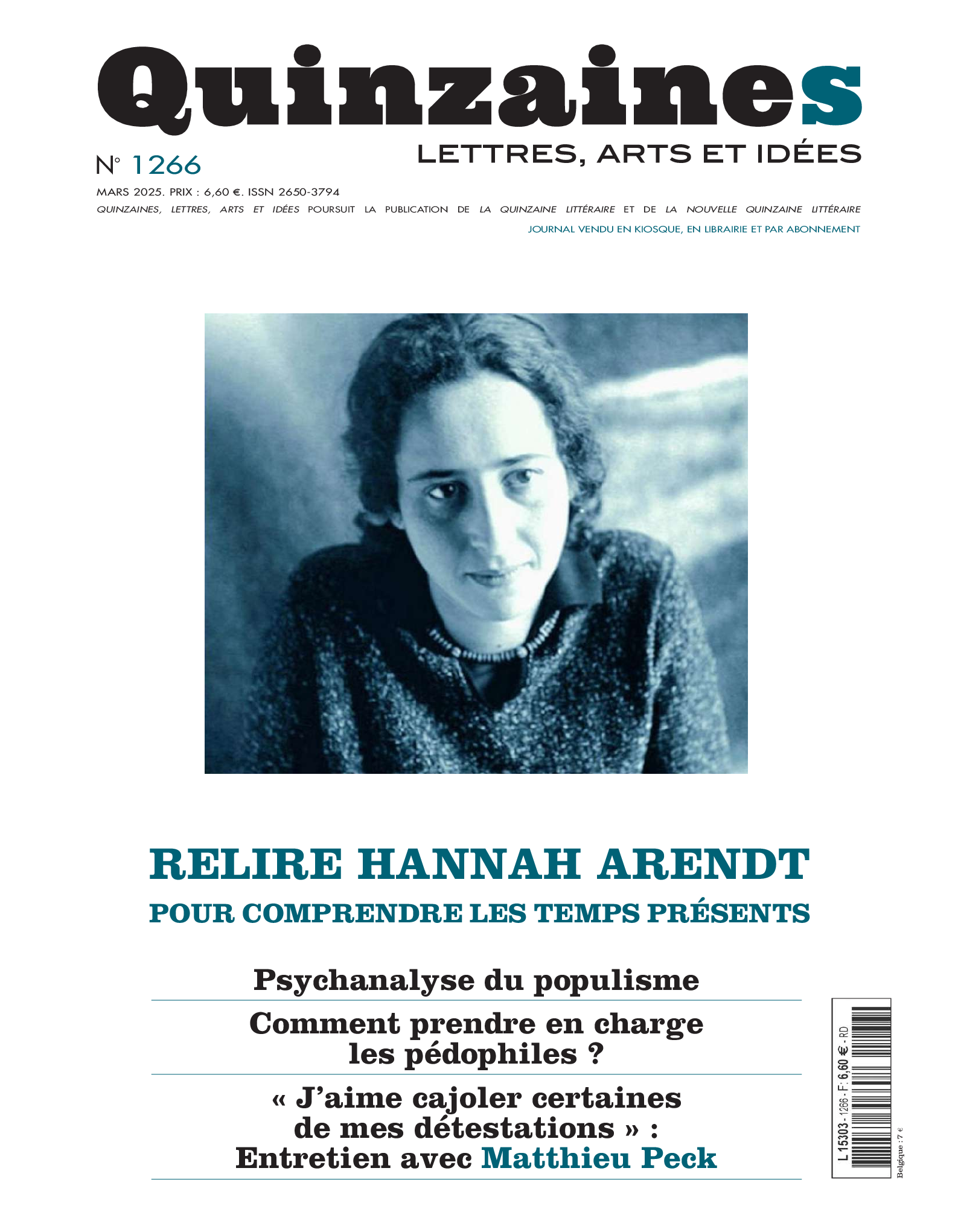
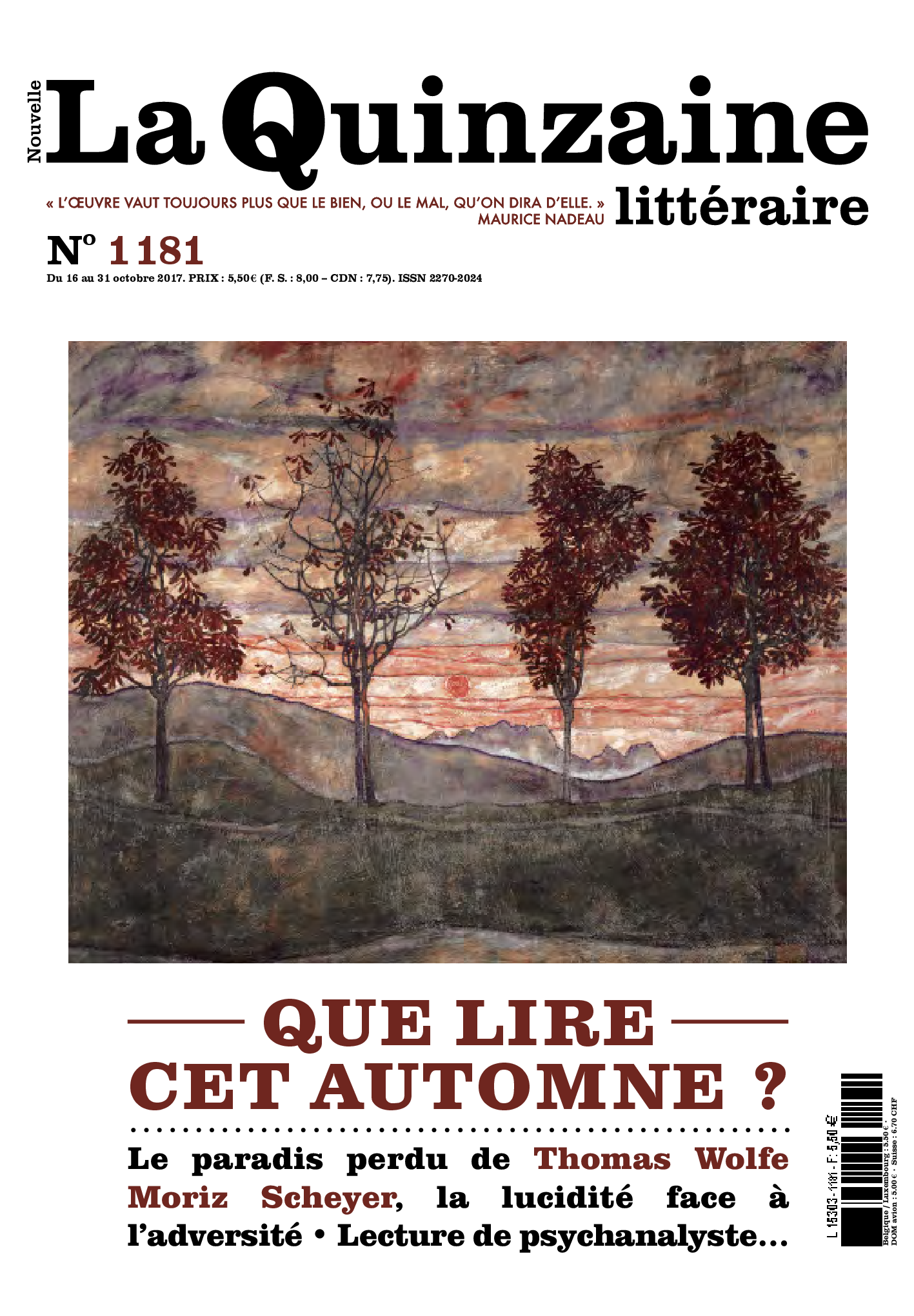
Commentaires (identifiez-vous pour commenter)