Salim Jay, qui en 2005 a publié un stimulant Dictionnaire des écrivains marocains, nous livre, chez Serge Safran, un tout aussi attrayant Dictionnaire des romanciers algériens (sorti au Maroc à l’enseigne de la maison d’édition La Croisée des chemins). L’ouvrage résulte au premier abord d’une fréquentation paradoxale de l’Algérie et de ses lettres, puisque l’auteur avoue n’y avoir séjourné que « quatre jours […] à la faveur d’un Salon du livre », et qu’il est en réalité nourri par une vie de travaux et de rencontres avec des écrivains (Mouloud Mammeri, Kateb Yacine, Mohammed Dib, etc.), certaines des entrées empruntant leur matière à des articles parus il y a une trentaine d’années.
Ce Dictionnaire à l’allure encyclopédique (réunissant des « talents inaperçus » et des figures « canoniques ») n’est pourtant pas une somme. Même s’il adjoint aux romanciers quelques poètes, anthropologues et adeptes du récit de vie et de l’ego-histoire, il a l’intelligence de ne pas prétendre à l’exhaustivité, préférant en outre à la posture de l’observateur neutre et objectif une position moins consensuelle, n’excluant pas de laisser transparaître au détour d’un trait caustique ou d’un bon mot le point de vue d’un spécialiste qui se veut un amoureux de l’écriture et donc un ami de ses sœurs et frères humains.
Cette publication intervient à un moment d’effervescence critique qui, d’une part, tend à actualiser la vision (héritée de Jacques Berque et de l’orientalisme progressiste, de Jean Déjeux, de Charles Bonn, de Guy Dugas, de Christiane Chaulet Achour, etc.) que les lecteurs francophones, et notamment les universitaires, se font de la littérature algérienne, par le biais d’une série de travaux que l’on doit à de jeunes chercheurs s’inspirant de la sociologie (Kaoutar Harchi[1], Tristan Leperlier[2]) ; et qui, d’autre part, accompagne l’essor d’une production qu’on aurait pu craindre, pour son versant en français, au bord de l’épuisement et du tarissement, sous l’effet conjugué d’un régime présidentiel sous perfusion (bien qu’appendice civil d’un puissant appareil d’État militaire) et d’un salafisme qui a dévoyé le mécontentement des couches défavorisées et de la jeunesse, leur face-à-face provoquant une « décennie noire » de guerre civile et d’abominations.
Or il n’en est rien. Malgré ces vicissitudes, la littérature algérienne, notamment romanesque, est florissante.
Ce qui fournit à Salim Jay l’occasion de pointer, dans une courte introduction, l’« efflorescence imprévue du roman algérien » et « sa radicale ouverture au monde », qu’il met en relation avec des remarques de Mohammed Dib expliquant le trouble des commentateurs à son endroit par sa propension à « donner des réponses à des questions qui ne sont pas posées [par l’histoire] ». Tendent à l’attester la quantité de livres publiés, la qualité et l’originalité de beaucoup d’entre eux, l’émergence continuelle d’auteurs qui, d’où qu’ils s’expriment, que ce soit du territoire algérien ou depuis la diaspora, s’essaient non pas à « promouvoir » une Algérie ripolinée aux couleurs de l’autosatisfaction officielle ou de l’aigreur cultivée à l’ombre des minarets, mais à « parler » une Algérie réelle, travaillée par des contradictions qui font qu’elle est toujours en quête de son peuple, celui dont l’histoire n’a pas voulu, puisque, du temps des légionnaires et de la répression coloniale, elle l’a étouffé sous la torture dans les cellules de la villa Sésini et des centres de détention d’Alger et d’El Biar[3], et après l’Indépendance dans les geôles de la prison El Harrach[4], en empêchant l’existence d’une Algérie algérienne rassemblant les différentes communautés présentes sur son sol. Le roman algérien pourrait bien, par conséquent, esquisser un portrait spectral de ce « peuple qui manque », en dépit ou peut-être en raison de ses multiples orientations, en tous les cas grâce à son extraordinaire vitalité.
C’est ce qu’induit l’ouvrage de Salim Jay, qui incite de surcroît à ne pas réduire la littérature algérienne contemporaine aux réalisations « incontestables » de Kamel Daoud et de Boualem Sansal, mais à l’appréhender dans sa diversité.
Il convient d’ajouter que Salim Jay, chaque fois qu’il a le sentiment qu’une « exigence authentique » habite les femmes et les hommes qui « écrivent l’Algérie », indépendamment de la nationalité que leur a conférée leur passeport, leur prête une oreille attentive et dénuée de préjugés, et leur reconnaît volontiers une « algérianité » que leur refusent les discours idéologiques et le cloisonnement habituel de la création littéraire en entités culturelles superposées, sinon « soudées », à des aires géographiques. Aussi son Dictionnaire accorde-t-il une place de choix à Albert Camus, à Hélène Cixous, à Jean-Noël Pancrazi, à Jean Pélégri, à Emmanuel Roblès, à Jean Sénac, à Benjamin Stora et à plusieurs autres.
Nul sentimentalisme larmoyant ne motive cette attitude mais une certitude que Salim Jay (en dépit de ses réserves vis-à-vis du terme de « race ») partage avec Rachid Oulebsir, pour qui « [l’]Algérie n’a jamais été la patrie d’une seule race, une seule langue, une seule religion » (ainsi que celui-ci l’a écrit, dans un article en ligne confié au Matin, le lendemain de la mise en espace d’un texte de Benjamin Stora à Béjaïa, en 2014, par la comédienne Virginie Aimone). Si, en effet, le mouvement des sociétés a « sectorisé » la littérature algérienne (en littératures indigène, coloniale et française) puis l’a réorganisée en une littérature nationale exaltant sa composante arabophone au détriment de la francophone, c’est le même processus qui, tout en livrant la planète et les cultures à la course au profit et à la dévastation, suscite les prémices d’un « monde en commun » dont il incombe aux masses d’accoucher, de part et d’autre de la Méditerranée, si bien que l’intégration au champ littéraire algérien d’auteurs identifiés comme ressortant exclusivement des lettres françaises, en est, avec d’autres signes avant-coureurs, la promesse.
Répertoriant « une offre littéraire arabophone et, désormais, amazighophone, en plus de l’offre francophone, qui tâchent toutes de s’adresser à un public pas nécessairement avide de lecture », Salim Jay cite Jacqueline Kaye et Abdelhamid Zoubir pour se demander à leur suite « quelle eût été la renommée de Kafka s’il avait écrit Le Procès en yiddish ou en tchèque plutôt qu’en allemand[5] ». Toutefois, il ne se résigne pas au constat contenu dans cette question, qu’il nuance immédiatement : « La surabondance des ouvrages écrits en langue française ne doit pas apparaître comme le signe d’une aliénation irrémédiable. » Et de se référer à une fort belle formule du romancier Sadek Aïssat affirmant que Nedjma de Kateb Yacine « est un livre qu[’il aime] parce qu’il paraît écrit en arabe », ou à une autre, de Mohammed Dib, jugeant que Jean Pélégri « a créé à son usage une autre langue française », ce qui suggère que les grandes œuvres du roman algérien francophone sont à trouver du côté d’une pratique « minorée » de la langue et que les réussites de cette littérature (en arabe comme en français) découlent d’une « littérature mineure » (au sens de Gilles Deleuze et Félix Guattari).
Par ailleurs, l’intérêt de son Dictionnaire réside dans une démarche fondée sur la certitude que la vocation littéraire ne peut être que « le produit d’une nécessité intérieure et d’un don spécifique », ce qui d’emblée exclut toute position dogmatique relative à l’emploi de telle langue plutôt que telle autre, et, dans le contexte algérien, équivaut à un manifeste rejetant le mythe (promu par le FLN) des racines arabo-musulmanes du pays au profit d’une vision multiculturelle plus conforme aux réalités.
Salim Jay a tramé son Dictionnaire d’un réseau intertextuel interne ménageant des « passerelles » pour ses lecteurs, les invitant à goûter les écrivain(e)s dont les œuvres, à l’instar de celle de Sadek Aïssat, rendent compte des « étapes d’un tourment intérieur à la mesure d’un tourment collectif », et qui, à la semblance de Jean-Noël Pancrazi, ont vrillé au corps et à l’âme « le désir inflexible de faire amitié avec le monde ». Le parti pris de soutenir les tentatives d’« auscultation sans merci des fractures de la société algérienne » ne lui interdit pas de regretter ce qu’il estime être les exagérations de Rachid Mimouni, de Boualem Sansal et de Leïla Sebbar. De même, si « l’introspection au scalpel » de Nina Bouraoui ne l’effraie pas, son « emphase » et sa « préciosité » n’emportent pas son adhésion. Bref, à celles et ceux qui ont « l’audace de se dire », Salim Jay recommande la mesure. Féroce à l’encontre de Yasmina Khadra (« dont le succès laisse souvent plus que perplexe »), il applaudit en revanche le « tempérament railleur et rebelle » de Mohamed Kacimi, parce que de plain-pied avec lui pour considérer que « le monde se moque de nous, ce qui justifie de s’en moquer ».
Quoique saluant chaleureusement Kamel Daoud, « parce qu’il veut se connaître lui-même et comprendre son pays », c’est aux « classiques » de la littérature algérienne que Salim Jay ne mégote pas son admiration : à Mohammed Dib (« [r]omancier du séisme intérieur et collectif », dont l’œuvre rédigée dans la langue de l’autre « loin de [le] rendre Français [l’]a fait plus Algérien »), à Assia Djebar (dont il associe la voix à celle des femmes algériennes qui « cherch[ent] dans les tombeaux ouverts »), à Kateb Yacine (au « ton oraculaire ») et à Mouloud Mammeri (qui « ne séparait pas l’ancestral et l’actuel »), pour ne mentionner qu’eux.
L’érudition et la passion qui ont présidé à l’élaboration de ce Dictionnaire des romanciers algériens font qu’il est appelé à devenir un usuel qu’auront plaisir à consulter les lecteurs désireux de prendre leurs repères avant de se lancer dans l’exploration et l’étude d’un corpus qui résonne, de manière directe ou indirecte, du bruit et de la fureur de ce que Mohammed Dib nommait « [c]e côté du tragique en pleine lumière, ensoleillé », si vivace chez Camus, et qu’il jugeait apte à rapprocher les Algériens « d’une certaine disposition grecque, à l’antique ».
[1]. Kaoutar Harchi, Je n’ai qu’une langue, ce n’est pas la mienne. Des écrivains à l’épreuve, préface de Jean-Louis Fabiani, Pauvert, 2016.
[2]. Tristan Leperlier, Algérie, les écrivains dans la décennie noire, CNRS Éditions, coll. « Culture et société », 2018.
[3]. À cette heure, il est toujours judicieux de renvoyer au bouleversement témoignage d’Henri Alleg, La Question (Minuit, 1958).
[4]. Voir Les Torturés d’El Harrach, préface d’Henri Alleg, introduction de Robert Merle, Minuit, 1966.
[5]. Jacqueline Kaye et Abdelhamid Zoubir, The Ambiguous Compromise: Language, Literature and National Identity in Algeria and Marocco, Routledge, 1990.
[Jean-Michel Devésa est professeur des universités à Limoges et écrivain.]
Jean-Michel Devésa
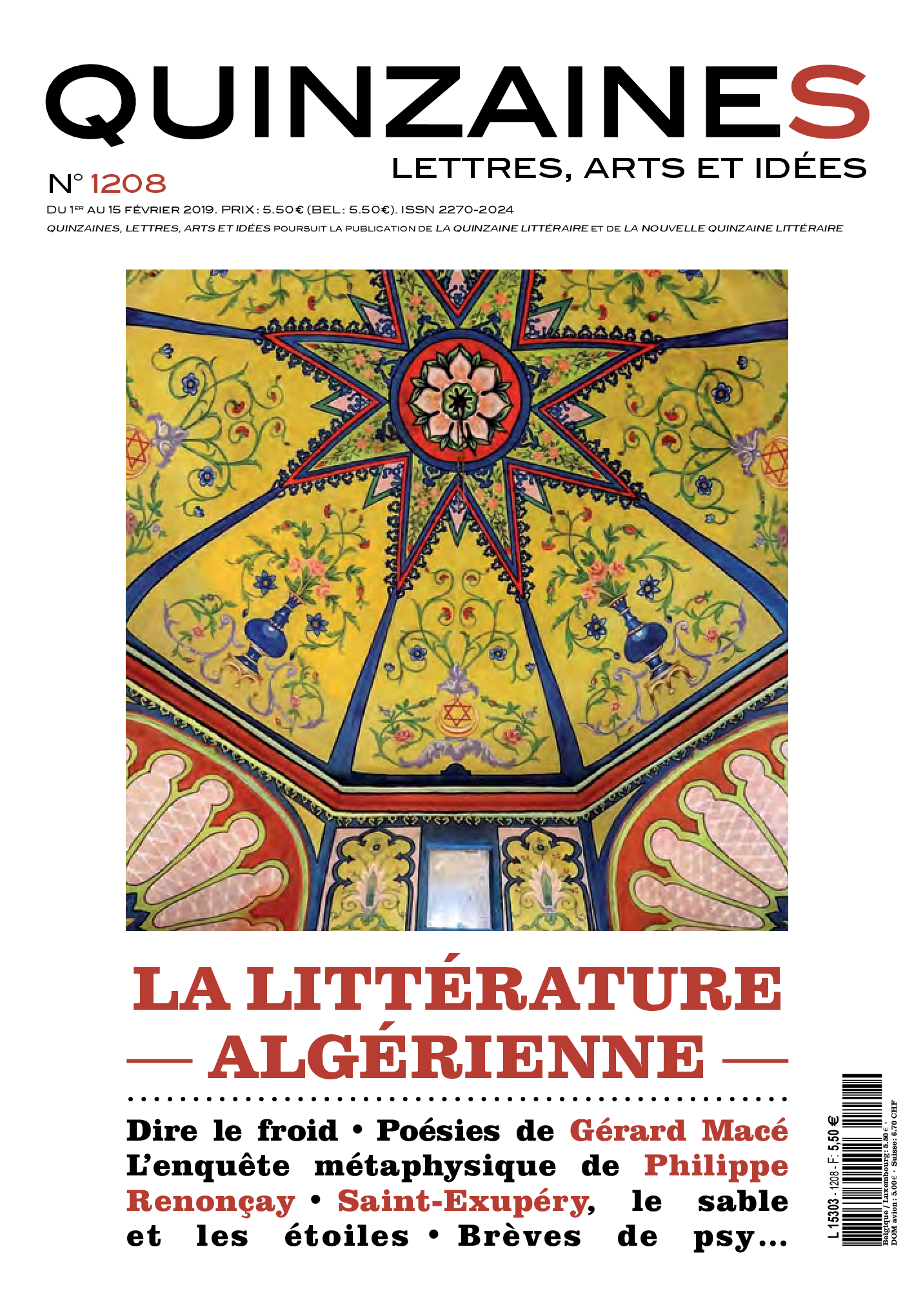

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)