Comme saint Paul, enfin, qui, avant sa conversion, manifeste son zèle pour le judaïsme enseigné par les Pharisiens et rejoint les persécuteurs de Jésus, il a commencé, en 1939, par faire partie d’un groupe « viril et guerrier » affilié au fascisme. En 1943, il rejoint une organisation de jeunes fascistes et devient le rédacteur en chef de leur journal. Mais très vite il se brouille avec le directeur et commence à prendre des distances avec leurs idées politiques.
C’est assez, toutefois, pour que la mauvaise conscience, le doute quant à la pureté des intentions et des engagements fassent désormais partie intégrante de sa personnalité et de sa pensée.
Ce bref rappel biographique nous semble indispensable à la compréhension du personnage de Paul, tel qu’il apparaît dans l’« Ébauche de scénario pour un film, sous forme de notes destinées à un directeur de production », c’est-à-dire pas du tout un saint mais au contraire un homme faillible à tout moment et jusqu’à la fin, mais double, tantôt habité, et uniquement, par sa foi et son zèle vis-à-vis de son idéal, et tantôt perverti par son rôle, capable de sombrer dans les travers et les dérives qui guettent un militant, fondateur d’une église.
Dans sa préface, Alain Badiou écrit que Pier Paolo Pasolini « a fait sienne la dialectique de l’abjection et du sublime » et que saint Paul a été pour lui « une figure tutélaire », « la première incarnation du conflit entre la vérité politique… et le sens qu’elle peut prendre dans la pesanteur du monde ».
Au cours du scénario, Paul, Luc et ses autres compagnons, leurs adversaires tout aussi bien, sont présentés, à première vue, comme des personnages issus d’une iconographie populaire, à gros traits, avec des exagérations, des formules volontairement naïves et simplistes. Ce qui bien sûr est un choix artistique (qu’on se souvienne, entre autres films, du magnifique Uccellacci e uccellini, avec Toto) et ne diminue en rien, comme on le verra, la complexité du propos.
« Paul – avec son visage fanatique de fasciste – prononce ces paroles devant un chef digne de lui : un important gradé ou un puissant bureaucrate qui lui sourit d’un air complice, comme un père stupide et féroce souriant à son fils stupide et féroce. » Il s’agit là de la période qui précède la conversion de Paul. Il n’empêche. Tout au long du scénario, Paul est montré comme un être capable du pire comme du martyre, avec distance, sans empathie, même avec ironie : « L’autocar s’arrête sur une petite place du centre. Paul et Silas, de la démarche inspirée des missionnaires, descendant du véhicule. »
Paul est tantôt le malheureux terrassé par un mal mystérieux, et, à ce moment-là, humble et fragile, tantôt le chef de guerre impitoyable : « À présent Paul a triomphé de son mal. Son visage est normal. Son expression est dure, sûre, autoritaire. On dirait que le Pharisien né dans la loi, la légalité et les privilèges, a soudain remplacé le Paul blessé que nous avions vu chanter durant la nuit. » « Avec le visage dur et sûr des classes dominantes, Paul (lui aussi en complet et cravate) commence un discours qu’il a préparé suivant les règles de la rhétorique. »
(Lors d’une réunion)… « Paul se transforme en organisateur et redevient le Pharisien dur qu’il a été durant sa jeunesse, avec ses yeux sévères et éclatants : non plus le saint mais bien plutôt le prêtre. » C’est l’échec de l’église, l’impossibilité de vivre la pureté d’un engagement, ce qui ne l’empêche pas de mourir en martyr (dans l’hôtel où a été assassiné Martin Luther King), comme Pier Paolo.
De même, ou plutôt avec encore davantage de schématisme, le fonctionnaire, l’homme de police ou de pouvoir a « l’aspect immonde » de celui qui « s’apprête à commettre un acte illégal et répugnant ». Ou encore : « Les prisonniers sont introduits dans le bureau d’un commissaire (ou d’un fonctionnaire du même ordre : de toute façon, un visage odieux, gouvernemental, servile, présentant toutes les caractéristiques pathologiques et repoussantes de la petite-bourgeoisie ignorante, etc.). »
Venons-en à présent à Luc, et à son surprenant personnage, loin de l’hagiographie et des enluminures. Dès le début du scénario, il nous est présenté en suppôt de Satan. Comme dans cette scène « infernale où Satan charge son envoyé de devenir l’incarnation de Luc qui, ayant terminé la rédaction de son Évangile, commence à écrire les Actes des Apôtres (et Satan lui recommande de les écrire dans un style faux, euphémique et officiel) ».
Dans la dernière partie, avant l’assassinat de Paul, Satan rejoint Luc qui « en ricanant, résume pour son chef la suite de l’histoire de Paul. Désormais, le but est pratiquement atteint. L’église est fondée. Le reste ne sera plus qu’une longue agonie… ils dressent une liste très longue des papes criminels, des compromis entre l’église et le pouvoir, d’abus, de violences, de répression, de dogmes. »
Le pur, le saint, le militant, manipulé, a échoué.
Seuls paraissent échapper à la dérive et à la faute les très jeunes gens, le peuple, les malheureux en général (non seulement les pauvres, mais aussi les marginaux, les drogués).
À lire les citations qui précèdent, on voit sans mal que les personnages, les situations, les événements glissent sans cesse d’un temps et d’un lieu à un autre – à plusieurs autres.
Bien que non croyant (mais tout de même italien, c’est-à-dire environné de religion sinon de religiosité), Pier Paolo a le goût de la mythologie chrétienne (Uccellacci e uccellini, L’Évangile selon saint Matthieu, à quoi on doit pouvoir ajouter Théorème), et de la mythologie grecque et latine (Médée), parce qu’elle lui permet (et qu’elle permet à d’autres), à partir d’un invariant (ici le Nouveau Testament), de décrire des époques ultérieures. Saint Paul est à situer à son époque à lui, de 36 à 67 après Jésus-Christ, mais aussi à celle, en France, de l’occupation allemande, et enfin à celle de Pier Paolo adulte : « Le monde dans lequel saint Paul vit et agit, dans notre film, est celui de 1966 ou 1967 », écrit-il dans son introduction.
Toutes les phrases prononcées par Paul sont extraites du Nouveau Testament (L’Évangile selon Luc, les Lettres de Paul, dont chaque fois les références sont données) et adaptables à des événements, des situations contemporaines. Comme par exemple lorsque Paul dit : « Nous devons… accepter… d’être des diplomates habiles et officiels. Nous devons donc accepter de nous taire dans des situations où nous devrions parler, accepter de ne pas faire les choses que nous devrions faire, et même accomplir les actes que nous devrions refuser d’accomplir. »
On constate que le schématisme relevé plus haut, le recours à une imagerie simpliste (qu’on peut trouver aussi chez Brecht) n’altère en rien la profondeur du propos, bien au contraire. C’est que la position de Pier Paolo n’est ni psychologisante, ni sentimentale, ni surtout univoque. Il prête à saint Paul certains de ses propres traits mais ne s’y incarne pas. Mieux. Il les critique, parfois par la bouche d’intellectuels qui assistent à ses réunions et relèvent ses comportements paternalistes et « maternalistes ». Cette profondeur de champ, de sens, vient de l’écriture, de la forme adoptée par Pier Paolo – la brièveté, l’efficacité, jointes à la multiplication des lieux, leur glissement, nous l’avons vu, à d’autres lieux, au mixage des époques, aux transformations des personnages.
Pier Paolo écrit ses scenarii comme des romans et ses romans comme des scenarii, pourrait-on dire abruptement. En réalité, il n’est prisonnier d’aucun genre. Théorème est une merveille de liberté et de poésie. Pétrole, son « roman », est une succession de 133 brefs chapitres intitulés « notes », comme celles de Saint Paul, où le personnage principal, Carlo, ressemble fort à l’apôtre ou à l’industriel, Paul, de Théorème.
On voit que lire Saint Paul ne suffit pas. Il faut aussi se plonger dans Pétrole, mais ceci est une autre histoire. On voit que l’écriture de Pasolini n’est pas exactement « alluvionnaire », à l’intérieur d’un champ précis, comme Lawrence Durrell qualifie la sienne, mais constituée de blocs, qui s’ajoutent à d’autres, lesquels donnent lieu à des incises, des renvois, des échos, etc. Proliférante et (presque) sans limites.
Marie Etienne
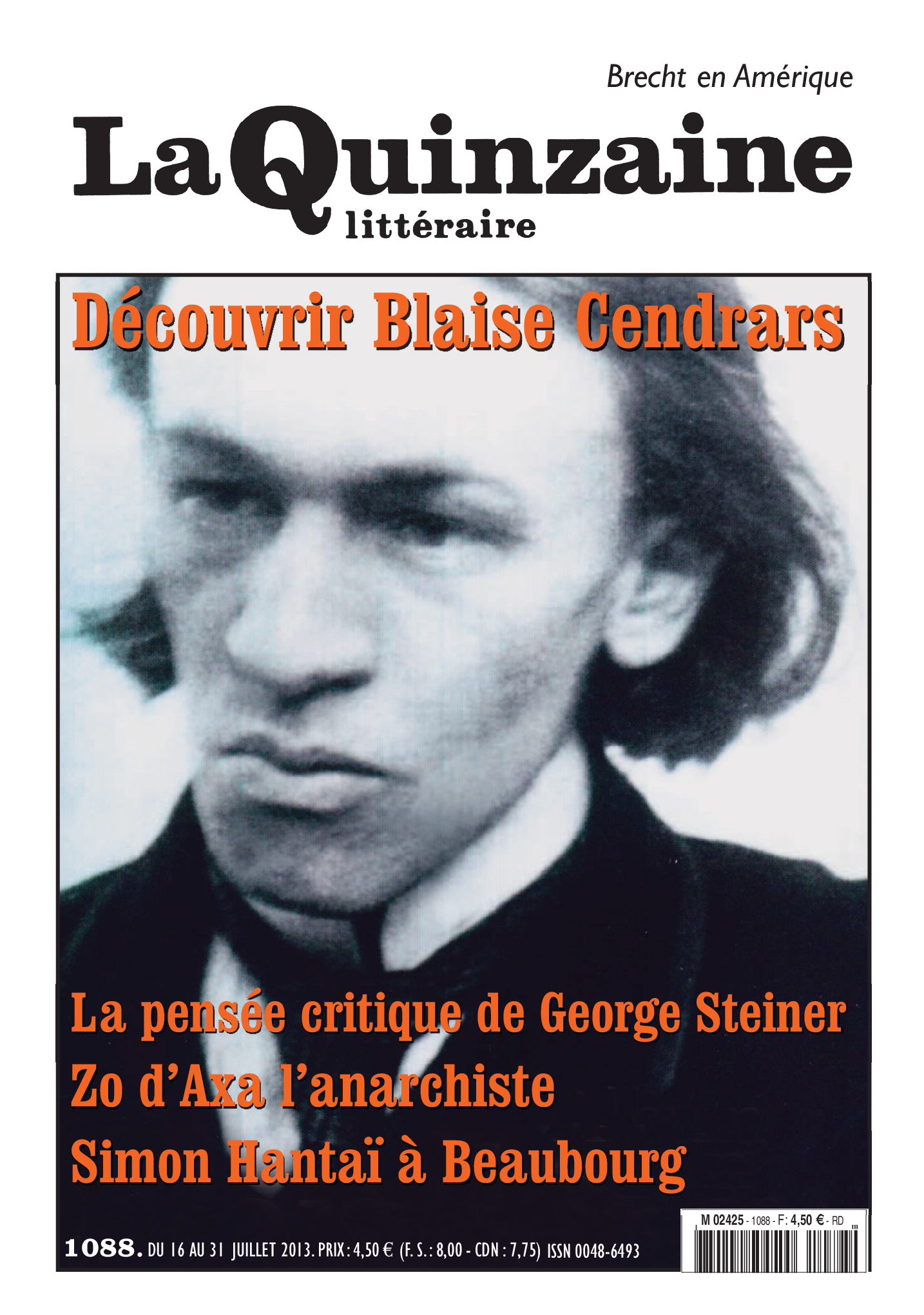

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)