Pourquoi cette réticence qui nous point devant des chiffres aussi enthousiasmants, à la veille d’une cérémonie des Césars qui va comme d’habitude dégouliner de consensus ? Parce que les chiffres ne sont jamais que des chiffres et que le quantitatif n’est pas tout. On n’a pas plus envie de se réjouir devant les tirages de la récente biographie, rédigée collectivement, d’Hemingway, ou du dernier ouvrage de Tatiana de Rosnay, que d’applaudir les millions de fauteuils occupés devant Rien à déclarer ou Largo Winch II, tambouille juste bonne à fournir un peu de fraîche à leurs producteurs et distributeurs. Les films qui, pour nous, laisseront trace cette année – Poetry (Lee Chang-dong), Carlos (Olivier Assayas), Les Mystères de Lisbonne (Raul Ruiz), Another Year (Mike Leigh), Bright Star (Jane Campion) – ont fait, ensemble, moins d’entrées que Des hommes et des dieux (Xavier Beauvois) ou Potiche (François Ozon) qui ne sont pas tout à fait les pires films de 2010, mais dont on ne peut pas dire qu’ils nous aient emportés vers des rivages inattendus. L’embellie économique ne nous concerne que si elle se traduit par des éclaircies qualitatives : aux dernières nouvelles, malgré quelques signes encourageants (Le Nom des gens, de Michel Leclère, a trouvé son public, Angèle et Tony, d’Alix Delaporte, n’a pas disparu tout de suite), les films du milieu ont toujours autant de mal à se monter. Certes, Resnais vient de commencer un tournage, mais si l’on jette un regard sur les derniers films sortis, on adhère à la déclaration d’Emmanuelle Devos dans Le Monde Magazine (19/02/11) : « Je n’ai pas vu un seul film français récemment où je me sois dit : “J’aurais adoré jouer ça…” Pas un ! » Mais l’horizon cannois va bientôt se dégager du brouillard et offrir une idée plus nette de l’état des lieux.
La Cinémathèque française a choisi de travailler dans le marbre, et après une rétrospective Eisenstein, une rétrospective Hitchcock, nous mijote une rétrospective Kubrick. On regimberait devant des menus aussi chargés en calories et pauvres en découvertes, si, entre deux programmations archiconvenues, elle ne nous ménageait des parenthèses plus appétissantes : il en fut ainsi de l’hommage à Koji Wakamatsu de la fin d’automne, et de celui à Jacques Baratier qui a couvert tout février. On respire là à des hauteurs plus humaines, qui donnent certes moins à penser, mais ouvrent des perspectives un peu plus neuves que le ressassement infini des mêmes thèses – on frémit d’avance de ce qu’il va nous falloir ingurgiter durant la saison Kubrick.
Il était temps que l’institution s’intéresse à Baratier ; sa filmographie, inaugurée à la fin des années 40, était achevée depuis 2002 (il n’a pu réussir à mener à bien les projets qu’il persistait à entretenir). On aurait sans doute pu s’occuper plus tôt de lui rendre hommage, avant qu’il ne disparaisse en novembre 2009. Ce qui aurait permis de constater que cet étonnant personnage avait une œuvre derrière lui, rare (neuf longs métrages exploités en cinquante ans), confidentielle (sept copies pour son ultime Rien voilà l’ordre), éparpillée (des films bricolés hors système, cent fois remis sur la table de montage, comme ses multiples versions de Désordre), jamais totalement satisfaisante – mais jamais indifférente. Un marginal comme on les aime, le sel de la terre, à la Jean Dewever ou à la Jacques Rozier, aux productions biscornues, objets mal ébarbés dont le plaisir bancal qu’ils procurent est plus intense que tant de produits calibrés – des pattes de loup contre des goldens, les croqueurs de pommes comprendront. Cinéaste inclassable : aucun de ses films ne ressemblait au précédent, ce qui interdisait tout étiquettage ; et plus précisément, ils ne ressemblaient à rien de ce qui se faisait parallèlement, excepté L’Or du duc, sa seule incursion, en 1965, dans le cinéma « normal » – il sut y utiliser Claude Rich, Pierre Brasseur et Danielle Darrieux aussi bien qu’un autre –, incursion non renouvelée, la production classique le gênant trop aux entournures. Le film suivant, Piège (1968), happening de 50 minutes improvisé par Bulle Ogier et Bernadette Lafont dans une demeure inhabitée, correspondait mieux à son désir d’un cinéma surprenant, lui-même étant son premier spectateur.
Il avait pourtant commencé avec les honneurs, puisque son Goha, premier film tourné en Tunisie indépendante, décrocha à Cannes 1958 un prix spécial « pour son originalité poétique et la qualité exceptionnelle du commentaire et des dialogues de Georges Schéhadé » — Baratier savait s’entourer. Homme d’amitié, ses amis étaient de qualité : on les voit défiler dans Désordre, court métrage tourné en 1947, dans lequel passe tout Saint-Germain-des-Prés, Vian et sa trompinette, les existentialistes du temps, Gabriel Pomerand et Orson Welles. Le film fut son grand œuvre : il le reprit en 1967, en fit un long métrage, Le Désordre à vingt ans, augmenté de témoignages en miroir, y travailla encore jusqu’à en faire le sujet de son dernier film, inachevé, Le Beau Désordre (2009). Quelle qu’en soit la version, Désordre est un document remarquable, sans doute le plus juste sur le lieu et le moment, saisis dans leur fraîcheur native. Entre le Flore et le Lorientais, Baratier avait bien connu Audiberti : il le convainquit de faire de son roman La Poupée un scénario, réalisé en 1962, film politique à la Audiberti, c’est-à-dire explosant dans toutes les directions, grinçant, baroque, boursouflé et parcouru d’éclairs poétiques de forte intensité. Servi par une distribution en forme de collage, Zbigniew Cybulski le Polonais, Claudio Gora l’Italien, Sonne Teal le Belge transsexuel, Daniel Emilfork, Sacha Pitoëff et Jacques Dufilho, La Poupée est un de ces météores que le cinéma du début des années 60 était capable de voir surgir, et qui conserve, après cinq décennies, toute son étrangeté, bel exemple de cette « poésie de cinéma » que Cocteau, inventeur du terme, a si vainement traqué.
Politique également, La Ville-bidon (1974, seul titre disponible en DVD, chez Doriane films), et son député-maire détruisant un bidonville pour bâtir une ville nouvelle – politique à la Mocky, en forme de jeu de massacre. De nouveau un bricolage, construit à partir d’un court de 1970, La Décharge, et première apparition des monstrueux immeubles-« choux » de Créteil (on les reverra dans La Dernière Femme de Ferreri). Si l’aspect dénonciateur a forcément vieilli, la description du petit monde des marginaux du bidonville demeure intacte ; Baratier était de plain-pied avec cet univers : il avait déjà filmé dans les baraquements algériens de Nanterre une partie de La Poupée (les manifestations du peuple sud-américain, puissance de l’illusion) (1).
Le goût de l’univers clos, on le retrouvera dans le pensionnat de jeunes filles de L’Araignée de satin (1984) et dans Rien voilà l’ordre (titre tiré d’un poème d’Olivier Larronde), et sa clinique psychiatrique – ce devait être la Borde, ce fut les Prémontrés. Le film, sorti fin juin 2004, ne rencontra qu’indifférence – le nom de Baratier n’évoquait rien pour le public et pas grand-chose pour la jeune critique. Revu en 2011, il brille des mêmes éclats intermittents que les précédents : les acteurs (Claude Rich, Laurent Terzieff, James Thierrée, Amira Casar) se distinguent à peine des vrais patients, jamais on ne ressent ce malaise du « faire semblant », fréquent devant la représentation de la folie à l’écran. En deux projections à Bercy, le film a compté plus de spectateurs que lors de sa sortie – de la même manière que la soirée Baratier présentée sur la chaîne CinéCinéma Classic a rassemblé plus d’audience que tous ses titres réunis. Désordre et dérangement, c’est sous ce double signe qu’il avait placé son œuvre, une œuvre flottante, hors du temps, jamais achevée. Il est rassurant de constater qu’elle peut encore trouver un écho.
1. Grâce à l’amitié de Kateb Yacine, ainsi que nous l’apprend l’excellent documentaire Portrait de mon père, réalisé par sa fille Diane.
Lucien Logette
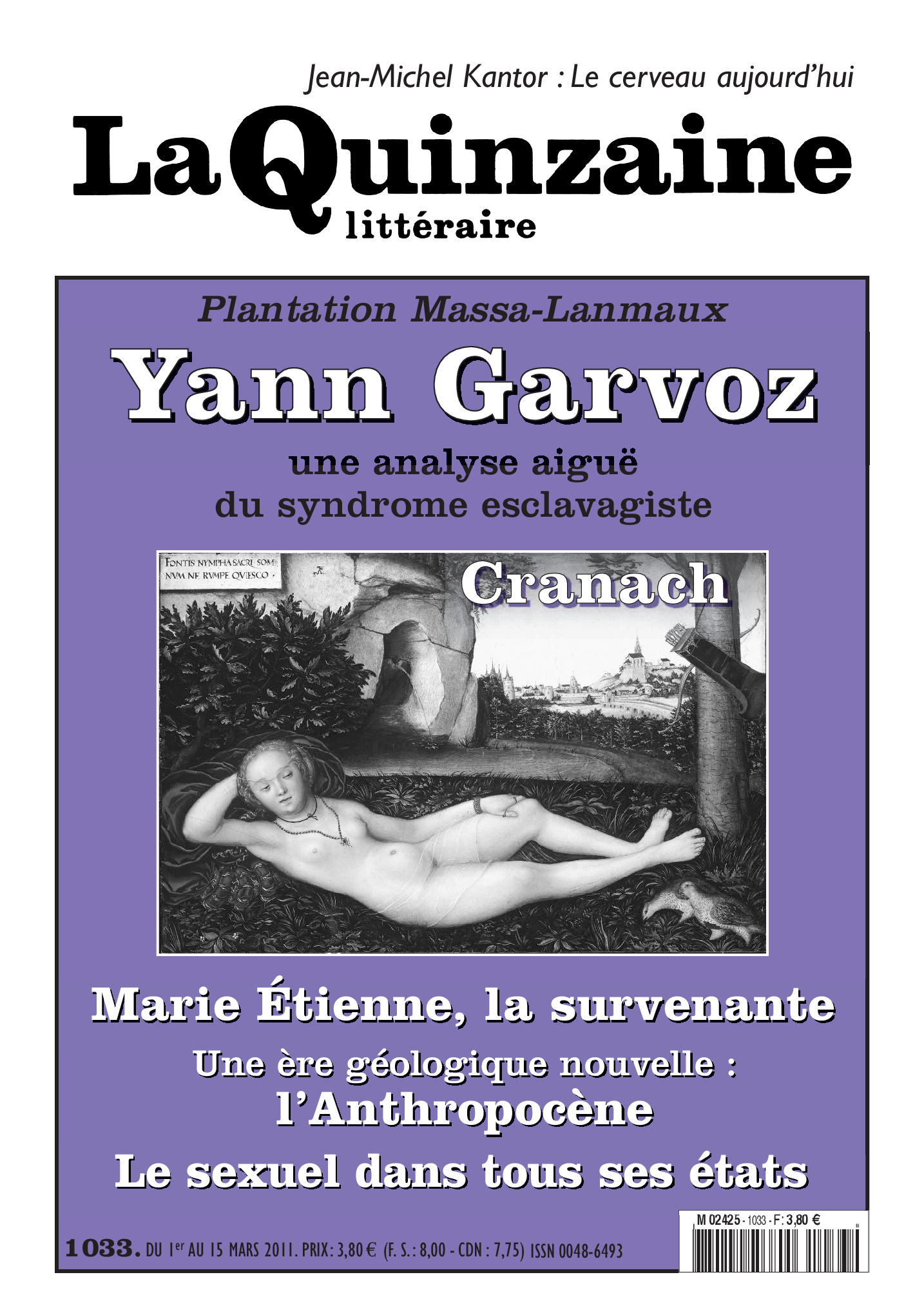

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)