Carol Reed possède un lourd handicap, celui d’être l’auteur d’un film qui, comme l’arbre la forêt, cache sa filmographie. Le Troisième Homme est répertorié dans toutes les histoires du cinéma, même les plus hâtives, et c’est justice, tant la fascination ambiguë sécrétée par Orson Welles y est plus qu’ailleurs sensible – et ce, malgré Anton Karas et son thème de cithare à scier les neurones. Mais derrière cette vitrine difficilement oubliable, que recèlent les rayons d’un magasin qu’on ne songe plus guère à visiter ?
Beaucoup de choses passionnantes, comme le prouve cet échantillon de titres peu connus. Si ses dernières productions, L’Extase et l’Agonie (1965), L’Indien (1970) pèsent lourd (dans le mauvais sens du terme), Reed, avant d’être sir Carol – il fut le premier cinéaste à être anobli, en 1953 -, avait signé une ribambelle de films tout à fait dignes d’intérêt : en tout, dix-huit longs métrages, entre 1936 et The Third Man (1949). De quoi alimenter la curiosité de ceux qui savent, malgré Godard, (2) que le cinéma anglais est une source de satisfaction soutenue.
Parmi les quatre films édités aujourd’hui par Elephant Films (déjà responsable, il y a peu, des rééditions Korda), Huit heures de sursis/Odd Man Out (1947) possède une certaine réputation, pour avoir longtemps fait les bonnes heures des ciné-clubs et constitué la première apparition dans un «grand» film de James Mason. Un James Mason remarquable – mais quand ne le fut-il pas ? -, en militant de l’IRA, blessé après un braquage, traqué par la police dans les rues de Belfast. Habillé numériquement de neuf, le film a gardé toutes ses qualités, puissance et rythme, servies par une photographie époustouflante (due à Robert Krasker) qui nous rappelle que le noir et le blanc sont les plus belles couleurs du monde. On en oublierait même les quelques cadrages obliques, tics d’époque dont même les meilleurs ne furent pas exempts. L’édition en DVD se doublant d’une sortie en salles (le 20 août), on pourra juger sur un écran non domestique de la pérennité du travail de Reed.
The Third Man, Odd Man Out – ajoutons-y, pour l’assonance, The Man Between (1953) et The Running Man (1963) –, on pourrait penser que l’auteur s’était spécialisé dans les portraits d’individus marginaux, criminels, combattants ou espions, solitaires et coincés. En réalité, Reed était un artisan qui travaillait à façon : rien de commun entre Sous le regard des étoiles (1939), d’après A. J. Cronin, The Young Mr Pitt (1942), biographie du Premier ministre et Première désillusion (1948), d’après Graham Greene, sinon une même réussite dans le traitement des divers sujets, lutte sociale ou psychologie enfantine. Du fait main.
Ces qualités, on les retrouve très tôt dans sa carrière, dans deux des titres retenus par Elephant, Bank Holiday/Week-end (1938) et Climbing High/La Grande Escalade (1938). Le premier est un film choral, genre déjà bien pratiqué à l’époque, qui choisit plusieurs personnages fuyant Londres le temps d’un pont estival pour rejoindre la côte – une infirmière et son fiancé, une famille chargée d’enfants, une candidate à un prix de beauté, mélangés à quelques milliers d’autres Londoniens eux aussi déplacés. Hôtels complets, trottoirs bondés, attractions foraines minables, tout ce monde s’entrecroise sans se connaître, à la poursuite de ses rêves particuliers, l’amour, la réussite, la simple survie, avant de rejoindre la ville.
Au-delà de l’intérêt narratif continu, le film vaut par le témoignage qu’il offre sur le milieu des petits employés anglais, entre Munich et la guerre, et ce qui n’était pas encore une industrie des loisirs : les queues gigantesques pour grimper dans les trains, les chambres prises d’assaut, les plages nocturnes occupées par des centaines de dormeurs, le luxe interdit aux cols blancs. Passe là un air du temps spécifiquement britannique (le même que dans les films d’Humphrey Jennings) – sans guère d’équivalent ailleurs. Et la trop oubliée Margaret Lockwood y promène sa douceur.
Le modèle évident de La Grande Escalade est la comédie du mariage à l’américaine, telle que calibrée au milieu des années trente ; il suffirait de remplacer Michael Redgrave par Cary Grant et Jessie Matthews par Claudette Colbert et on se croirait, sinon chez Hawks ou McCarey, au moins chez Woody Van Dyke ou Garson Kanin. La situation, les tribulations d’un riche sportsman poursuivi par une coureuse de dot, mais amoureux d’une jeune fille pauvre et qui cache son état afin d’être aimé pour lui-même, est un classique, et le film s’appuie sur un schéma éprouvé, donc solide, qui fait passer ses soixante-dix-sept minutes comme rien.
Ce qui est moins éprouvé, c’est la galerie de personnages d’appoint, dont un échappé d’asile passionné d’opéra et qui, sans connaître Pascale Ferran, se prend pour un oiseau et surtout un révolutionnaire aboulique, membre du Parti communiste, qui promet le camp de concentration à sa propriétaire trop exigeante et refuse de travailler pour ne pas engraisser le Capital (et lorsqu’il est engagé, s’écrie : « Lénine, je t’ai trahi ! »). La grande escalade promise ne dure que dix minutes, mais son incongruité est digne de W. C. Fields.
On change de registre avec L’Héroïque Parade/The Way Ahead. 1944, le temps n’est plus à la comédie, même saugrenue. Le cinéma anglais est engagé à plein dans l’effort de guerre – il faut être à contre-courant comme Michael Powell pour tourner Colonel Blimp (1943), avec un officier anglais ridicule et son homologue allemand sympathique – et Carol Reed ne rechigne pas. Il réalise un film exemplaire, qui, à l’encontre de son titre français, n’a rien d’héroïque : une douzaine de personnages, entre 1939 et 1944, enrôlés en 1941 dans un bataillon d’élite, alors qu’ils n’ont pas la fibre guerrière.
Leur motivation défaillante va peu à peu évoluer, selon un schéma devenu habituel dans les films de formation militaires. Mais ce qui pourrait être une succession de clichés se révèle un étonnant trajet initiatique, par la grâce d’une caractérisation sans faille des «héros», chacun saisi avec une rare pénétration : aucun débordement patriotique, aucune grandiloquence, aucune complaisance. C’est sans doute le meilleur scénario du grand Eric Ambler – et un des meilleurs « films de guerre » de la période. Sans triomphalisme : voir le plan final ambigu, les combattants marchant dans la fumée de la mitraille vers une mort probable alors que s’inscrit sur l’écran « The beginning ». On a rarement fait plus simple et plus fort. Longue vie posthume à sir Carol.
- Pourquoi un tel film, qui enfonce à peu près tout ce qui s’est fait depuis le début du siècle dans la catégorie « cinéma social », et dont l’intensité atteint vingt unités-Dardenne, a-t-il dû patienter vingt-huit ans pour obtenir une sortie, en catimini, au creux de l’été ? Comrades est encore visible dans quelques salles, une fois par jour. Félicitons UFO Distribution et l’AFCAE (Art & Essai) d’avoir osé l’exhumation. Tous ceux qui l’ont vu en conserveront la trace, peu effaçable.
- Rappelons sa belle affirmation : « Les Anglais ont fait ce qu’ils font toujours dans le cinéma, rien ».

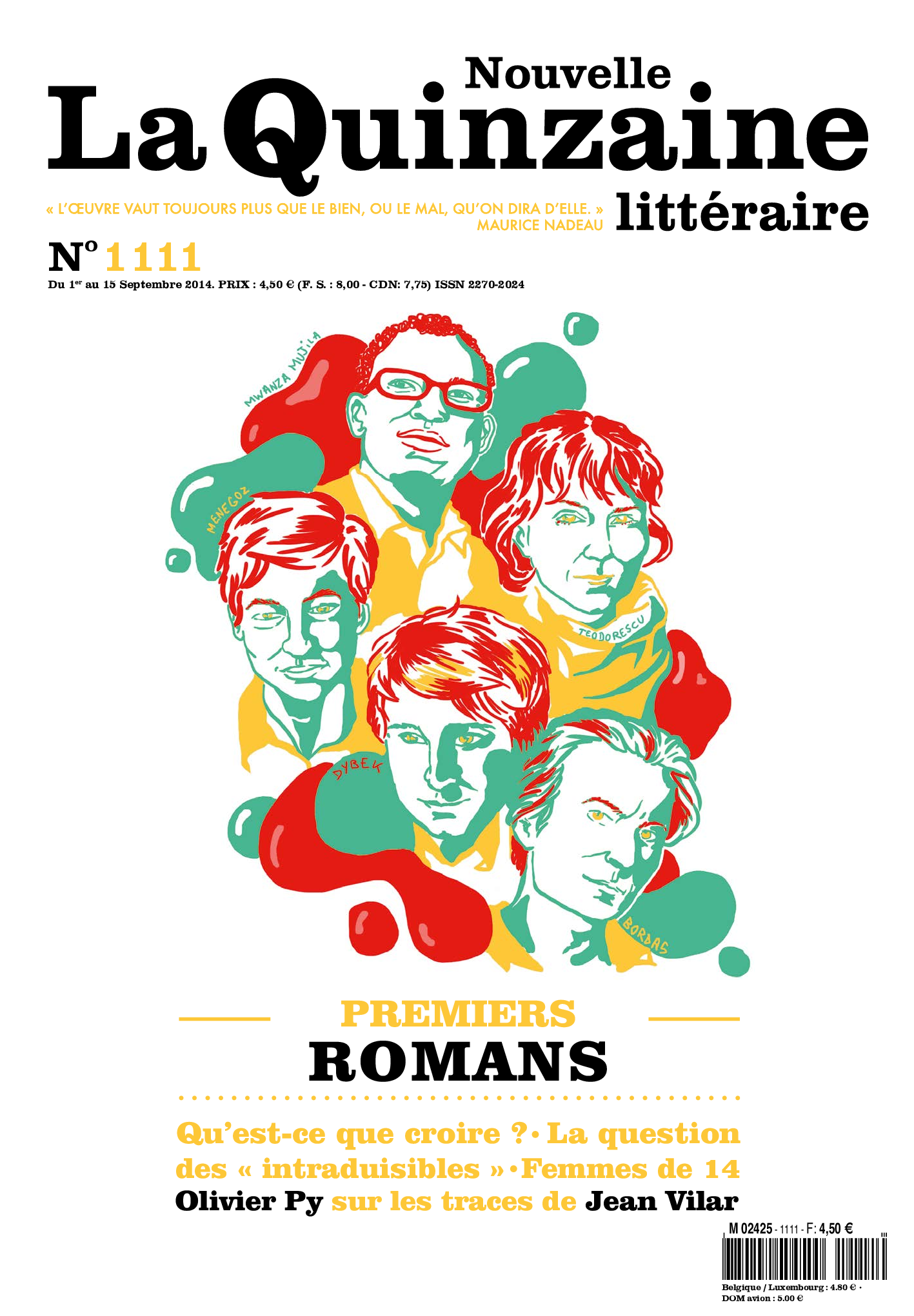

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)