Waterloo est une bataille d’interprétations. Il y a celle du Mémorial de Sainte-Hélène, qui fixa la thèse officielle : Napoléon aurait pu vaincre successivement les Prussiens et les Anglo-Hollandais, si Ney n’avait pas bougé trop tard et surtout si Grouchy n’avait failli à sa mission d’empêcher Blücher de rejoindre Wellington. Il y a celle de Clausewitz, dans sa Campagne de France en 1815, qui disculpe les officiers de « Bonaparte » et soutient que ce dernier avait multiplié les erreurs de commandement. Les inversions sémantiques sont légion en fonction des camps : pour les Français Waterloo est « la bataille de Mont-Saint-Jean », alors que pour les Anglo-Prussiens elle est celle de la « Belle Alliance ». Aujourd’hui encore, le Français qui débarque à Londres peut s’écrier, comme Alphonse Allais : « Chez nous, toutes les rues portent des noms de victoires : Wagram, Austerlitz... Tandis que là-bas : Trafalgar Square, Waterloo Place... Ils n’ont choisi que des noms de défaites ! » Les romantiques, Chateaubriand, Lamartine et Hugo en tête (« Grouchy ! » – C’était Blücher) consacrèrent le mythe, dans le sens napoléonien. Mais qu’il y ait deux points de vue, comme en tout conflit, est chose naturelle. Stendhal inaugura une tout autre approche, qui allait elle aussi symboliser la situation interprétative : Fabrice à Waterloo n’a qu’une vision fragmentée, chaotique et secondaire des événements, comme s’il n’y avait plus rien à interpréter ou comme si toute interprétation ne pouvait que refléter une perspective irréductible aux autres.
La question classique de l’épistémologie des sciences historiques consiste à savoir si celles-ci doivent s’appuyer sur un type d’explication causale ou sur une forme de compréhension herméneutique, ou pour reprendre la division courante depuis Wittgenstein, Anscombe et Davidson, si l’on a affaire à des causes ou à des raisons. Philippe Mongin montre que l’on peut classer l’ouvrage de Clausewitz sur la campagne de 1815 comme un prédécesseur des approches de ce que Weber appellera la rationalité instrumentale et comme un modèle de « récit analytique ». Clausewitz raisonne comme le ferait aujourd’hui un théoricien de la décision en attribuant aux agents des désirs et des croyances et en supposant qu’ils maximisent leur utilité espérée en situation d’incertitude et qu’ils sont des agents rationnels. Quel objectif poursuivait Napoléon en scindant en deux son armée pour en confier une partie à Grouchy ? Il faut aussi, ce que ne fait pas toujours Clausewitz, raisonner en termes de théorie des jeux, et supposer que les agents, ayant atteint un nœud de décision associant un lieu géographique et un adversaire (rencontrer l’ennemi à Quatre-Bras, revenir vers Ligny), optent pour une stratégie donnée. Mongin reconstruit les stratégies en termes de théorie du choix rationnel et il ne se prive pas de faire des reconstructions rétrospectives, à la manière de ce que l’on appelle aujourd’hui le raisonnement contrefactuel en histoire : que se serait-il passé si… ? Si Napoléon n’avait pas envoyé Grouchy à la poursuite des Prussiens ? Si Grouchy était arrivé à temps ?
Tout autre est le Waterloo de Stendhal. Le dialogue-clé est celui de Fabrice et du maréchal des logis : « Monsieur, c’est la première fois que j’assiste à la bataille, mais ceci est-il une véritable bataille ? – Un peu. » En prêtant à son héros ces interrogations, Stendhal manie l’ironie et introduit de la distance entre le sens commun, qui voudrait que les acteurs d’une bataille soient identifiés, que celle-ci ait un début et une fin, et la réalité fragmentaire perçue par son héros. Stendhal est un anti-théoricien des jeux : là où la théorie du choix rationnel découpe les événements en probabilités et conséquences, et les jugements en certains et incertains, le chapitre III de La Chartreuse nous montre un agent qui fait tout sauf maximiser son espérance mathématique.
Il est tentant de voir dans les deux lectures, celle du philosophe de la guerre et celle du romancier, l’opposition entre l’explication rationaliste du récit analytique et la lecture herméneutique et compréhensive. Mais Clausewitz a parfaitement conscience des limites du modèle de la rationalité instrumentale. Il montre que les actions de Napoléon ne sont pas toutes rationnelles et que tout ne se laisse pas prédire par un calcul d’intérêt. On reproche le plus souvent aux modèles du choix rationnel, comme aux conceptions causales en histoire, de gommer la singularité des événements. Mais les deux ne sont pas incompatibles, comme l’a d’ailleurs montré Donald Davidson (3). De son côté Stendhal incarne-t-il le modèle du récit herméneutique dans lequel le narrateur procède par empathie et reconstruit l’« horizon » des significations des divers acteurs ? Pas plus. L’ironie stendhalienne suppose l’empathie de Stendhal pour son héros, mais aussi sa mise à distance (4).
La notion d’interprétation est associée à au moins trois poncifs (bien représentés dans le volume dans lequel paraît l’article de Mongin, notamment dans un article de Barbara Cassin sur la relativité de la traduction) qui composent ce que l’on peut appeler l’interprétationnisme. Le premier est qu’à chaque interprétation correspond un point de vue exclusif des autres. Le deuxième est le relativisme : toutes les interprétations se valent. Le troisième est que, selon le slogan nietzschéo-postmoderne, il n’y a pas de faits, il n’y a que des interprétations. Les lectures clausewitzienne et stendhalienne de Waterloo infirment ces trois poncifs. Tout d’abord il est faux qu’à chaque interprétation corresponde un point de vue. Aussi bien Clausewitz que Stendhal savent se placer de plusieurs points de vue à la fois. En second lieu il est faux que tous les points de vue se vaillent et que le pluralisme interprétatif règne. L’interprétation du Mémorial ne tient pas devant l’historiographie et Stendhal démonte implicitement la lecture romantique de la bataille. Il y a des interprétations meilleures que d’autres, des points de vue plus objectifs que d’autres et si les modèles de la théorie du choix rationnel n’expliquent pas tout, ils permettent de tester des hypothèses. Enfin, le slogan nietzschéen tient-il la route ? L’interprétation est-elle seulement un récit parmi d’autres, le réel s’évanouissant derrière le conflit des interprétations qui le « construisent » ? Il y a certes un mythe de Waterloo, mais Waterloo n’est pas la guerre du Golfe selon Baudrillard : la bataille a eu lieu, et Clausewitz en donne un récit assez fidèle. On peut penser que Stendhal aussi. Certes son but est tout le contraire de celui de la description historique. Il ne vise pas la précision ou le détail, encore moins à faire vrai. Ce qu’il vise est la peinture des émotions humaines, ici celles qui se font jour dans une bataille. Il les décrit d’un certain point de vue, celui de Fabrice, mais ce qu’il décrit n’est pas moins réel. Stendhal aussi pratique l’histoire contrefactuelle : on peut lire tout le récit de Fabrice à Waterloo comme une expérience de pensée : que se passerait-il si on mettait un novice au milieu d’une bataille ? L’expérience de pensée n’est pas seulement œuvre d’imagination : elle peut être aussi au service de la recherche d’hypothèses sur le réel. L’interprétationnisme culmine dans la thèse selon laquelle l’histoire est un récit, tout comme la littérature, et n’est qu’un récit. Rendre à l’histoire et à la littérature leur statut de connaissances, c’est sonner la retraite de l’interprétationnisme et son Waterloo.
- Relayé par un autre « Retour à Waterloo. Histoire militaire et théorie des jeux », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2008, n° 1, 63e année, pp. 39-69.
- On se référera toujours avec profit sur ces sujets au livre d’Alain Boyer L’Explication en Histoire, Presses universitaires de Lille, 1992.
- Actions et événements, Paris, Puf, 1993.
- Voir la belle étude de Patrizia Lombardo, « Tendresse et pudeur chez Stendhal », Philosophiques, vol. 35, n° 1, pp. 57-70.
Philippe Mongin, « Waterloo et les regards croisés de l’interprétation » in Alain Berthoz, Carlo Osola et Brian Stock (dir.), La Pluralité interprétative, fondements historiques et cognitifs de la notion de point de vue, Paris, Collège de France, 2010, 223 p., hors commerce, disponible sur http://conferences-cdf.revues.org.
Pascal Engel
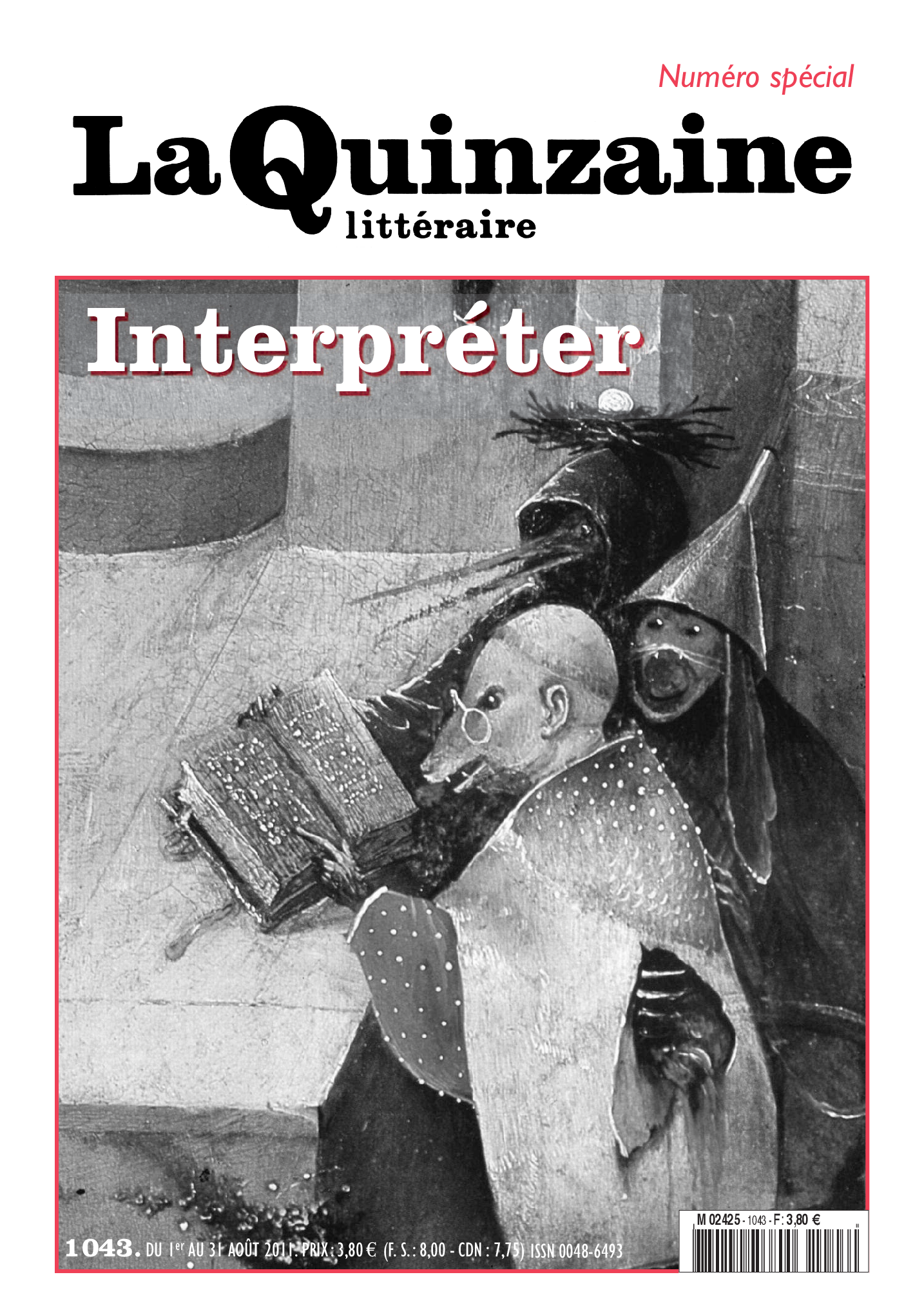

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)