Le livre de Sébastien Charbonnier ne relève ni du style du panégyrique ni du style défensif. Il emprunte beaucoup à la sociologie de Bourdieu et aux historiens de la classe de philosophie et développe un programme qui se veut émancipateur (1). Il rappelle que la revendication universaliste et émancipatrice des philosophes contraste avec le caractère très réduit de leur public (jusqu’aux années 1960, la philosophie concerne moins de 10 % d’une classe d’âge, et ce n’est que vers 1980 qu’intervient la massification de cet enseignement). Il dénonce les mythes et contradictions de la philosophie au lycée : son élitisme en dépit de sa revendication démocratique, la métaphore du « couronnement » que constituerait pour le lycéen cet enseignement, sa prétendue exceptionnalité, la prétendue « difficulté » de cette discipline, le rôle tantôt de prêtre laïque, tantôt de gourou du professeur de philosophie, et les formes permanentes d’autolégitimation que cette discipline se donne.
Il propose, contre l’esprit de sérieux scolastique, qu’on retrouve le sens du « jeu sérieux », et qu’on conçoive l’enseignement de la philosophie comme un ensemble de pratiques et non comme un apprentissage théorique. Il suggère, en s’appuyant sur des enquêtes menées auprès d’élèves, que l’on cesse de considérer qu’il y a des textes canoniques et que l’on se passe du professeur pour laisser aux élèves l’initiative des discussions, ou encore que l’on abandonne la pratique des notes. Il est cependant assez difficile de tirer de ce livre souvent profus et touffu des propositions précises et de voir comment celles-ci peuvent être mises en œuvre de manière uniforme. L’idéal – d’inspiration deleuzienne-bergsonienne-spinoziste – qu’il propose, à savoir de cesser de penser le « tout fait », d’être le plus nombreux possible à penser le plus possible, à retrouver le sens pratique et le sens de la minorité, reste plutôt programmatique et abstrait, à l’instar de ce qu’il dénonce.
Il y a autant de manières de concevoir l’enseignement de la philosophie qu’il y en a de concevoir cette discipline. À cet égard, la situation est-elle tellement différente aujourd’hui de ce qu’elle était au temps de Victor Cousin ? Plutôt que de voir les révisions successives des programmes comme des preuves d’une permanence de l’éclectisme, pourquoi ne pas y voir des tentatives – de plus en plus désespérées, il est vrai – pour établir un dénominateur commun ? Durkheim notait déjà en 1895 que personne n’accepterait un sujet de bac comme « Du rôle de l’imagination dans la perception extérieure ». Que dirait-on aujourd’hui ! Le problème des programmes n’est pas qu’ils ne donnent pas assez de liberté, mais qu’ils en donnent trop. Le problème n’est pas seulement que le plus grand nombre pense le plus possible – programme qui à la lettre peut parfaitement convenir à la philosophie médiatique qui a tendance à imposer ses modèles à l’enseignement scolaire aujourd’hui et qui constitue pour lui une véritable menace car elle recrée ce que Bourdieu appelait une « doxosophie » –, mais de penser quelque chose.
À quoi peut servir une « pensée en train de se faire » si l’on ne sait pas ce que l’on pense, si l’on ignore si ce que l’on dit est susceptible d’être vrai ou justifié ? À force de rendre les programmes indéterminés, d’y supprimer tout ce qui pourrait encore ressembler à une discipline scolaire, on vide la liberté qu’on revendique de tout contenu. Si penser est un art ou une pratique, cette activité ne doit-elle pas s’exercer selon des règles, dont la plus élémentaire est celle qui consiste à donner des raisons et à évaluer celles des autres, en courant le risque d’avoir tort ? Et pour cela ne faut-il pas un syllabus ? Et est-il sûr que le meilleur guide pour l’enseignement soit un philosophe qui proclamait : « la philosophie a horreur des discussions ; elle a toujours autre chose à faire » ?
- Jean-Louis Fabiani, Les Philosophes de la République, Minuit, 1988 ; Louis Pinto, La Vocation et le Métier de philosophe, Seuil, 2007 ; Bruno Poucet, Enseigner la philosophie : histoire d’une discipline, 1860-1990, CNRS éd., 1999.

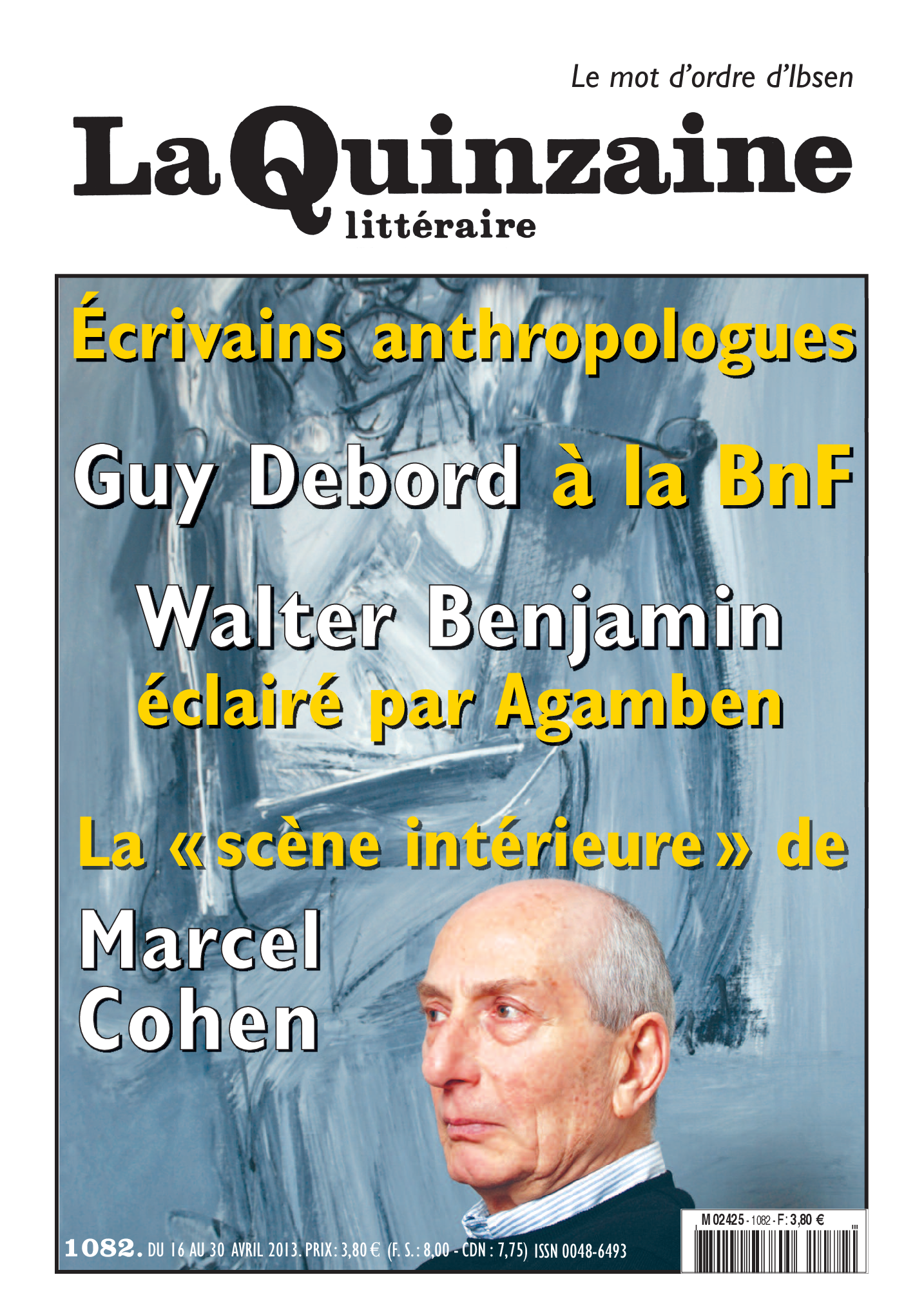

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)