D’ailleurs, cette rousse aux yeux verts n’est-elle pas une ondine, et toute cette histoire/retable en trois volets un rêve shakespearien plein de bruit et de fureur, déguisé en récit apparemment réaliste, alors que des passages en italique le ponctuent, où la voix grelottante des morts prend la parole, affirmant que c’est elle la conteuse qui, de bout en bout, a porté au jour les mots que nous lisons, à seule fin de ressusciter un monde défunt et d’empêcher, en le réitérant, qu’il ne disparaisse corps et biens ?
Telle est l’ambiguïté, grandiose, de ce chef-d’œuvre, coup de tonnerre, assurément, dans le ciel morne de la médiocrité littéraire ambiante. Dans l’excellent dossier consacré à l’écrivain par Le Matricule des Anges (n° 139, janvier 2013), on peut lire cette réponse de Stefánsson à une question de Thierry Guichard sur la « dimension chamanique » de son travail : « Pendant mon enfance, du plus loin que je me souvienne, il est évident pour moi que les vivants cohabitent avec les morts. Ma femme a vu plusieurs fois des visages lui apparaître comme ça. Sa mère a vu plus de morts que de vivants… (…) Dois-je croire ce qu’elles racontent ou dois-je les envoyer chez un psychiatre ? »
Boutade significative. L’auteur est un homme d’aujourd’hui, marqué de plus par un enseignement chrétien qui prétend à la raison depuis Saint Thomas d’Aquin, et cela en dépit des contradictions insurmontables auxquelles le parti pris rationaliste de celui-ci confronte la foi du charbonnier, si nécessaire pourtant à qui veut gagner le royaume des cieux. Il ne saurait donc ajouter foi à « ces conneries ». Mais comment un Islandais, si proche en cela d’un Japonais, pourrait-il ne pas être animiste ? Les soubresauts d’une terre volcanique, le vent furieux, la neige, la mer, la pluie, le froid, sont pour lui plus que des forces, des divinités derrière lesquelles s’embusque, avide, la mort omniprésente.
Ainsi, la puissance de cet ensemble romanesque formidable repose-t-il en partie sur le mélange, en un dosage subtil, de la peinture la plus concrète des choses et des événements de ce monde – gestes précis des hommes qui rament et qui pêchent le cabillaud ; gestes des femmes qui cassent la glace, de grand matin, pour y plonger leurs mains rougeaudes, éventrer et laver le poisson, l’étendre en été sur l’herbe, le sécher, le saler, le transformer en morue exportable ; occupations répétitives des pauvres fermiers de l’extrême Nord, confinés dans leurs maisons de tourbe enfouies l’hiver sous un fardeau de neige gelée ; bagarres des marins en goguette, saouleries, viols – et d’un fantastique souffle poétique issu des profondeurs de la nature, des profondeurs aussi, infinies même chez les rustres, de l’âme des hommes.
Réussir cette mixture improbable semble impossible et le miracle de ce texte est d’y parvenir constamment, avec une efficacité et une grâce souveraines. Chacun des trois volumes présente une structure différente, mais l’ensemble obéit à des lois communes. Dans le premier, l’événement moteur de la fiction est initial, c’est la pêche tragique dans laquelle périt, gelé parce qu’il avait oublié sa vareuse (oubliée parce qu’un poème qu’il lisait lui avait troublé l’esprit), le seul ami du gamin, cette mort déclenchant la fuite et le premier sauvetage du héros par une femme riche et dédaigneuse de l’opinion triviale, veuve non remariée, belle, amante d’un capitaine anglais, donc dévergondée. Le deuxième, commencé à l’auberge harmonieuse où, autour de cette femme exceptionnelle, vit une communauté de déclassés, prenait son envol avec le départ du gamin et du facteur Jens, un des géants mutiques et bons du livre, vers la Mer Glaciale, et se perdait dans la bourrasque de neige, s’arrêtant abruptement sur le toboggan d’une seconde mort.
La construction du troisième, plus complexe, fait alterner scènes intimes, d’une tonalité généralement apaisée et morceaux de bravoure éruptifs (renaissance du gamin et de Jens, dans la paix du printemps qui vient puis épisode sacrilège de l’église où attend, dans le cercueil que les héros ont convoyé au péril de leur vie, une épouse morte exhalant, dans sa décomposition avancée, une odeur de « mouton fumé » qui excite les chiens ; vie quotidienne au bourg avec ses petits drames et le duo amoureux de la belle aux yeux noirs et du capitaine anglais, puis tempête, anormale en début d’été, et disparition du capitaine, noyé dans la coque de son navire retourné par un coup de vent, au milieu du port, avec les huit marins de l’équipage ; mariage inattendu de la belle, puis naufrage de la barque du gamin, suivi d’un ultime sauvetage par la rousse aux yeux verts, mais engloutissement subséquent probable, ou possible, du jeune couple dans la mer implacable). En somme une suite de coups de théâtre, un système en dents de scie, qui pourrait rappeler le fonctionnement, en première analyse mélodramatique, du grand roman hugolien, ou plutôt de celui, à peu près contemporain, de Dickens, dont on sait qu’il est une des admirations de Stefánsson.
Et pourtant, bien qu’il s’agisse, dans les monuments romanesques du XIXe siècle comme chez l’écrivain islandais, d’une littérature de l’émotion et même, dans une certaine mesure, d’une littérature toute pénétrée de préoccupations morales à soubassement biblique et social, Le Cœur de l’homme n’a rien ni d’un mélodrame romantique, ni d’une réactualisation du roman d’apprentissage à la manière des Grandes Espérances. Les lois communes de l’écriture de Stefánsson, autant dire son originalité même, s’opposent à de tels rapprochements.
Au plan de l’agencement global de la trilogie d’abord, le principe d’organisation n’est pas l’enchaînement anecdotique des épisodes, comme s’il s’agissait de raconter l’histoire de quelqu’un (Jean Valjean, David Copperfied), mais le déroulement inéluctable des saisons (là encore, nous sommes très près d’une sensibilité esthétique japonaise). Ce qui commande la poussée de l’écriture chez Stefánsson, ce n’est pas le sort de l’humanité souffrante – donc pas la visée humaniste –, mais bien la météorologie, la vérité naturelle la plus concrète et la plus crue, mais par là même la plus étrangère à l’homme et comme la plus abstraite. La saga du gamin s’inscrit rigoureusement dans le temps qui passe et va vers la mort : un automne qui sent déjà l’hiver (septembre à décembre, tome I), puis manque de se perdre dans les méandres glacés d’un hiver tardif (mars-avril, tome II), s’épanouit enfin et peut-être atteint son terme au fil du court été (juin à août, le présent livre).
Les hommes ne sont à peu près rien dans cette affaire entre terre, ciel et mer, des bulles prêtes à crever, des fétus – et l’on retrouve là l’animisme tout-puissant. Jouets des éléments, guettés, à tous les à-pic des fjords, par la mort qui rôde, ils doivent être prêts sans cesse à entrer dans l’eau qui glace, l’eau endormeuse où ils rejoindront ces limbes obscurs où végètent tristement les voix de ceux et surtout de celles qui ne sont plus.
« Il pleut des voix de femmes, comme si elles étaient mortes, même dans le souvenir » chantait l’Apollinaire des Calligrammes. Or ce sont ces voix mortes qu’il importe de perpétuer, afin que la vie s’extirpe, malgré tout, du désespoir. À ces voix qui bourdonnent en permanence, souvent inaudibles, parfois plus fortes que celles des vivants, se superpose la grande rumeur biblique venue du fond des âges, ce ressac de catéchisme auquel tout le monde croit à demi, à l’enfer surtout, si proche de cette terre, au ciel un peu, trop loin, trop imparfait, et du reste, puisque l’amour, la réalité la plus charnelle et la plus sensible au cœur, l’amour seule expression non trompeuse du bonheur, n’est vécu et célébré comme il faut que par les femmes, par quelle aberration Dieu, s’il existe, a-t-il envoyé sur terre Jésus et non pas une fille, sa fille ?
Éric Boury, le traducteur à qui il faut tirer bien bas son chapeau, souligne dans le numéro du Matricule des Anges cité plus haut à quel point la langue de Stefánsson, fondée sur la juxtaposition de groupes de mots séparés par des virgules, est personnelle et moderne par rapport à l’islandais, idiome archaïque. On le suit aussi quand il précise combien est périlleuse la tâche de restituer en français, ce français analytique et sec qu’il faut un Chateaubriand, un Proust, un Claude Simon pour amadouer la prose essentiellement poétique, c’est-à-dire à la fois concrète et métaphorique, d’un écrivain aussi inventif que Stefánsson.
C’est qu’elle marche comme une navette, cette prose fluide, entremêlant sans jamais les embrouiller, sur la trame solide d’une histoire aux nœuds romanesques solides, où foisonnent des personnages, même secondaires, aussi pittoresques, vivants, aussi inoubliables que Scrooge ou Marley ou le chétif Bob Cratchit dans A Christmas Carol de Dickens (1843), les fils de dialogues à partenaires multiples mais écrits en continuité sur la même ligne, ou parfois détachés, comme au théâtre, avec indication conjointe du nom du locuteur, et ceux, plus fréquemment appelés sur le métier, de sentences généralisantes ou d’opinions qui ne sont attribuables à quelqu’un de présent – discours réel ou intérieur – qu’après coup, voire jamais.
Quand on ne sait d’où viennent les séries de fils qui se croisent, par exemple lorsqu’il est question de l’état lamentable des relations sociales à une époque où l’Islande, encore rattachée comme quasi-colonie au royaume de Danemark (depuis 1380), n’était guère qu’un noirâtre comptoir septentrional où les armateurs de Copenhague entretenaient une clientèle de gros commerçants locaux pressurant le bas peuple, on peut se demander si là perce la véritable voix narrative du texte. Mais rien n’est moins sûr. Car il se pourrait aussi bien que les trois femmes à qui ce roman en trois volets, si profondément féministe, est dédié, fassent partie intégrante – au moins les deux premières, dont les dates de mort sont indiquées – de ce tissu de voix disparues, si verlainiennes, qui se frôlent l’une l’autre en une mystérieuse symphonie de douceur et se mêlent à celles, innombrables, montées de l’indistinct passé d’un petit peuple misérable et fier.
Un peuple cultivé en ses provinces les plus reculées, plongé dans les ténèbres une partie de l’année, fou de soleil et de jouissance, que magnifie Stefánsson en un bouquet capiteux de beautés formelles sans aucun équivalent actuel, sous réserve de meilleur inventaire.
Maurice Mourier
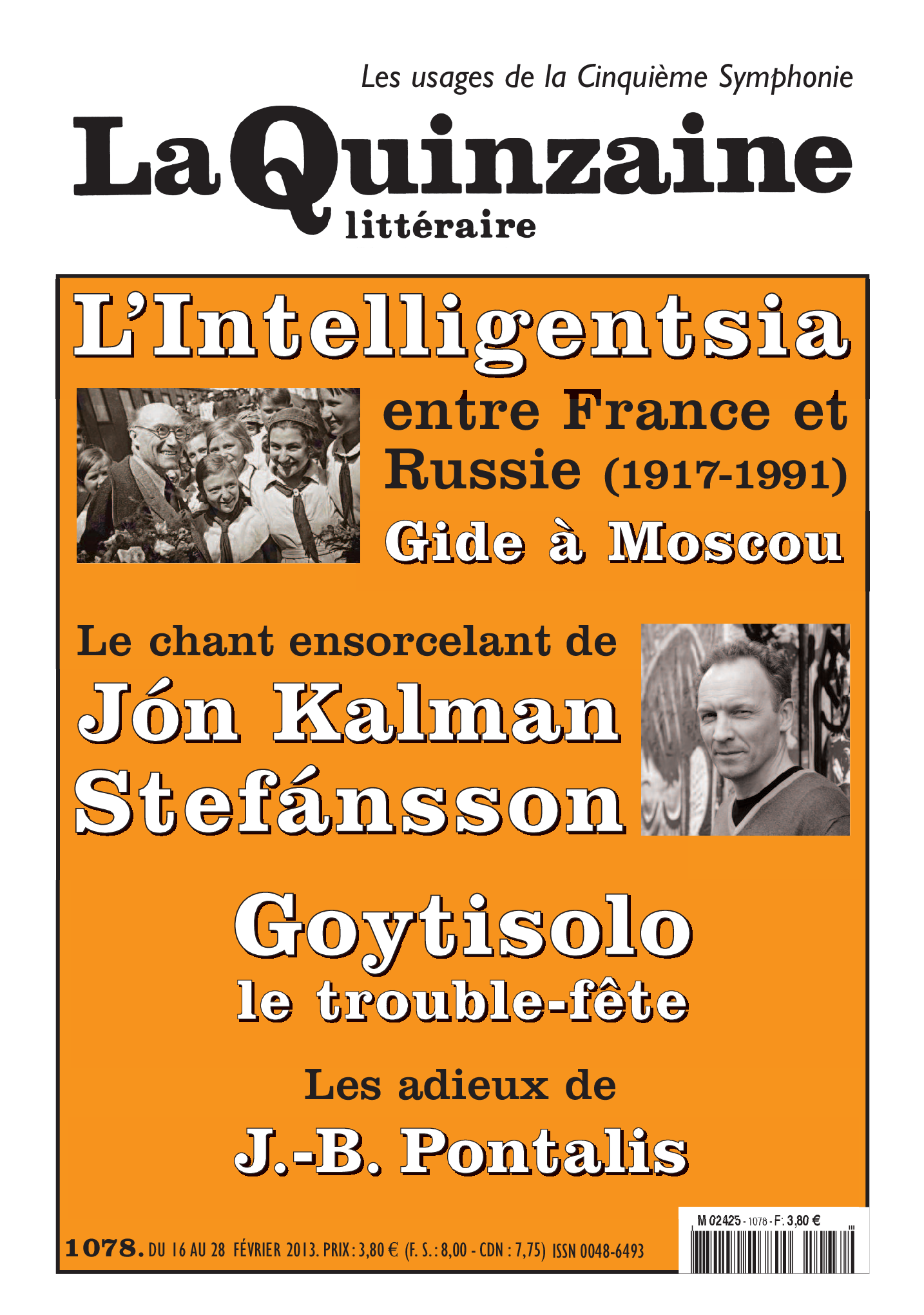

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)