Thierry Laisney – La découverte de la musique de chambre, réputée moins accessible, se fait souvent après celle de l’opéra ou de la musique symphonique, par exemple ; votre expérience a-t-elle été celle-là ?
Pascal Dusapin – Elle a été exactement inverse : mon premier souvenir de musique – j’avais six ans, pas plus – est un souvenir de musique de chambre, même si ce n’est pas au sens où l’entendent les musiciens classiques. Il s’agissait d’un trio de jazz (piano, contrebasse, clarinette) entendu dans un hôtel, lors de vacances à la neige. J’en ai un souvenir immense ; pour la première fois j’entendais de la musique organisée, c’est ça qui m’avait impressionné. À l’époque, je n’avais aucune idée de ce que pouvait être un orchestre symphonique ou un opéra, que j’ai d’ailleurs découverts très tard.
T. L. – Vous avez écrit de nombreuses pièces de musique de chambre, des œuvres instrumentales mais aussi des œuvres pour chœur de chambre, un opéra de chambre, etc. ; pourriez-vous définir ce qui fait l’unité de cette musique de chambre au sens large, est-ce qu’elle aurait un rapport particulier avec ce qui relève de l’intime ?
P. D. – Je vous dirai tout d’abord, de façon un peu provocante, que je ne fais pas nécessairement de différence entre la musique dite « de chambre » et la musique symphonique. Ce qui lie avant tout les genres, c’est le désir de composer. Ici, le désir ira à une pièce pour piano et clarinette, là à une pièce pour grand orchestre, etc. De l’un à l’autre, j’ai coutume de dire que je « continue ».
Pour ce qui est de l’intime, on peut arriver à une très grande intimité avec un orchestre symphonique, une intimité encore plus surprenante. Lorsque vous voyez – car il s’agit bien de vision – un énorme ensemble vous envelopper avec un sentiment très intime, très chaleureux, il peut y avoir quelque chose de très fort. Quand un orchestre se tait ou ne déploie plus qu’une simple ligne, comme une hésitation, il peut y avoir une plongée dans l’intime.
Ce sont là un peu des métaphores de compositeur expérimenté ; en effet, il n’en reste pas moins que tout ce qui relève de la musique de chambre crée de fait une intériorité – plus qu’une intimité. Rien que la plus petite surface du papier – puisque c’est ça mon métier, c’est de dessiner des notes – va créer quelque chose qui vous enveloppe de lui-même, de même qu’un écrivain qui soudain se mettrait à écrire sur un carton de bière dans un bistrot va être enveloppé par un sentiment très profond de l’intériorité. Si donc on veut dire que quelque chose va plus profond avec la musique de chambre, ce n’est pas vrai ; en revanche, si l’on veut dire que quelque chose s’éteint autour de vous au profit d’une expression moins égocentrique, alors c’est certain, la musique de chambre est la reine pour cela.
En même temps, il y a des formes de musique de chambre (je pense au quatuor à cordes) qui sont à la fois dans l’intime et dans la vastitude totale, qui sont des formes paradoxales.
T. L. – On utilise parfois à propos du quatuor à cordes, genre paradigmatique de la musique de chambre, la métaphore de la conversation. Vous-même avez dit que dans votre 4e Quatuor les instruments sont comme des frères qui se ressemblent tout en se distinguant ; plus généralement, pourriez-vous nous dire quelque chose sur cette personnification des instruments ?
P. D. – Chacun de mes quatuors a un projet spécifique et, en même temps, est relié aux autres par des effets de style ou des questions de construction. Tous mes quatuors ont à voir avec Beckett, mais le 4e et le 5e sont particulièrement appropriés à l’image de cet auteur. Le 4e Quatuor est fait sur une idée de singularité presque théâtrale. Les instruments commencent à l’unisson puis se divisent : ils vont chercher leur indépendance, s’écarter de leur ligne initiale et, de temps en temps, se réunir. Il y a presque quelque chose de l’ordre du narratif qui se met en place, dans la mesure où chacun des éléments musicaux devient comme un fragment d’une petite histoire, un peu comme dans certains textes de Virginia Woolf, où des discours inconscients-conscients s’établissent en parallèle, parfois se développent dans des directions opposées, parfois se rejoignent, mais pas nécessairement sur des points d’accord, et créent alors d’autres divisions, etc. Le 4e Quatuor est fait sur un assemblage de ce type. Le 5e est plutôt fait de deux groupes de deux instruments (selon des combinaisons variables), qui se séparent pour être plus forts. Il y a toujours une association dialectique. C’est comme un récit. Ce sont des histoires très abstraites, mais ce sont des histoires quand même, avec des devenirs, des résolutions, des luttes quelquefois, en tout cas des dialectiques qui se créent au fur et à mesure de la façon dont la pièce invente elle-même son propre temps. Et puis la figure de Beckett est importante : c’est une musique qui ratiocine, qui tourne autour de certaines choses sans jamais arriver à les résoudre, elle est en face quelquefois d’une forme de néant comme dans certaines pièces de Beckett, c’est une musique qui s’amuse aussi.
T. L. – Un auteur qui vous a consacré un livre (1), Jacques Amblard, souligne non seulement l’essence vocale de votre musique mais encore sa proximité avec l’intonation parlée (l’« intonationnisme ») ; qu’en pensez-vous ?
P. D. – J’ai été très frappé par cette thèse. L’« intonationnisme », c’est-à-dire le chant général dans l’espace de la voix humaine, correspond assez bien à mon travail. Je peux mimer ma propre musique, je peux la chanter, je la vis très physiquement. Même si je reste un écrivain de musique – je compose toujours « à la table » –, j’ai besoin de sentir dans le corps en permanence les flux de la musique, même quand il s’agit de musiques extrêmement complexes. Quand je travaille mes opéras avec les chanteurs, je chante toujours avec eux. Avec les instrumentistes aussi. Je n’avais pas élaboré de théorie particulière là-dessus, et Jacques Amblard a analysé ce phénomène de façon incroyablement exhaustive dans toute ma production.
Je suis sensible aux sons de la langue. Sur six opéras, j’en ai cinq en langue étrangère. J’adore aller au Japon car le japonais est une langue extrêmement chantante ; ce n’est pas une langue qui chante tellement individuellement mais c’est une langue chorale : il faut entendre les Japonais parler ensemble, dire la même chose avec des intonations différentes, cela crée des effets choraux d’une beauté ! Moi, j’entends ça et je me demande comment le capter et le transformer dans la musique. Cela peut entrer tout à coup dans l’orchestre, vous ne pouvez pas savoir, il y a une petite chimie qui se fait, un « précipité » comme disent les chimistes. J’aimerais bien faire un opéra en russe : il y a une possibilité d’accrocher la langue de façon tout à fait différente, rythmiquement et du point de vue de l’intonation.
Pour répondre plus avant à votre question, il faut s’interroger sur ce qu’est l’espace de l’imaginaire, sur la façon dont un compositeur entend et transforme les sons et les articule en mélodies. Et qu’est-ce qu’une mélodie ? Cela peut être un simple violon solo, une voix de chanteuse, mais ça peut être aussi un énorme orchestre étalé sur cinq octaves. C’est un énorme chant, presque inchantable, pourtant il s’agit encore d’un chant. La leçon des musiques extra-européennes, en particulier africaines, est importante aussi. Il y a, par exemple en Afrique centrale, des chœurs profondément mélodiques mais avec des structures harmoniques très complexes, micro-intervalliques, et qui relèvent du chant pur, du chant comme celui que peuvent chanter les enfants.
T. L. – Dans votre livre (2), vous dites qu’il ne faut pas avoir peur de parler d’émotion ; si, à l’écoute de vos quatuors en particulier, on parle de caractère méditatif, grave, d’inquiétude, voire d’angoisse, est-ce que selon vous cela renvoie seulement aux impressions de l’auditeur, ou y a-t-il dans cette appréciation quelque chose de plus objectif ?
P. D. – En effet, je n’ai pas peur de la question des émotions, ni même de celle de la mélancolie, de la tristesse, etc. Pour mon opéra Passion (qui va faire l’objet d’une nouvelle mise en scène en octobre prochain au Théâtre des Champs-Élysées), j’ai fait un travail presque théorique sur la question des affects, en revenant aux affetti monteverdiens, etc. Que subjectivement on ait des émotions, c’est certain. Mais quelles émotions ? Quand j’entends des sinistres dire qu’ils n’ont jamais ressenti la moindre émotion à l’écoute de la musique contemporaine, ce n’est pas le problème de la musique dite « contemporaine », c’est le problème de la personne qui écoute. J’ai eu des émotions fantastiques en écoutant Stockhausen ou Xenakis, je refuse à quiconque de m’enlever le privilège d’avoir une émotion. L’émotion a été un sujet tabou dans toute la musique d’après-guerre pour des raisons qui appartiennent à la grandeur et à la misère de notre histoire, et ne sont pas réservées à la musique : la littérature, les arts plastiques sont passés par la même histoire. En ce qui me concerne, quand j’ai commencé, très jeune, on me disait : « c’est trop lyrique, c’est trop expressif... », mais j’ai besoin pour ma part que la musique exprime quelque chose, qu’elle relève du domaine de l’expression directe et je me suis arrangé pour le faire, encore aujourd’hui. Que ça devienne des émotions après, c’est autre chose. En revanche, je pense que la question centrale de l’art, que cela plaise ou non aux musicologues de la musique moderne, c’est bien de créer des émotions nouvelles, et quand vous créez des émotions nouvelles, vous créez aussi des malentendus anciens, je pourrais faire ce jeu de mots.
Mais qu’il y ait une objectivité des émotions, certainement pas. L’émotion, c’est du cognitif complexe : ce qui nous émeut aujourd’hui ne nous émouvait pas il y a dix ans, il y a mille ans, etc.
T. L. – Mais si l’on attribue par exemple à votre 5e Quatuor la propriété d’être douloureux, interrogatif...
P. D. – C’est vrai ! Il y a même une revendication : c’est cela que je veux faire. C’est presque un projet, je veux me coller à ça, ce qui ne veut pas dire que je veuille l’imposer aux autres ; je veux faire sortir ça de moi.
T. L. – Dans le même ordre d’idée, Alain Poirier est allé jusqu’à entendre dans votre 4e Quatuor un « témoignage parallèle d’événements divers et contemporains de la composition comme ceux en particulier de politique internationale » (3); cela-a-t-il un sens pour vous ?
P. D. – Je ne savais pas qu’Alain Poirier avait dit cela. Il a dû voir mes manuscrits, où je mentionne souvent les événements politiques ; en tout cas, ça me fait plaisir, car l’une de mes interrogations sur mon métier est de savoir ce que nous exprimons, nous compositeurs, dans notre relation au monde et comment nous le disons. Nous le disons avec un langage d’expression universelle mais d’une abstraction telle qu’il est parfois difficile de se connecter au monde. Par comparaison avec ce que fait un écrivain, un plasticien, un cinéaste, un photographe, comment la musique, dès qu’elle est dans sa substance même, peut-elle témoigner de l’obscurité du monde ?
T. L. – Dans un livre tout récent (4), Thomas Dommange se demande ce que signifient toutes les annotations et citations dont Schumann a parsemé ses partitions. Selon lui, la musique et le langage sont radicalement hétérogènes, mais la musique étant impuissante à dire sa propre essence, le langage extra-musical le fait en quelque sorte pour elle. Les annotations verbales indiquent comment le compositeur, après coup, entend son œuvre. Pour vous, qui avez notamment beaucoup cité Beckett en marge de vos partitions, quel est le rôle des annotations ?
P. D. – Ce que dit cet auteur me paraît très juste, si ce n’est que pour moi les annotations ne viennent pas après coup mais toujours pendant la composition. Un texte me frappe, s’adapte très bien à ce que je suis en train de vivre et donc je l’insuffle dans la musique. Ensuite, je le garde ou non dans l’édition définitive. J’ai tendance maintenant à réduire un peu mes annotations car elles sont trop commentées, on m’y renvoie toujours. Regardez la partition qui est devant moi ; première indication : Simplement, ce n’est pas une indication typiquement musicale, c’est déjà plus du texte, une indication technique mais aussi extrêmement psychologique. Vous pouvez ainsi éprouver le besoin d’éclairer le cours d’une œuvre pour vous-même et pour un interprète futur, le paradoxe extraordinaire de la musique faisant qu’elle est toujours dans cette expression de « je ne peux rien vous dire, alors je vais tout vous dire mais je vais le dire autrement ». Mon 5e Quatuor est parsemé de citations de Mercier et Camier de Beckett, et cela aide les musiciens, cela leur donne des indications sur le cours du temps en train de se faire. Dans mon 2e Quatuor, Time Zones, il y a une pièce réservée au violoncelle solo, une pièce où tout est fait pour que ce soit difficile à jouer, l’instrumentiste est mis théâtralement dans cette situation. Lors de l’édition, j’ai ajouté à la fin une citation de Mercier et Camier : « Quel salaud ! » Rien que cette petite indication « fait passer la pilule », en permettant au musicien de comprendre que je sais exactement dans quelle situation je viens de le mettre ; en même temps, c’est une provocation – d’ordre pratique – pour le faire aller plus loin. Dans le même quatuor, il y a un mouvement, très lent, où les instruments ne jouent jamais ensemble (sauf la dernière note), j’ai mis une citation des Carnets de Léonard de Vinci : « L’oiseau de moindre poids plus largement s’étale » ; les musiciens comprennent alors tout de suite qu’il faut alléger, que quelque chose s’évapore en quelque sorte.
Quand je travaille avec les musiciens, les textes, je les fais moi-même : j’emploie sans cesse des métaphores, très simples, parfois sexuelles ou érotiques, j’explique des situations, je raconte des histoires. Je suis prêt à tout pour que la musique sorte et pour qu’elle soit incarnée par une vie narrative, mais pas au sens où l’entendrait un raconteur d’histoires.
T. L. – Puisque La Quinzaine littéraire consacre son numéro spécial à « la chambre », que ce thème vous inspire-t-il, quel lien éventuel pourriez-vous faire en particulier avec l’architecture, qui vous intéresse beaucoup ?
P. D. – Quand vous m’avez parlé de « chambre », j’ai aussitôt pensé au Voyage autour de ma chambre de Xavier de Maistre. C’est un livre que j’ai relu plusieurs fois dans ma vie parce que c’est un livre qui est dedans et, à la fois, qui tourne autour. Quelle autre définition au fond peut-on avoir de la musique ? Il y a un double paradoxe : vous êtes dedans, vous tournez autour, et vous êtes ouvert sur l’infini. L’architecture peut relever du même paradoxe. J’apprécie l’architecture avec mon corps ; en général, il s’agit de la confrontation avec un espace où tout à coup mon corps se sent bien. Un exemple : un certain endroit du Trocadéro, sous les colonnes, qui crée une intimité extraordinaire, où je pourrais dormir, travailler... On retrouve le dedans, le « tourner autour » et le périmètre extravagant de l’infini. Autre exemple : dans cette prodigieuse salle de concert qu’est le KKL à Lucerne, il y a un endroit qui crée pour moi un moment de plénitude physique d’une extrême intensité. Et puis le lieu où nous sommes, que j’ai éprouvé physiquement avant d’en faire mon atelier : toujours une relation de corps.
- Jacques Amblard, Pascal Dusapin : l’intonation ou le secret, Musica Falsa, 2002.
- Pascal Dusapin, Une musique en train de se faire, Seuil, 2009.
- Cité dans l’Histoire du quatuor à cordes, Fayard, nouvelle édition 2010, tome 3, p. 1107.
- Thomas Dommange, L’Homme musical, Les Solitaires intempestifs, 2010.

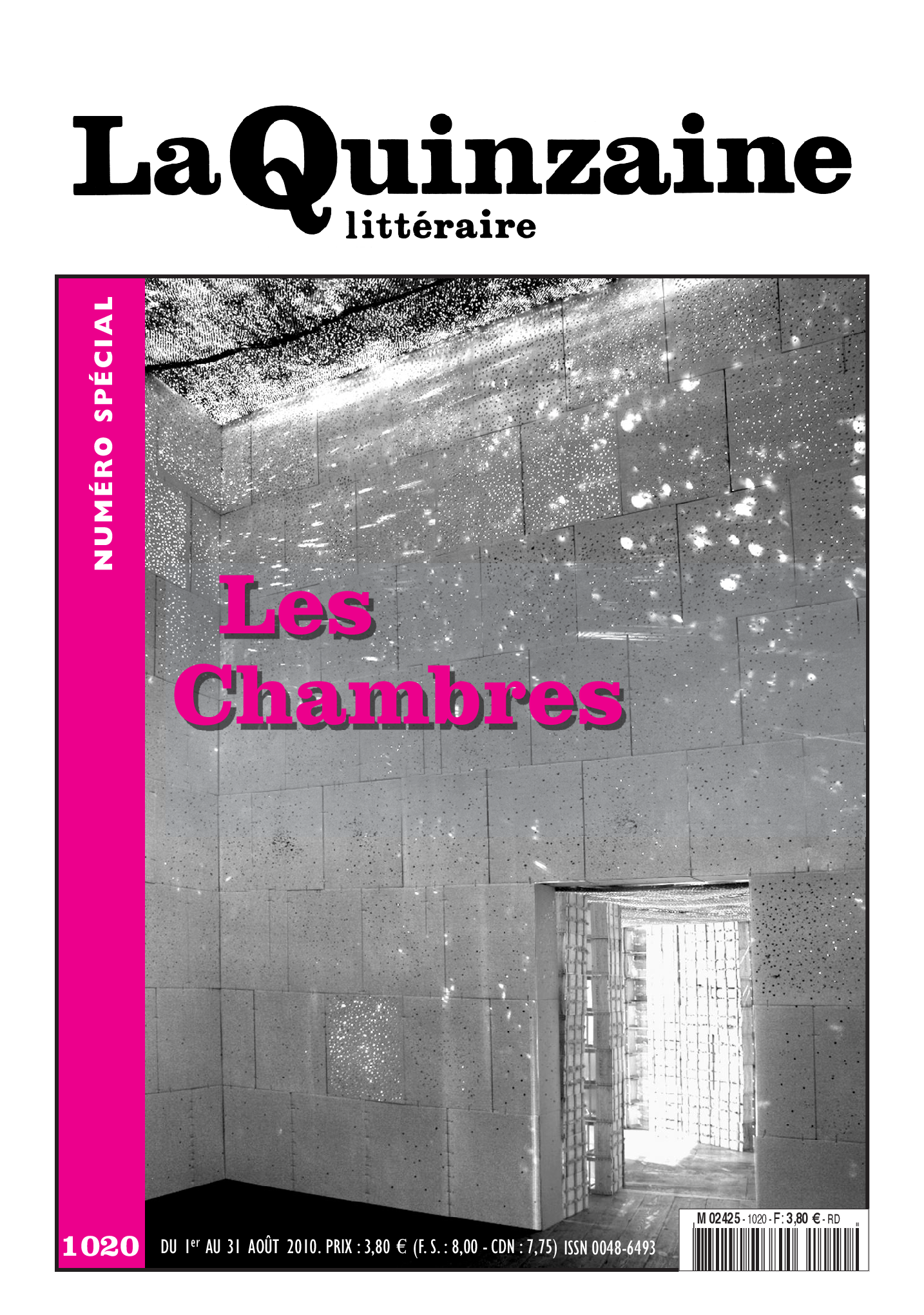

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)