Rien n’est sans doute plus important que les territoires fictifs, les nôtres, ceux qui conforment notre perception, altèrent nos sens, défont la réalité, empêchent de tourner rond, d’être simplement, de vouloir ou de comprendre, ceux-là mêmes qui réordonnent le chaos du réel, le reforment suivant des dispositions particulières, incongrues et profondes, intimes, solitaires, résumant à eux seuls notre identité, ses tracas, ouvrant une perspective qui semble impossible. Rien ne l’est pourtant et seuls demeurent les lieux qui nous font exister, pleins d’illusions, encombrés des restes de nos apprentissages, de nos lettres qui s’abîment dans le néant, de nos ombres qui s’échappent tels des spectres s’effaçant, lentement oubliés. Nous sommes seuls, improbables, désignés à notre propre signe, enfermés, égarés dans le monde, tantôt gigantesques dans un espace confiné, tantôt minuscules dans l’immensité. Telle Alice dans le terrier, nous ingurgitons les potions qui nous transforment, dans le trou, dans la pièce, nous changeons, modifiés comme des objets, au-delà de nous-mêmes, près de disparaître. Nous nous raccrochons alors à notre ombre, au double qui nous suit, habitant second qui nous pourchasse d’une assiduité maladive, dont nous ne nous dépêtrons pas.
Pourtant, c’est son ombre que Peter Pan vient chercher dans la chambre des enfants Darling – Wendy, John et Michael –, la poursuivant, lui parlant comme à une vraie personne, se dissociant de lui-même et ne vieillissant pas. Barrie l’écrit dans la célébrissime première phrase : « All children, except one, grow up. Tous les enfants, sauf un, grandissent. » Là, dans cette scène inoubliable, se joue quelque chose de profond, un basculement du sens, s’ouvre, comme une porte, une ère du regret et du choix de la réalité que nous adoptons, ici symbolisé par la césure entre les enfants ensauvagés et les adultes qui reconnaissent l’ordre du monde. D’un côté la joie du rêve, le bonheur irréel et illusoire (peut-être pas tant que ça !), de l’autre, l’acceptation des règles et de l’inéluctable. On est loin des rêveries de Swift et des incroyables Voyages de Gulliver, loin d’un monde de l’idée qui se transpose, de l’illustration d’un propos, d’une réflexion politique et de l’ironie terrible de celui qui ordonne le renversement du pays des Houyhnhnms. (Notons que Gulliver aura bien souvent sa chambre dans ces drôles de contrées.) L’écrivain a traversé le miroir, passant de l’autre côté. Il a changé, transformant le lien (platonicien) qui le lie à son environnement, abolissant les règles. Il est dorénavant le chantre involontaire de l’irréalité.
Au début du XXe siècle, le monde bascule, les signes s’ordonnent différemment, la représentation semble entrer en crise, comme un organisme épuisé ou contaminé par un virus, le sujet pensant, l’écrivain, le narrateur, se dissocie, s’abolissant dans sa multiplicité. Reprenant les schèmes d’une histoire ancienne, celle du rationalisme, le doute grandit, le monde, l’être, se disloquent. Nous entrons, passant un seuil, dans l’ère de la négativité. La chambre devient alors (peut-être ce qu’elle n’a cessé d’être) le lieu des échos, des tergiversations de la conscience, de sa déliquescence, le siège d’un trouble essentiel, celui qui défait le monde et l’être qui le perçoit, le territoire impossible qui n’obéit pas aux règles.
C’est dans le lieu le plus habituel, comme dans les objets quotidiens qui se métamorphoseraient en des artefacts inimaginables, que le monde se défait, que l’identité se dilue et se reforme sans cesse, que l’ordre s’effondre. Le héros des Aventures dans l’irréalité immédiate (1) confie cette expérience fascinante dans les premières pages de ce livre incroyable : regardant un point sur le mur de sa chambre, il déconstruit l’expérience de la disparition de son identité, sa dilution progressive et son ressaisissement approximatif. « Lorsque je regarde longtemps un point fixe sur le mur, il m’arrive parfois de ne plus savoir qui je suis, ni où je me trouve. Alors je ressens l’absence de mon identité, comme si j’étais devenu pour un instant une personne tout à fait étrangère. Ce personnage abstrait et ma personne réelle se disputent ma conviction avec des forces égales. » Il est impossible d’être ce que nous croyons, la fixité de l’être est un leurre, et peut-être ne sommes-nous rien. Ce jeune garçon ne cessera de traverser des chambres pour expérimenter le sentiment de la réalité, s’abîmant dans le monde, dans la masse de sensations qui défont le réel, le réordonnant sans cesse, scindant la conscience en une suite de plus en plus indiscernable d’épars qui ne se rejoignent plus. Il y a là le plus grand effroi qui soit, celui qui hante notre temps.
L’immédiateté, c’est la chambre, le lieu solitaire, d’une élection involontaire, le terreau familier de l’irréalité, l’espace dissociatif par excellence, l’antre de notre propre disparition. Avec peine, nous y survivons. Les ombres nous pourchassent comme nous les pourchassons. C’est un combat inégal et perpétuel. Peter veut épingler la sienne, la retenir, rétablir son entièreté. Dans le même temps, il désire ce qu’il ne peut posséder, réclame le détachement de sa condition, essayant d’être complet, de suspendre sa propre fuite. Il s’attarde dans la chambre d’enfants qui appartiennent à la communauté, voués au vieillissement, à l’illusion de leur vie future, alors que lui demeure éternellement jeune, enfantin, et les entraîne dans un voyage merveilleux, dans la fuite de la réalité, à l’abord du Pays imaginaire. Arrachés à leur chambre, ils reviendront après leurs aventures, leur incartade au royaume des songes irréels, rassasiés de leur propre enfance. Il survivront à leurs rêves, alors que lui, séparé, retournera vers son territoire, sa chambre (celle, dissimulée, où Wendy raconte son histoire) emplie de rêves immatures et jouissifs, dangereux, aux allures de géographie impossible.
La chambre constitue bien souvent le dernier refuge, l’espace que l’on referme sur soi, comme une coquille obturée sur le corps d’un mollusque, une manière de tanière dirait sans doute Blecher. Elle conforme le sursaut de l’individu, son recoin, une abstraction en quelque sorte. En 1942, l’écrivain juif polonais Bruno Schulz (2) meurt, assassiné en pleine rue par un officier nazi. Schulz avait jusqu’alors miraculeusement survécu à l’élimination des Juifs de sa ville parce que Landau, un gestapiste féru d’art, lui avait fait délivrer un sauf-conduit en échange de la réalisation de fresques dans la chambre de son jeune fils. Cette chambre fut le territoire de Schulz, l’espace sur lequel il inscrivit sa trace, ses signes, aujourd’hui effacés et néanmoins toujours présents. Une sorte d’hérésie de la survie, de geste absolu, premier ou dernier, recours ultime d’une conscience déchirée, d’un homme que l’on ne peut briser. La chambre de cet enfant étranger s’apparente à l’ultime cache, symbole d’une survivance, enchevêtrement d’une peur terrible et d’un espoir démesuré. La chambre trace la séparation, la frontière qui nous travaille, elle devient le lieu où l’on s’étreint soi-même, se perdant sans cesse, se ressaisissant de ses formes, s’y lovant, s’y égarant comme au cœur d’un territoire infini, se reformant toujours. Et là, s’entrecroisent sans fin nos ombres.
- Max Blecher, Aventures dans l’irréalité immédiate, traduit du roumain par Marianne Sora, Maurice Nadeau, 1989.
- Bruno Schulz (1892-1942), lire Le Sanatorium au croque-mort et Les Boutiques de cannelle (Gallimard, coll. « L’Imaginaire »), Le Livre idolâtre et sa correspondance (Denoël).

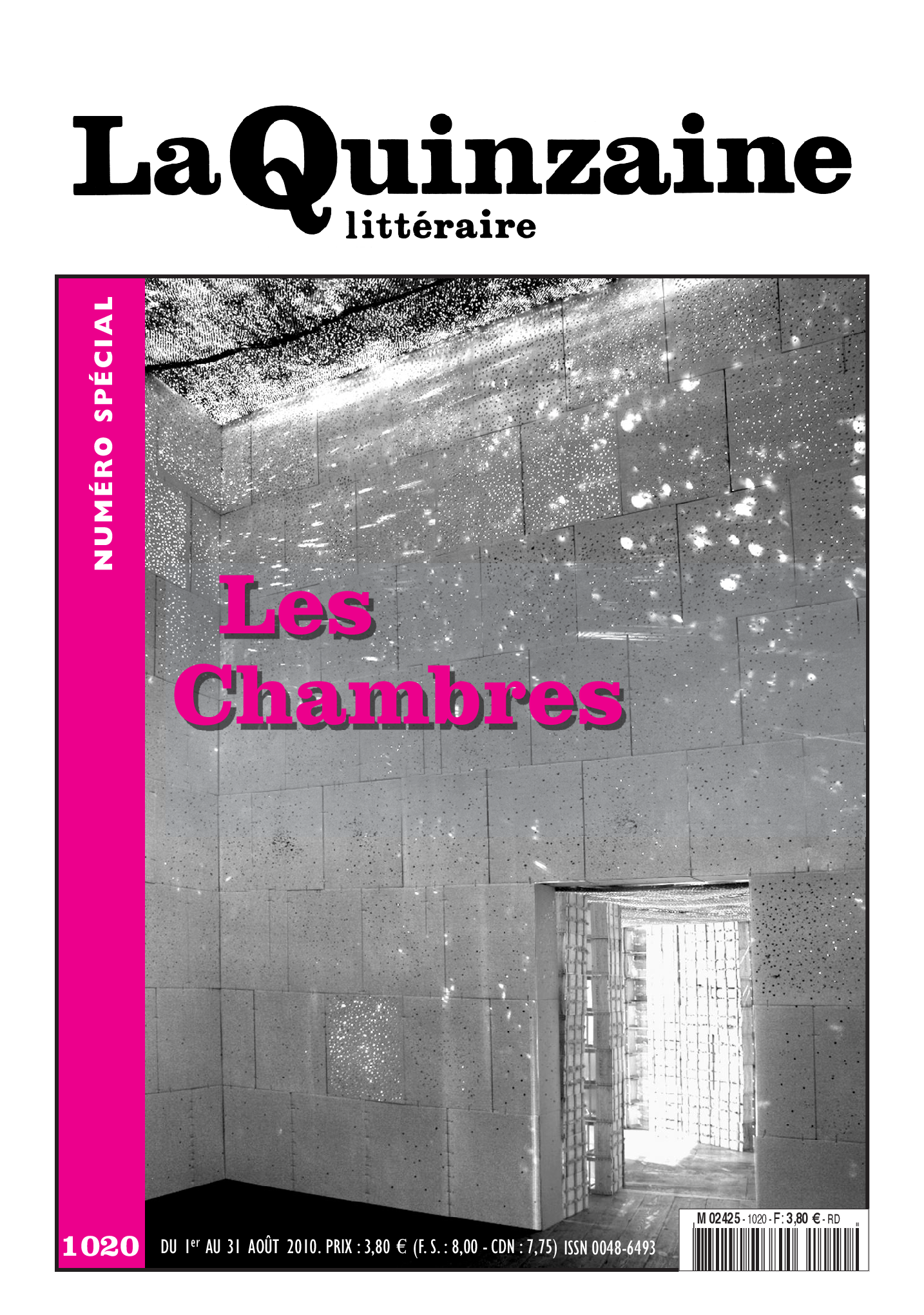

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)