Entre-temps, de – 400 à + 200, la philosophie du Jardin – du nom de la propriété achetée en – 307 à Athènes par Épicure pour y installer son école – avait successivement étendu son influence sur les trois secteurs géographiques du monde méditerranéen : l’Asie Mineure, d’où elle partit, la Grèce propre puis sa conquérante et son émule l’Italie. Comme les autres grandes « sectes » grecques et notamment l’Académie de Platon (créée en – 387) et le Portique du stoïcien Zénon de Citium (ouvert en – 300), elle fut constamment sous le feu des critiques et des réfutations, mais demeura plus que ses rivales au centre de débats virulents, à cause de sa radicalité théorique et de son intransigeance : matérialisme absolu, relégation dans l’empyrée de dieux impuissants, morale du plaisir.
Les ennemis d’Épicure et de ses successeurs, par la qualité de leurs mises en cause, fournissent d’ailleurs, en particulier à l’époque romaine, la meilleure preuve de l’importance accordée par l’élite intellectuelle de la fin de la République aux thèses du Jardin. Ce n’est qu’avec le christianisme et sa véhémence « fondamentaliste », chez Tertullien (IIe-IIIe siècles de notre ère) et surtout Lactance (IIIe-IVe siècles), qu’il est tenté de faire table rase d’un épicurisme travesti en libertinage vulgaire et en sensualité de goinfres (les prétendus « pourceaux d’Épicure »), sans toutefois que ces falsifications honteuses parviennent à tuer une doctrine dont on retrouverait les traces chez Montaigne, Molière élève de Gassendi, La Fontaine et tant d’autres esprits libres.
Mais au juste, où lire les textes fondateurs ? L’entreprise est malaisée car le temps a été plus clément pour la pensée de Socrate rapportée par Platon, pour Aristote son continuateur, pour les stoïciens, tous gens plus acceptables et mieux acceptés que les épicuriens, ces amis de la plèbe. L’essentiel du volume imposant proposé par « la Pléiade » consiste donc à mettre à la disposition d’un public (très) cultivé des pages d’Épicure et de son école. Or, ce que l’on arrache aux décombres de l’Histoire littéraire, ce sont surtout des bribes, ou carrément des débris. Épicure, effrayant polygraphe, avait écrit plus de trois cents « rouleaux ». Son œuvre princeps, La Nature, comptait trente-sept « livres », dont le labeur bénédictin des collaborateurs du présent ensemble n’a permis, sur un laps de douze années, de restituer que certains fragments.
Il faut dire que la patience et la sagacité de cette équipe ont dû s’exercer en particulier sur les papyrus découverts au XVIIIe siècle à Herculanum dans la bibliothèque de Philodème, un épicurien grec fixé en Campanie et mort vers – 40, et que ces papyrus avaient été aux trois quarts carbonisés par l’éruption du Vésuve en – 79 ! Aussi les efforts de déroulage matériel des volumina fragilisés, commencée par les savants italiens dès la mise au jour des vestiges dans la villa dite des Pisons, puis les tentatives subséquentes de raboutage, de remplacement éventuel des colonnes manuscrites manquantes, enfin de traduction, sont-ils toujours en cours, le résultat provisoire que nous tenons en main étant un des rares produits de la collection qui ne présente pas une suite harmonieuse d’écrits, mais bien un work in progress qui doit retenir l’attention d’abord à ce titre, donc plus par son côté de puzzle mystérieux que par un contenu effiloché et destiné en fait, le plus souvent, à des spécialistes.
Se succèdent en effet sous l’œil un peu hagard de l’amateur même éclairé non seulement le morse lacunaire d’Épicure mais celui de ses successeurs comme « scholarques » à la tête du Jardin, ou de ses disciples plus ou moins brillants : Métrodore (mort en – 278), Hermarque (mort en – 250), Idoménée et Polyène, tous deux de Lampsaque en Asie Mineure, Polystrate à qui l’on doit un intéressant opuscule sur « Le mépris irraisonné des opinions répandues dans la multitude », Zénon de Sidon (à ne pas confondre avec Zénon de Citium, fondateur du Portique) dont Cicéron alors jeunot suivit les leçons à Athènes, Démétrios Lacon qui déjà s’interroge vers – 100 sur les difficultés rencontrées dans la lecture des textes épicuriens et souligne que la représentation anthropomorphique des dieux dans l’épicurisme ne va pas de soi, enfin Philodème de Gadara (une cité grecque de Mésopotamie), émigré une première fois à Athènes, une seconde à Rome, puis établi à Naples sous son protecteur Pison, pour lequel il devait constituer, dans la station estivale chic d’Herculanum, une magnifique bibliothèque dont nous trions les cendres.
Heureusement il n’y a pas, dans l’immense fonds épicurien, que des restes calcinés. Et d’abord le compilateur Diogène Laërce, qui vivait au IIIe siècle de notre ère, nous a transmis ce que l’on sait de moins flou sur la vie du « philosophe illustre » mort depuis six cents ans. On découvre avec émotion la carrière du fils de l’assez modeste « clérouque » athénien fixé comme colon à Samos, son activité locale de professeur, les écoles successives qu’il créa dans divers comptoirs de la côte asiatique avant de s’établir à Athènes. On se fait une idée assez précise de l’homme, de son culte de l’amitié, de l’extraordinaire bienveillance qu’il témoignait aux plus petites gens, aux esclaves, aux prostituées, accueillis au Jardin comme auditeurs, une attitude aux antipodes de la morgue aristocratique de l’Académie et du Portique. On y apprend sa dignité, sa sobriété, son souci des autres lors de la rédaction de son testament, sa sérénité devant la souffrance et la mort.
Surtout Diogène Laërce a conservé trois lettres authentiques d’Épicure à ses disciples Hérodote (sur la physique), Pythoclès (sur les phénomènes célestes et la météorologie), Ménécée (sur l’éthique et la sagesse), résumés succincts de sa doctrine explicitement rédigés à usage de mémorisation plus facile de thèses dont l’auteur lui-même reconnaît ainsi l’excessive complexité, ces mémentos étant suivis de 40 « Maximes capitales » où la leçon philosophique se resserre encore.
C’est grâce à ces documents que l’originalité de la position épicurienne nous apparaît à nouveau. Fondée sur une physique matérialiste et mécaniste, celle des atomes, empruntée à Démocrite (mort vers – 370) mais modifiée par la « déclinaison » (cette déviation légère de la chute éternelle dans le vide des éléments premiers permet seule les chocs, les rassemblements et finalement les agrégats d’où naissent toutes choses), elle développe une théologie subversive (les dieux éternels et bienheureux ne s’occupent pas des hommes, il n’existe ni Champs-Élysées ni Enfers) et une cosmogonie qui ne l’est pas moins. Le tout a pour but unique le bonheur de l’individu. L’action politique, autant dire la vie même de la cité, si essentielle pour les Grecs puis les Latins, doit être bannie des préoccupations du sage. Le souverain bien se confond avec l’ataraxie, l’absence de trouble, une fois que la peur insensée de l’au-delà et de ses châtiments a été oubliée et que le plaisir, qui n’est autre que la sensation de non-douleur, a été reconnu par chacun pour la valeur unique de l’existence.
Heureusement aussi, tant pour les auteurs mutilés qui prolongent Épicure que pour les représentants ou adversaires de l’épicurisme tardif (Sénèque, Plutarque, Galien, Sextus Empiricus, ces deux derniers médecins), « la Pléiade », nous offre des notices copieuses, passionnantes, parfois d’une qualité d’analyse qu’on peut juger exceptionnelle quand on connaît bien, pour les avoir traduits mot à mot, les textes concernés – je pense à celle de Carlos Lévy expliquant d’une façon lumineuse des pages 1 312 à 1 318 l’hostilité, fondée sur une pratique assidue de la doctrine et non sur un dénigrement à base d’ignorance, de Cicéron à l’égard de l’épicurisme : la doctrine est antipathique à un homo novus avide de s’intégrer à une aristocratie de souche qui le regarde de haut. Car c’est une joie de lire ce que des chercheurs ayant consacré une partie de leur vie à un corpus difficile ont à nous dire sur lui, une joie de se croire plus intelligent en les lisant.
Pour nous, lecteurs modernes, c’est du reste l’épicurisme latin qui apporte les plus solides satisfactions littéraires, à cause de Lucrèce évidemment (né vers – 96), dont le De natura rerum, terreur des latinistes en herbe par son lyrisme à la fois emporté, abrupt et minutieux dans l’exposé des idées d’Épicure, constitue un hymne au génie du philosophe, élevé au rang d’un dieu, incomparablement plus beau que tout ce qui s’est écrit d’autre en poésie latine. Ici, un vrai regret : pourquoi le poème inachevé et inimitable n’apparaît-il qu’en traduction ? Certes, celle de Jackie Pigeaud est excellente dans sa rusticité un peu âpre, qui rend bien compte de la violence prophétique d’un poète emporté par la fureur de convaincre et de sauver ainsi l’homme du désespoir grâce à l’exemple d’Épicure. Mais la langue de Lucrèce est si riche, si puissante et en même temps si mélodieuse qu’on regrette l’édition bilingue procurée chez Aubier en 1993 par José Kany-Turpin et reprise chez Garnier-Flammarion.
Ne quittons pas la sphère de la latinité sans revenir à Cicéron, qui ambitionna non seulement de réussir une carrière politique (il y parvint avant d’être assassiné en – 43, un peu avant que la République ne le rejoigne dans la tombe), mais de doter Rome d’une philosophie à la fois empruntée à et démarquée de la Grèce. L’extrait proposé de La Nature des dieux aux pages 743-784 et traduit avec acuité et finesse par Clara Auvray-Assayas met en scène une discussion libre entre l’auteur, encore accablé en – 45 par la mort de sa fille Tullia et cherchant de ce fait consolation dans la pensée grecque, et ses amis Velléius l’épicurien et Cotta le « pontife », c’est-à-dire un prêtre membre du Collège ayant en charge la jurisprudence religieuse à Rome.
Velléius démolit méchamment toutes les écoles opposées à celle d’Épicure et expose sur un ton de magister la doctrine en insistant sur la perfection anthropomorphique des dieux et leur éloignement de toute préoccupation ou malheur ou crime des hommes. Mais c’est surtout la réplique de Cotta qui convainc le lecteur. D’un esprit mordant et d’une impeccable logique, elle n’a aucune peine à stigmatiser les contradictions d’Épicure et à démontrer que ses dieux, êtres de farniente, espèces d’ectoplasmes sans aucune nécessité, sont si insignifiants qu’en réalité l’épicurisme, s’il est honnête avec lui-même, doit en faire l’économie et n’est en somme qu’un athéisme déguisé, que bien entendu Cotta condamne… tandis que nous l’approuvons ! Passage d’une vigueur dialectique remarquable, qui met le doigt sur l’essence la plus profonde de la subversion épicurienne reposant sur le constat d’absurdité de toute transcendance. Or ce point crucial est loin d’être obsolète, n’est-ce pas ?
Épicure aujourd'hui
Car ce vieil Épicure, que peut-il bien représenter pour nous aujourd’hui ? Pour qui est passionné d’Histoire des Sciences, une des lacunes les plus notables de la présente édition, si superbe par ailleurs, est qu’elle ne fait appel nulle part à une exégèse scientifique contemporaine de la physique épicurienne, sur laquelle, rappelons-le, tout le système de la philosophie du Jardin, toute sa conception de la place de l’homme sur la terre, de sa naissance (fortuite conjonction d’atomes), de son inéluctable disparition (disjonction fortuite des agrégats) sont solidement assis. Solidement ? Qu’est-ce que la physique et les cosmogonies actuelles, qu’est-ce que le « modèle standard » du Big Bang pourraient conserver d’une science pour qui la sensation, en particulier tactile et secondairement visuelle, était la pierre de touche du vrai, et par conséquent le disque solaire pas plus grand en réalité qu’il ne l’est en apparence ? Mais en même temps pour qui l’agencement des corps premiers (aujourd’hui les quarks ?) suffit à rendre compte de la totalité du réel, à la condition d’y associer le vide (l’énergie du vide de nos physiciens de la « théorie des cordes » ?), tandis que la pluralité des mondes (admise par nombre des cosmogonies d’aujourd’hui) est donnée pour une évidence logique ? Voilà des questions qui ne sont ni oiseuses ni dépassées. N’en trouver ici aucune trace dénote une carence.
Il nous semble bien en effet qu’Épicure n’est pas si loin de nous, qu’il nous préserverait peut-être encore par son matérialisme ingénu de la remontée, de toutes parts, des remugles monothéistes, des Sarah Palin au front de taureau et des ayatollahs mugissants.
Quant à savoir si le remède en forme de panacée (comprendre que, nos atomes se dissolvant naturellement, il ne subsistera rien de nous) qu’il brandit pour éliminer de notre horizon la peur de la mort (réduite par lui à une peur de la souffrance immédiate ou bien différée dans les Enfers) a jamais eu et conserve toujours son efficace, demandez à Baudelaire si la véritable angoisse métaphysique n’est pas précisément celle éprouvée devant ce remède même, tout logique qu’il est : l’angoisse du « Néant triste et noir » !
Maurice Mourier
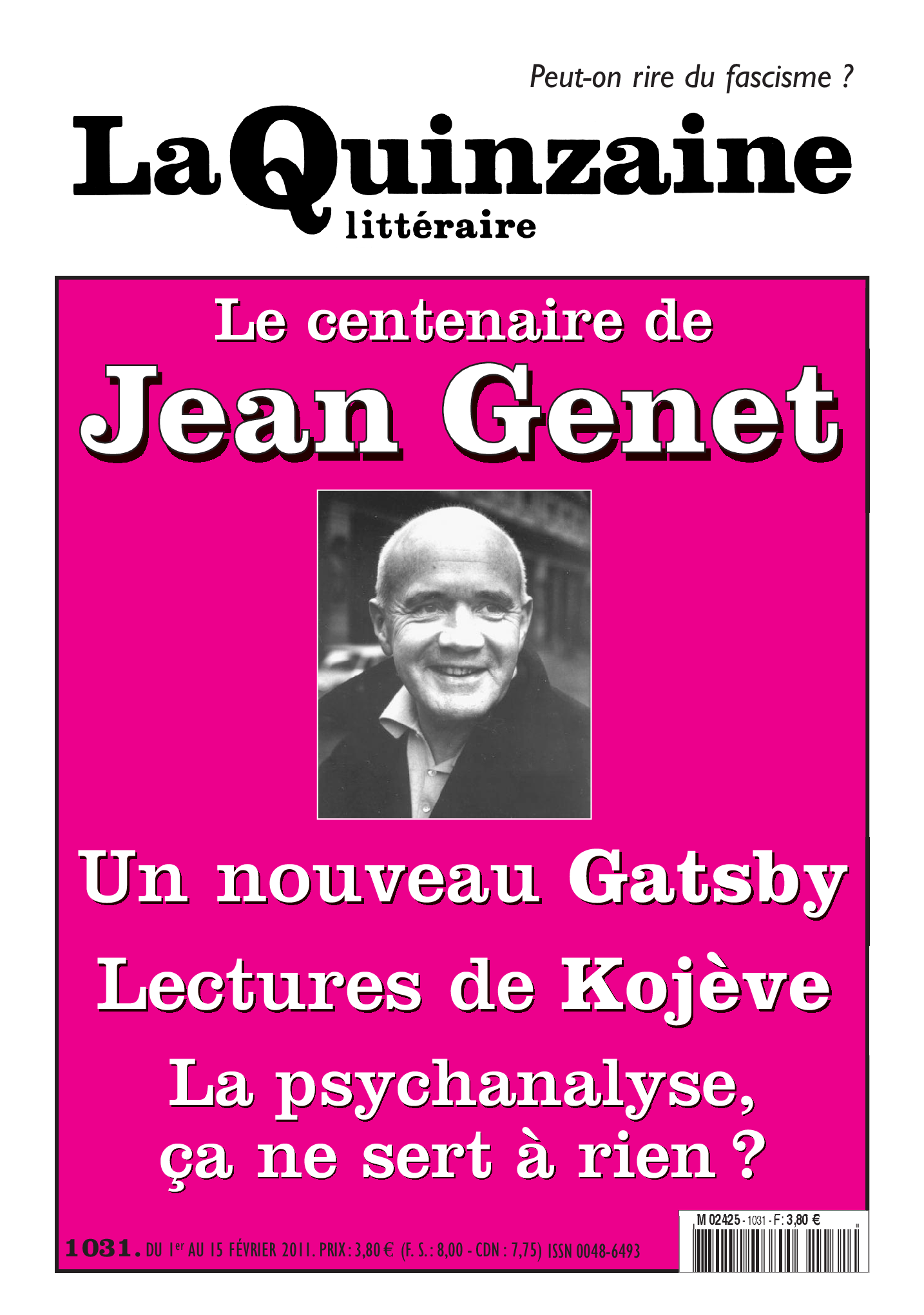

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)