Avant tout développement, une certitude : comparé à la littérature de science-fiction, le cinéma souffre d’un mal fondamental, qui tient à son excès de représentation. Déficit paradoxal : l’obligation de montrer constitue une limite à l’imaginaire. Et qui ne dépend pas de la technique du moment : des multiples bricolages naïfs primitifs aux effets spéciaux numériques actuels (le générique d’un film de SF répertorie plusieurs centaines de techniciens), rien ne peut y faire, l’image restera moins profondément porteuse de rêve que le texte. Au contraire, même : plus exacte se voudra l’impression de réel, moins celui-ci sera atteint de façon satisfaisante. Simplement parce que le futur n’a pas besoin d’être « spectacularisé » pour être vraisemblable : les vaisseaux spatiaux et les exoplanètes reconstruits dans le détail, les créatures de l’espace plus vraies que nature seront toujours inférieurs, sur le plan de l’imaginaire, à ce que les écrivains ont suggéré. En bref, la littérature d’anticipation n’a pas de frontières, le cinéma, si.
Ce n’est pas tirer contre son camp que constater que les grandes émotions, les interrogations, les sensations de bascule dans le gouffre n’ont pas été produites par les images animées mais par les textes : parmi les quelques centaines de films vus, entre La Cité foudroyée (Luitz-Morat, 1924) et District 9 (Neill Blomkamp, 2009), rien n’égale la découverte, du côté des grands anciens, du Monde des A de Van Vogt ou du cycle Fondation d’Isaac Asimov, de Tous à Zanzibar de John Brunner ou de Vermilion Sands de J. G. Ballard ensuite, du Monde inverti de Christopher Priest ou de L’Enchâssement de Ian Watson enfin, au moment où nous avons pris quelque distance avec la « fiction spéculative » moderne. Quant à Philip K. Dick, ses intuitions géniales n’ont jamais trouvé d’équivalent à l’écran : Blade Runner est un grand film parce que Ridley Scott est un grand cinéaste (mais il n’a emprunté que la trame des Androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?) et la série télévisée qu’il annonce à partir de l’uchronie éblouissante du Maître du Haut Château sera certainement réussie – mais Ubik, À rebrousse-temps ou La Vérité avant-dernière sont des romans éveilleurs de bouleversements que le cinéma d’anticipation ne nous a jamais apportés.
Il n’empêche que celui-ci existe, et même grandement – l’index établi par Jean-Pierre Bouyxou, dans sa vénérable (1971 !) Science-fiction au cinéma, comportait déjà 27 pages de titres sur deux colonnes – depuis, il y a eu Star Wars, Terminator et leurs sequels et prequels, et une recherche sur le site imdb offrirait assurément des centaines de titres supplémentaires. Impossible désormais d’établir un panorama d’un genre aussi vivace, d’autant que quelques sous-genres le traversent, parmi lesquels l’heroic fantasy (type Le Seigneur des anneaux), le space opera (type Terminator ou Avatar), les temps futurs (type Truman Show – le plus proche de l’univers dickien –, Dark City ou Antiviral, de Brandon Cronenberg, à Cannes 2012) ou la fiction post-apocalyptique. Chacun avec ses codes et ses canons, qui déterminent une faible marge de renouvellement : de Conan le Barbare (John Milius, 1981) à La Légende de Beowulf (Robert Zemeckis, 2007), il n’y a guère d’évolution, de Planète interdite (Fred McLeod Wilcox, 1956) à Avatar (James Cameron, 2009) la transition est d’ordre technologique (si le scénario du second est plus raffiné que celui du premier, la différence n’est pas fondamentale), la société de l’avenir obéit aux mêmes schémas – des Temps futurs (W. C. Menzies, 1937) à Bienvenue à Gattaca (Andrew Niccol, 1997), ce sont toujours les mêmes figures totalitaires. Quant aux lendemains de la guerre nucléaire, les visions en sont forcément répétitives, simples variations narratives à l’intérieur d’un paysage dévasté identique. C’est ce sous-genre qui fournit pourtant le plus de titres depuis quelques années, sans doute parce que l’inquiétude repose moins désormais sur la crainte d’une invasion d’extraterrestres que sur l’auto-empoisonnement de la planète.
Rien ne ressemble plus à un territoire rongé par les retombées d’une explosion atomique qu’un territoire rongé par une pollution majeure : villes en ruine, sources d’énergie détruites, agriculture anéantie, tribu de survivants ramenés à des conduites préhistoriques – avec parfois, au bout du tunnel, la lueur d’un nouveau départ, retour cyclique à l’Éden initial. Littérairement, le genre n’avait pas attendu Hiroshima, et, pour nous en tenir à l’Hexagone, Régis Messac et Jacques Spitz avaient dressé, dès 1935, l’un dans Quinzinzinzili, l’autre dans L’Agonie du globe, des tableaux désespérants de la société d’après le Grand Choc. Le cinéma hollywoodien attendit un peu, six ans exactement, pour lancer, avec Five (Arch Oboler, 1951), le premier signal de l’angoisse post-nucléaire. Production pauvre, tourné comme un reportage, le film ne demeure important que parce qu’il inaugure une lignée fructueuse, le sentiment du caractère inévitable de la catastrophe s’étant ensuite affirmé : le cinéma américain des années 50 résonne d’une menace diffuse, qu’elle prenne la forme de l’intrusion (Les soucoupes volantes attaquent, La Guerre des mondes, L’Invasion des profanateurs de sépulture – tous également interprétables selon l’angle « antirouges » de la guerre froide) ou de l’apocalypse (The Day the World Ended, Teenage Caveman, Last Woman on Earth, tous « nanars » fauchés de Roger Corman ; Le Monde, La Chair et le Diable de Ranald McDougall, 1959, première description plausible de New York désert ; Le Dernier Rivage, Stanley Kramer, 1959). Le passage des acteurs inconnus de Five aux stars de Kramer (A. Gardner, G. Peck, F. Astaire, A. Perkins) montre que le sujet a pris de l’épaisseur : au-delà du petit monde des amateurs de SF, c’est le grand public qui est maintenant requis.
En 1964, Vincent Price devient le dernier homme sur Terre, dans l’adaptation de Je suis une légende de Richard Matheson (Sidney Salkow). Mais l’interprète était trop raffiné. Il fallait, pour incarner l’ultime héros, un Américain 100 %, au sang bien rouge : c’est Charlton Heston, qui, quelques années durant, va devenir le porte-espoir pour l’humanité, entre La Planète des singes, primum opus de la série (Franklin Schaffner, 1968) et Soleil vert (Richard Fleischer, 1973), en passant par le méconnu Le Survivant (Boris Sagal, 1971), dont la vision de New York en déshérence était fort crédible – même si l’on a vu mieux depuis. L’homme providentiel, capable de tracer son chemin au milieu des hordes hostiles qui peuplent les ruines – le last man on Earth n’est jamais vraiment le dernier, il faut nécessairement des opposants au héros – sera désormais une figure récurrente du monde d’après. Pas forcément intéressé par le sauvetage de la planète, mais surtout concerné par sa propre survie, tel Mel Gibson que son rôle de policier vengeur dans Mad Max et ses suites (George Miller, 1979, 1981, 1985) portera au vedettariat.
Malgré leur contexte apocalyptique, les scénarios des Mad Max reprenaient les schémas du western, Mel Gibson n’étant qu’un successeur lointain du lone ranger, justicier solitaire des serials des années 30, et la bande de méchants motorisés l’équivalent des gangs de détrousseurs de banque. L’anticipation n’était qu’un agrément, manière de moderniser les ingrédients. Quelques films récents affinent la perspective, jouant à la fois sur les actions spectaculaires et sur l’austérité narrative : un couple, père et fils ou homme et femme, traversant le continent détruit, qu’il s’agisse de sauvegarde personnelle ou d’une mission plus vaste. Si les survivants de The Island (Michael Bay, 2005), perdus dans le désert à la recherche de la vérité, sont encore les sujets d’un complot qui leur échappe, les héros de La Route (John Hillcoat) et du Livre d’Eli (Hughes Brothers), tous deux de 2009, sont exemplaires. La Terre n’est plus que décombres, le soleil a disparu, l’eau est rare, des épaves se battent pour une boîte de conserve. Les père et fils du premier (adapté de Cormac McCarthy) descendent vers le Sud, promesse d’une éventuelle survie, et doivent affronter toutes les violences – périple d’initiation : l’enfant devra apprendre à se blinder en éliminant toute compassion, jusqu’à accepter la mort du père pour rejoindre une autre famille plus apte à le protéger. L’étrange messager solitaire du second, appelé vers l’Ouest par une voix intérieure, combat les hommes de main du Big Boss qui cherche à récupérer le livre qu’il détient – le dernier exemplaire de la Bible, qui permettra de redonner à la société en dérive des racines morales –, entraînant dans son sillage une jeune fille qui poursuivra sa tâche. Le film est ambigu, le messianisme se mêlant au western et au film d’art martial, mais l’idée que l’avenir du monde réside dans la transmission d’un écrit (dans l’île d’Alcatraz, les survivants disposent d’une presse à main) est réjouissante. Les lendemains qui lisent, on ne peut rêver meilleur slogan. Tout n’est peut-être pas perdu…
Lucien Logette
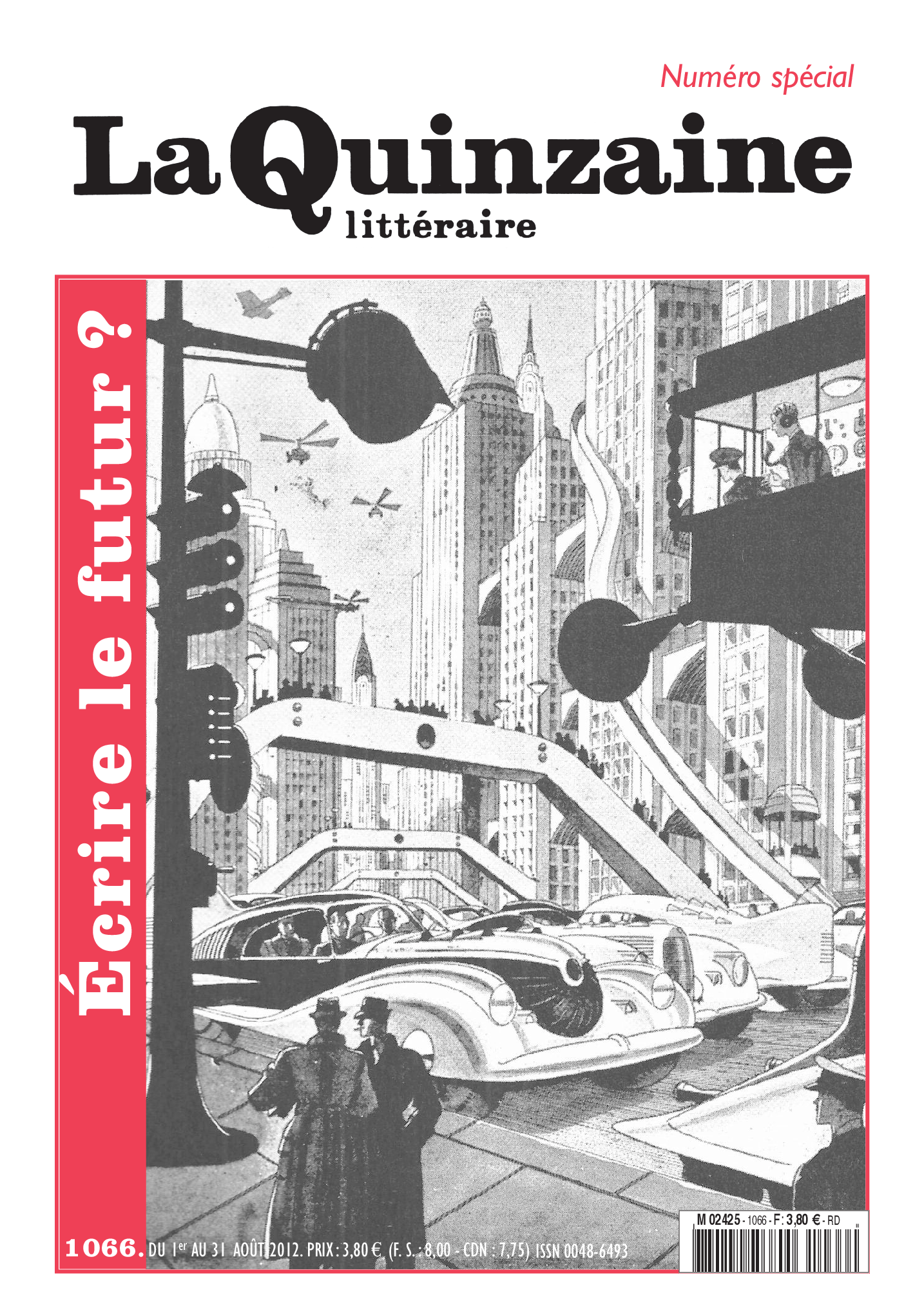

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)