Hugo Pradelle : À la parution de votre livre, vous affirmiez d’emblée que ce n’était pas un roman d’anticipation – il y a donc un sentiment ironique qui m’anime en vous interrogeant –, que c’est un livre qui réfléchit l’état de crise extrême pour des sociétés. Votre livre pourtant obéit à toutes les règles du genre.
Xabi Molia : Avant de disparaître se déroule à Paris, dans quelques années, alors que notre univers quotidien s’est radicalement transformé. L’est de Paris s’est fortifié et ses habitants y survivent, assiégés par des hordes de créatures féroces qui les attaquent obstinément et, peu à peu, les contaminent ou les tuent. On peut considérer les choses simplement et se dire que, se transportant dans un futur, on est, qu’on le veuille ou non, dans l’anticipation. Pourtant, j’avais une double réserve sur la conception du roman d’anticipation comme préfiguration. Cette approche rétrécie me déplaît car elle consisterait à faire du roman le lieu d’une vérité, sur un monde à venir, qui n’est pas du tout l’expérience de lecture à laquelle je voulais me livrer, ni construire pour les lecteurs. Par ailleurs, et cela semblera paradoxal, je ne me reconnais pas strictement dans l’anticipation parce que le cœur du livre, ce qui le portait, c’était l’envie de faire un roman historique. Je souhaitais travailler sur des formes intimes et collectives de culpabilité, qui ont marqué le siècle passé. Le livre a pris forme en réaction à la réception polémique des Bienveillantes, roman que je n’aime pas mais dont je veux défendre le droit à être un roman – et rien d’autre. Parmi ses détracteurs, certains lui reprochaient son manque d’exactitude historique. Comment écrire un roman qui prenne en charge un questionnement sur notre histoire en évitant le procès en incompétence fait au roman historique ? Une des solutions consistait à garder le problème qui m’intéressait, mais en le transportant hors de l’Histoire.
H. P. : L’anticipation n’est pourtant pas qu’affaire de préfigurations ou de prédictions, les choses apparaissent plus nuancées…
X. M. : J’avoue ne pas bien connaître cette littérature. Les livres aujourd’hui, dans la majeure partie des cas, n’existent dans les médias qu’à partir d’un angle qui permette de se relier à un état du monde, du réel, présent ou à venir. On parle alors d’autre chose que de littérature. Cela reviendrait, dans le cas d’Avant de disparaître, à avoir une lecture métaphorique du livre, qui n’est pas conçu ainsi. Cela m’ennuie profondément que le texte ne soit pas abordé pour ce qu’il est : de la littérature. C’est le malheur de Volodine qui pâtit d’une réception qui cherche à relier ce qu’il écrit à du connu, un moment de l’Histoire, des idéologies. Mais ce n’est pas son problème, il fait autre chose. Alors il demeure très largement ignoré du grand public. C’est pourtant l’un des écrivains les plus passionnants d’aujourd’hui.
H. P. : Votre roman, qui se situe après la catastrophe, met en scène le « pourrissement du monde » (c’est de vous !) et pourtant c’est aussi, surtout presque, un roman d’amour.
X. M. : Le livre s’est construit par cercles concentriques. J’ai d’abord mené une réflexion autour du stéréotype narratif « une femme disparaît ». C’est pourquoi Kaplan recherche sa femme, Hélène, qui disparaît au moment où leur histoire se termine. Je trouvais intéressant qu’elle disparaisse non pas dans le cadre d’un amour fou, mais dans le moment du tiédissement, de l’épuisement de la passion. J’ai ensuite élargi le cadre, et ce qui est apparu autour d’eux, c’est un monde qui lui-même se termine, dont l’histoire prend fin…
H. P. : C’est la catastrophe, l’épuisement, la fin…
X. M. : J’ai fait ma thèse sur les films catastrophes hollywoodiens. Je connais donc bien mieux ce sujet que l’anticipation. Ce genre n’est nullement anxiogène, il porte au contraire un discours rassurant et optimiste. Il met en scène le climax d’une catastrophe pour mieux souligner un moment de régénération, de purification. Il y a ainsi besoin du désastre pour qu’un dépassement s’opère, que la communauté se réinterroge sur ce qui la fonde, la fait tenir ensemble. Après la catastrophe, des valeurs véritables triomphent, « bonnes », justifiées par la tradition. J’ai donc voulu, au-delà d’une variation générique, imaginer un après où le cap serait cette fois mis au pire, avec au centre la déperdition.
H. P. : Concevez-vous cet élan anticipatif à la manière d’un exorcisme ?
X. M. : Il est vrai que j’ai une aversion pour les positions réactionnaires qui considèrent qu’après c’est toujours moins bien qu’avant. Ce que je trouvais intéressant, c’est ce moment de renversement de la perspective. On sort de la déploration pour développer un autre de mode de pensée qui renie le pessimisme naturel pour entrevoir un monde meilleur sans l’homme. Une sorte de continuation qui, poussée à l’extrême, peut être euphorisante. Ce sont les animalistes, un groupe anonyme, qui portent cette idéologie singulière dans le roman. Ce n’est pas une idée neuve : le vrai bonheur n’existerait que lorsque l’homme ne serait plus là pour le vivre.
H. P. : Vous vous intéressez au genre, populaire par excellence, du film catastrophe. Comment pensez-vous les littératures de genre, comme un détournement, une intégration, avec quelle distance ? Et tout ça a à voir avec la mémoire, y compris celle des formes…
X. M. : J’ai un rapport organique avec la culture populaire. Par hasard, j’ai rencontré Perec et une littérature plus exigeante que celle que je fréquentais et mes envies se sont portées sur des recherches de dispositifs, une littérature spécifiquement littéraire. Je me suis vite demandé ce que je devais faire de cette matière, de ces goûts éclectiques et disparates, de ce qui m’apparaît comme une double aspiration nullement contradictoire. Lorsque je décide de décrire un monde en ruine, cette mémoire culturelle populaire se réactive. À partir de là, j’évolue dans une sorte d’archipel de stéréotypes que je ne peux pas ne pas explorer. Il me faut alors décider de ce que je conserve, détourne, cherche… Il fallait que je fasse quelque chose de cette culture post-apocalyptique très américaine que je connaissais bien. Comment acclimater ces clichés-là, en premier lieu la figure du zombie, au paysage français le plus proche. Ce projet a immédiatement provoqué de la déviation.
H. P. : Il y a le stéréotype du zombie, avec sa dimension grotesque, qui fonctionne bien avec l’idée de transformation (des corps et des formes) qui est l’un des sujets majeurs du livre comme du genre anticipatif.
X. M. : Il y a, chez Romero, par exemple, une dimension de critique féroce de la société occidentale qui n’est pas présente dans d’autres films contemporains des siens et qui véhiculent une pensée plutôt réactionnaire, qui racontent l’histoire d’un retour au statu quo… Après être sorti de ses gonds, le monde y revient… J’aime l’idée que le partage d’une mémoire générique permet une économie de moyens dans l’écriture. Par exemple, dans le livre, le mot « zombie » n’est jamais prononcé, mais à la manière dont sont décrites les bêtes, la référence s’impose par une sorte d’implicite partagé. Ce qui m’intéresse, c’est la manière dont le genre dysfonctionne dans le livre. Lorsque je m’aperçois, en travaillant les stéréotypes, qu’il manque quelque chose. L’expérience de lecture qu’il m’intéresse de construire : comment ce livre peut être et ne pas être un film de zombie – on ne peut pas vraiment dire roman de zombies –, comment il peut être et ne pas être un film catastrophe. L’idée n’est pas simplement de mettre à distance le genre, mais aussi de prendre au sérieux le plaisir de la narration, de ne pas être exclusivement dans une réflexion métatextuelle.
H. P. : L’alternance temporelle qui structure le livre dit quelque chose de la manière dont se conçoit le futur. Tout est fini, mais qui prend en charge le passé ?
X. M. : On peut la prendre dans les deux sens. L’interprétation est totalement ouverte de ce point de vue.
H. P. : La morale est pourtant omniprésente dans le genre anticipatif. Dans Avant de disparaître, la radicalité, la politique, occupent une place centrale.
X. M. : Très tôt, dès le projet du livre, j’ai voulu m’interroger sur le monde qui finit en même temps qu’il s’anime d’une énergie portée par des gens qui espèrent, croient, et surtout qui voient dans le désastre un renouveau euphorique. Cette idée entre en écho avec ma lecture de L’Insurrection qui vient, ce livre sublime et grotesque, qui reprend à la fois la tradition rhétorique française et celle de la littérature révolutionnaire. Je me suis dit qu’il fallait faire un livre sur la fin et l’espoir en même temps, sur l’énergie de la colère. C’est là que ça devient compliqué parce que le livre sort au moment du mouvement des Indignés, que des gens en voient une figuration – on retombe sur la lecture métaphorique que je refuse de prendre en charge. Ce sont ces questions qu'il m'intéresse de déplier dans le livre, de travailler sans relâche.
H. P. : Dans cette dimension prospective du roman, vous intégrez des questionnements qui tordent nos sociétés. Vous utilisez ainsi la transformation, ces fameux zombies atteints d’altrisme, la maladie des autres. Il y a là une part de fantasmes et une réflexion sur l’animal et la nature.
X. M. : Je comprends au cours du travail la question qui me guide. Elle m’intéresse d’ailleurs plus que les réponses qu’on lui apporterait. La réponse n’a pas, je crois, sa place dans une œuvre de fiction. Je cherche à savoir ce qu’on fait de sa culpabilité, comment y survivre. Quand, pour vivre, il faut tuer quelqu’un, ou, pour être heureux, il faut en passer par le malheur de quelqu’un d’autre. Comment s’en défait-on ? Cette question hante notre histoire collective. L’altérité, dont vous laissez entendre qu’elle prend place dans cette dimension anticipative du récit, qui existe, je la place dans le contemporain. Si mon livre est contemporain, c’est par cette question de l’altérité et d’une alternative entre refus et acceptation que des personnages portent dans le roman. D’abord les animalistes, qui disent que les bêtes c’est le Bien, ce qui amènera la fin nécessaire de l’homme, et puis ceux qui conçoivent l’autre, de manière beaucoup plus reconnaissable, comme bouc émissaire, foyer de fantasmes. Or, ce qui me passionne dans la figure animale, c’est l’absence de langage, la question de l’incommunicable. Que fait-on de celui avec qui aucun dialogue n’est possible ? C’est une question forte, à laquelle je n’ai pas de réponse. Que fait-on du fou, du fanatique, du sénile, de l’animal… ? C’est ce que j’aime dans la morsure de la bête mourante quand Kaplan avance sa main. Elle le mord parce qu’elle est là pour mordre, qu’il n’y a pas d’autre projet. On ne sait même pas s’il s’agit d’un projet…
H. P. : On ne peut d’ailleurs pas trancher. L’intérêt, j’y reviens, n’est pas là, mais plutôt dans le processus formel qui nous permet de sortir de l’horreur de ce qui est montré pour pouvoir survivre.
X. M. : Pour se rendre supportable la catastrophe, il faut trouver les moyens pour la dire ?
H. P. : Oui. Mais vous ne le diriez pas comme ça.
X. M. : Non. Mais j’aime bien l’idée que vous ayez le dernier mot et pas moi.
Hugo Pradelle
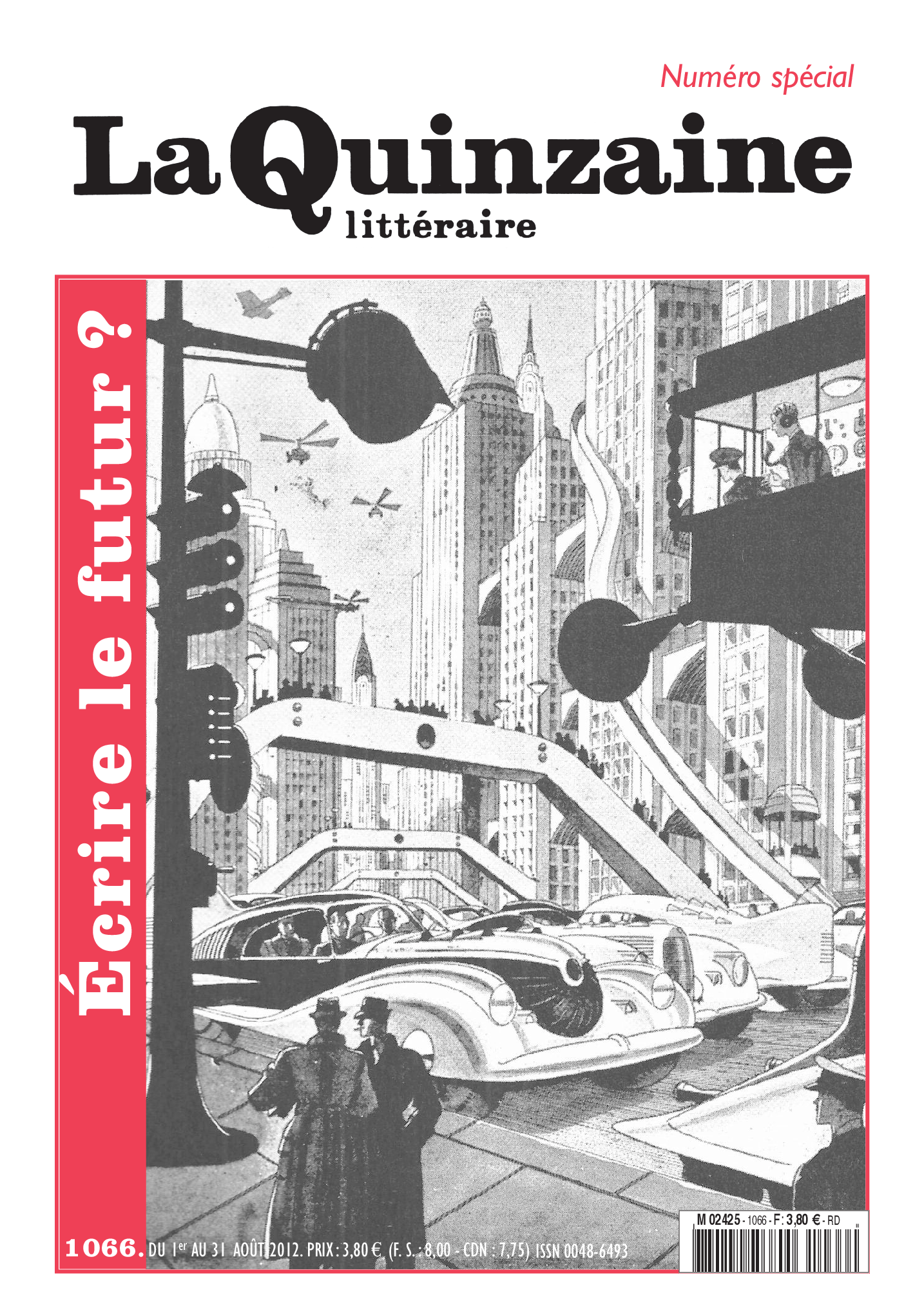

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)