Patricia De Pas : Aurélien Barrau, vous écrivez que les pouvoirs publics devraient déclarer l’« état d’urgence environnementale ». Quelle est la cause de cette urgence : l’extinction des espèces ou le dérèglement du climat ?
Aurélien Barrau : Le climat, en tant que tel, n’a pas beaucoup d’importance. Ce qui compte, ce sont en effet ses conséquences sur les vivants. Or, si l’élévation globale de la température est un bien un problème majeur – et chaque nouvelle étude montre qu’il est un peu plus grave que ce qui était jusqu’alors supposé –, il n’est qu’un élément parmi d’autres d’un drame beaucoup plus vaste. La vie est en train de péricliter sur Terre. Et il est essentiel de marteler que, même si le climat était parfaitement stable, nous serions quand même dans la sixième extinction massive. Aujourd’hui, le réchauffement global n’est pas la principale cause de disparition de la vie. Ce serait plutôt la fonte des espaces vierges, notre expansionnisme sans fin qui a réduit la nature au statut de ressource. Il ne peut y avoir d’avenir viable qu’avec une refonte radicale de tout notre système de valeurs. Diminuer les émissions de CO2 est certainement nécessaire mais pas suffisant, tant s’en faut.
Patricia De Pas : Cet expansionnisme est-il imputable à la croissance démographique ?
Aurélien Barrau : Certainement pas ! Il est évident qu’il serait préférable que nous soyons moins nombreux. Pour autant, la surfocalisation sur la démographie est une grave erreur.
D’abord, il s’agit une erreur morale, puisqu’elle laisse entendre que c’est aux pays pauvres n’ayant pas – ou peu – participé au désastre en cours qu’il conviendrait de faire des efforts !
Ensuite, il s’agit d’une double erreur scientifique. Premièrement, parce que nous avons de bonnes raisons de penser que la croissance démographique se stabilisera à partir de 2050. Au moins, qu’elle augmentera beaucoup moins rapidement. Deuxièmement, parce que la vision sous-jacente à l’incrimination « démographique » consiste toujours, d’une manière ou d’une autre, à supposer que cela sauve le monde en pérennisant la situation actuelle. Ce qui est, là encore, doublement erroné. Dans une première mesure, parce que si nous ne changeons pas le système, la croissance économique, quant à elle, ne fléchira pas. Endiguer la croissance démographique ne retarderait donc que marginalement les effets dévastateurs de notre manière d’habiter le monde. Et, dans une seconde mesure, parce qu’il est dramatique de confondre pérennité et légitimité. Actuellement 1 000 milliards d’animaux sont tués chaque année dans des conditions souvent atroces. Un enfant meurt de faim toutes les cinq secondes. Souhaite-t-on pérenniser ces tendances ? En divisant par deux la population sans changer notre mode d’être, nous diviserions (peut-être) par deux ces chiffres : le problème serait-il résolu ?
Patricia De Pas : Vous voulez dire que le modèle économique actuel encourage l’expansionnisme ?
Aurélien Barrau : Sans le moindre doute. Tout peut être discuté et loin de moi le désir de museler quiconque. Il est tout à fait normal de pouvoir lire ici et là des économistes qui, dans de longues tribunes, s’interrogent sur les moyens de relancer la croissance. Ils sont en droit d’écrire ce qu’ils veulent. Ce qui me choque, c’est qu’ils continuent de faire comme s’il allait de soi que la croissance soit désirable. Il me semble aujourd’hui être scientifiquement clair que la croissance économique des pays développés est la première cause d’effondrement de la vie sur Terre. Plutôt que de la nommer « croissance », si l’on utilisait le terme « prédation suicidaire », peut-être notre ressenti changerait-il… Il n’est plus, en tout cas, possible de faire comme si de rien n’était et de continuer à considérer que les valeurs éminemment mortifères de l’ancien monde doivent perdurer sans être interrogées.
Cela dit, le modèle économique n’est pas le seul responsable : des tropismes fondamentaux sont ici à l’œuvre. Se soucier du long terme échappe littéralement à ce pour quoi nous sommes « programmés », avec toutes les réserves de mise autour de ce terme. Il faudrait réussir à nous extraire d’un certain nombre de déterminations fondamentales, et ce n’est pas une mince affaire !
Patricia De Pas : Vous dites dans votre livre que le souci de l’avenir ne génère pas beaucoup de dopamine… Faut-il en déduire que l’humanité ne se décidera à agir que lorsqu’elle y sera contrainte par l’épuisement des ressources, autrement dit lorsqu’il y aura un intérêt vital à changer de modèle sociétal ?
Aurélien Barrau : Ce n’est même pas évident. On a vu des civilisations s’effondrer, alors qu’elles étaient prévenues de leur fin imminente. Je pense qu’il faut cesser de raisonner d’un point de vue binaire. La question n’est pas de « sauver le monde ». Il est bien trop tard pour que rien de grave n’ait été commis. Il n’est pas trop tard pour éviter que ce ne soit pis encore. La question, à mes yeux, consiste seulement à minimiser les souffrances à venir en tentant d’user de cette incitation forcée au changement pour explorer de nouveaux modes d’être, de nouveaux concepts, de nouveaux rapports à l’autre et à l’espace, de nouvelles ontologies.
Patricia De Pas : Vous faites allusion aux civilisations qui ont disparu. Vous pensez probablement à celles des Mayas ou de l’île de Pâques. Dans un discours récent, le Premier ministre Édouard Philippe a évoqué son inquiétude quant à notre avenir sur Terre. Il a fait référence au livre de Jared Diamond, "Effondrement. Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie" [1]. Mettre sur le même plan l’effondrement d’une civilisation et celui de l’humanité n’est-il pas un peu rapide ?
Aurélien Barrau : Moi, je ne parle pas d’une menace sur l’humanité. Je parle d’une menace sur des millions d’espèces qui comptent, pour certaines, des milliers de milliards d’individus. C’est beaucoup plus grave encore que la seule fin possible de l’humanité ! À laquelle je ne crois d’ailleurs pas vraiment : un petit nombre d’humains riches s’en sortiront toujours… On ne peut pas considérer tous les autres vivants comme de simples dommages collatéraux.
Mais pour revenir au fond de la question, je pense que la situation n’est pas si différente. La survie d’éventuelles autres ethnies importait sans doute peu aux Mayas : la fin de leur monde était la fin du monde. Et ils ne l’ont pas évité.
Nous avons déjà atteint un niveau d’atrocité qui dépasse l’entendement : 60 % des animaux sauvages ont disparu en quarante ans ; 94 % (en biomasse) des mammifères sur Terre sont de la viande d’abattage ; 25 % de la population humaine mondiale va manquer d’eau à court terme… On pourrait multiplier les chiffres à l’infini. Absolument tous les voyants sont au rouge vif, et ce n’est plus une crainte c’est déjà un bilan. Or, non seulement aucune révolution ne se profile, mais chaque année est pire que la précédente.
Patricia De Pas : On se demande bien sûr à quoi pourrait ressembler l’humanité sur une planète dont la richesse se serait tarie. Certains imaginent un monde de cyborgs sur une Terre dévastée…
Aurélien Barrau : C’est bien le point en effet ! Supposons – et je n’y crois pas une seconde – qu’une supertechnologie permette d’élaborer de gigantesques absorbeurs de CO2 que nous installerions en lieu et place des forêts, de gigantesques épurateurs d’eau que nous installerions en lieu et place des lacs, de gigantesques zones mécanisées de géo-ingénierie que nous installerions en lieu et place des prairies, serait-ce le monde que nous voulons ? Voilà la question ! Je ne crois pas du tout au miracle technologique qui permettrait aux humains de continuer à vivre aussi vieux et aussi nombreux. Rien ne le laisse rationnellement entrevoir et cette croyance relève d’un pari assez fou. Mais, quand bien même il aurait lieu, cette vie dans un monde dévasté et bétonné, vidé de diversité et amputé de sa beauté, aurait-elle un sens ?
Patricia De Pas : Je voudrais revenir sur l’expansionnisme humain. En quoi est-il responsable de l’extinction des espèces ?
Aurélien Barrau : Pour une raison très simple : la première cause d’effondrement de la vie, à ce stade, ce n’est pas le réchauffement climatique ; c’est le fait que les vivants non humains n’ont plus de lieu pour vivre ! Nous nous sommes tellement approprié les espaces naturels que les animaux finissent par mourir, faute d’habitat.
Patricia De Pas : Est-ce la seule raison ? Pourquoi, par exemple, les oiseaux et les abeilles sont-ils également concernés par cette extinction ?
Aurélien Barrau : Naturellement, il y a beaucoup d’autres raisons. En ce qui concerne les oiseaux et les insectes, les pesticides jouent un rôle majeur. Rien qu’aux États-Unis, on estime qu’ils tuent 62 millions d’oiseaux par an, c’est une catastrophe.
Ce qui me semble essentiel dans ces circonstances, c’est de bien comprendre que la « solution » ne peut pas venir d’une éventuelle trouvaille technologique. C’est tout notre être-au-monde qui, aujourd’hui, contribue à réifier la vie. Le plus urgent, c’est précisément d’oser penser hors de l’ordre établi. Le récent soulèvement des forces de réaction tente de museler le frétillement d’une prise de conscience. C’est absolument incroyable…
Patricia De Pas : Quel soulèvement ?
Aurélien Barrau : Il n’est plus aujourd’hui possible de douter de la catastrophe en cours, qui est scientifiquement actée. Mais, plutôt que de travailler à l’élaboration de stratégies vertueuses et réconfortantes, nous assistons à une incroyable levée de boucliers des forces de réaction, qui sont littéralement prêtes à tout pour ne renoncer à rien de leur confort. Ne pouvant plus traiter les lanceurs d’alerte de doux dingues — et pour cause, le drame est incontestable —, ils changent leur fusil d’épaule et les traitent de dictateurs en puissance, s’adonnant aux tentatives les plus invraisemblables pour les discréditer. Aucune calomnie, aucun mensonge éhonté ne nous est épargné. D’un certain point de vue, c’est bon signe : ils paniquent, ils perdent les pédales, ils vrillent littéralement. Mais ça demeure triste : même face à cette possible fin du monde, il n’y aura donc aucune dignité.
Je crois qu’il est urgent de ne plus réagir aux délires écolo-phobiques. C’est parfois drôle, parfois tragique. Mais nous avons un travail plus important à mener que de nous focaliser sur quelques provocations qui ridiculisent d’elles-mêmes leurs auteurs.
Patricia De Pas : Vous avez été violemment pris à partie sur Twitter. Est-ce la raison pour laquelle vous avez choisi d’y fermer votre compte ?
Aurélien Barrau : J’ai été conspué par les uns, presque divinisé par les autres. Tout cela est ridicule et n’a aucune importance. Ce n’est pas le lanceur d’alerte qui importe, c’est l’alerte elle-même. Quant à Twitter, c’est en effet à peu près ce que j’ai vu de pire : règne du clash, du mensonge et de la caricature. La pensée en 280 caractères est la négation de la pensée.
[1]. Jared Diamond, Effondrement. Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie, trad. de l’anglais par Agnès Botz et Jean-Luc Fidel, Gallimard, coll. « NRF essais », 2006.
Patricia De Pas
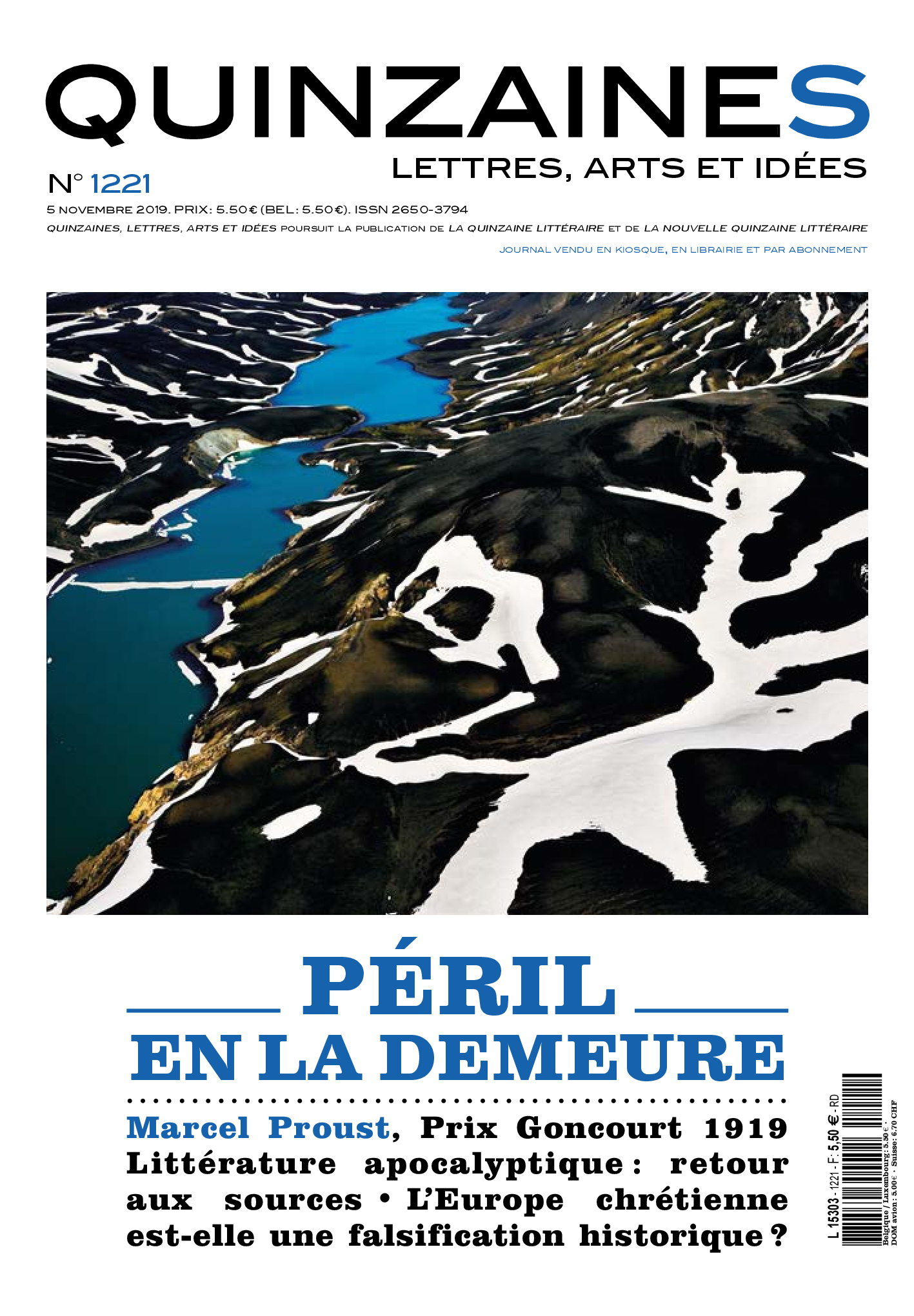

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)