Notre connaissance du jésuite allemand très célèbre en son temps date de la place que lui donnait Jurgis Baltrušaitis dans La Quête d’Isis, troisième volume des « perspectives dépravées », après Aberrations et Anamorphoses. Ces livres ont modifié notre regard sur les formes, les mythes, voire le langage. Étaient pris en compte les doubles fonds, les mouvements souterrains, les apparentements cachés. Ces perspectives « dépravées » ont fait entrer « les légendes des formes dans le domaine visionnaire et les légendes du mythe dans le domaine de l’esprit. Elles relèvent toutes d’un même mécanisme raisonné et poétique ».
Joscelyn Godwin, dans ce nouveau livre, initie le lecteur et le regardeur à un dessein égal à son objet, sauf, me semble-t-il, le privilège donné à la vérification du savoir, aux dépens de l’attention à la « poésie ». Et pourtant il nous fait contemporain, d’esprit et de regard, de l’ambition d’un homme qui fut à la fois l’un des grands érudits de son temps et des plus imaginatifs – l’un et l’autre jusqu’au délire, de l’interprétation, et de la construction.
Il explore le monde des choses visibles, la promptitude de l’écureuil, les taches du soleil, scrutées au télescope. Il tire de ces taches solaires des images qui s’offrent au regard comme des compositions abstraites, mais dont il révèle la face cachée, un tourbillon où se rencontrent et s’affrontent le solide et le liquide. Il n’y a pas, pour Kircher de choses du visible qui ne puissent entrer en correspondance avec un autre élément de la nature.
Douze chapitres, douze portes donnent ici accès à cette œuvre dont, en 1646, il révèle le système, comme Raymond Roussel en 1935, après sa mort, accompagnait sa déclaration « chez moi l’imagination est tout » de la révélation du procédé qui sous-entendait ses récits. C’est l’Ars magna lucis et umbrae (Le Grand Art de la lumière et de l’ombre) où les mots sous les mots et les images en réflexion avec les mots, font affleurer un Monde souterrain (Mundus subterraneus), nous ouvrent des territoires inconnus nés de l’imagination combinatoire. Vingt mille lieues sous les mots, est le titre donné par Annie Lebrun à son pénétrant ouvrage sur Roussel (Pauvert, 1994).
Quatre siècles avant Kircher le Majorquin, Ramon Llull, (la lumière, sobriquet de Ramon Amat), dit « le savant illuminé », avait conçu d’écrire, en catalan, un projet dicté par Dieu : écrire un livre qui fût le meilleur du monde. Son Grand Art, lui le premier, à l’utiliser entier, englobe « forme et manière ».
Dans les ouvrages de Kircher les images, auxquelles il donne le plus grand soin, qu’elles fussent de lui ou commandées par lui à de grands artistes, font passer de la lumière à l’ombre et vice versa. L’on pense aux commandes de Roussel à Zo pour le texte en images (et non l’illustration) des Nouvelles Impressions d’Afrique. La lumière et l’ombre composent dans les images-textes de Kircher une unité neuve, souvent abrupte, résistant au déchiffrement, à la lecture. Les frontispices des livres introduisent aux thèmes qui y sont développés, à la façon de s’en saisir au défaut de l’écriture alignée.
Les figures sont composites. Elles donnent leur part à l’impossible, elles dévoilent des rencontres indicibles. Sur la page d’en face, le texte nourrit sa linéarité des compositions qui, jusqu’à la démesure dans les rapports de toutes sortes, viennent suppléer aux catégories où les langues sont enfermées.
Avec frénésie, Kircher, l’arpenteur de tous les horizons, de tous les savoirs, s’emploie à en maîtriser le plus grand nombre : le grec, le latin, l’hébreu, le copte, l’arabe, le syrique, le chinois, etc. Après L’Arche de Noé, inventaire des animaux, réels ou imaginés, il publie La Tour de Babel. Sur la base du tableau de Breughel il bâtit sa tour. On ne saurait la décrire, tant les éléments qui la composent sont rebelles à la transposition de quelque langue que ce soit. Le plus scriptible serait, au bord de la gravure, l’architecte qui contemple ou vérifie l’édifice. Un édifice composite : la tour elle-même, celle de l’histoire de l’art, mais cernée de chemins qui ne mènent nulle part, et dressés parmi des édifices de tous styles et de toutes civilisations les églises romaines, les obélisques, les pyramides. La synthèse n’en pourrait se faire, un sens apparaître, que sur la feuille de l’architecte, dans sa loge, « regardeur » de ce théâtre baroque.
Kircher, à Rome où il demeura trente ans, fut l’ami de Bernin qui mourut le même jour que lui. Ces vues de Rome semées dans la plaine auprès de la Tour de Babel étaient censées répondre à la phrase écrite en haut de la Tour : « Faisons une ville et une tour qui s’élèvent jusqu’au ciel ». Que serait-il arrivé si les bâtisseurs avaient atteint leur but ? Kircher, le savant polyglotte, l’envisage. Mais l’auteur de notre livre reprend avec jubilation le jugement d’une commentateur récent pour qui il y avait de la « pataphysique » dans les réflexions de Kircher.
L’architecte et nous aussi sommes des « regardeurs » selon le mot de Duchamp. Et les mots et les images composés par Kircher sont, toujours selon les mots de Duchamp, en « renvoi miroirique ». Les machines de Kircher et celles de Duchamp ont des liens de parenté. Parentes aussi les perspectives – disons dépravées –, la distinction entre « apparence » et « apparition ». Une formule comme « le scribisme illuminatoresque dans la peinture » pourrait être de Kircher. Mais après l’invention des « signes-étalons », « représentant des relations inexprimables par les formes alphabétiques concrètes des langues présentes et à venir », Duchamp conclut à la défaite de l’ambition : « Cet alphabet ne convient qu’à l’écriture de ce tableau très probablement. » La Tour de Babel de Kircher dit la même chose, en images.
Son attention la plus constante porte sur les hiéroglyphes. L’Égypte est son lieu d’observation, de réflexion, de composition le plus cher. Une Égypte réelle, ou une Égypte devenue une pièce maîtresse de son langage figuré. Elle est présente dans La Chine illustrée, son grand ouvrage sur la Chine où ses supérieurs de la Compagnie de Jésus l’empêchent de se rendre craignant que leur savant confrère ne soit pour les Chinois un martyr tout désigné. Sa réflexion sur la Chine n’en est pas arrêtée pour autant, puisque « les Chinois anciens descendaient des Égyptiens, desquels provenait leur système d’écriture ». Sur l’Égypte repose le Grand Art de Kircher. Les monuments de tous horizons sont traduits en pyramides, en obélisques par l’auteur d’Œdipus Ægypticus.
Au-delà de l’Égypte, l’œuvre immense du jésuite allemand représente une avancée vers une Polygrapha nova, où le visible et le lisible se joignent et se répondent comme la lumière et l’ombre.
Georges Raillard
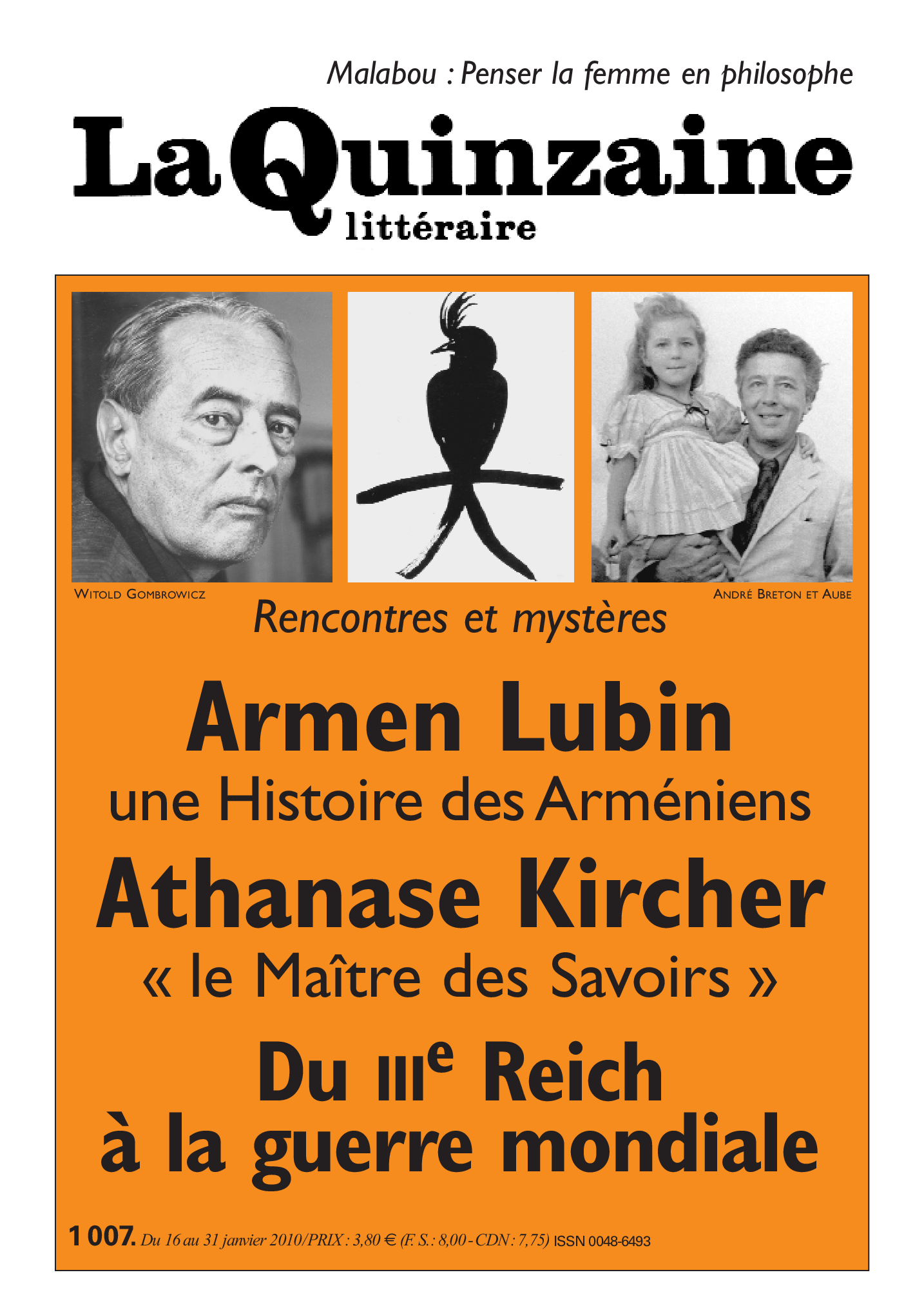

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)