La pensée d’Hannah Arendt n’est pas univoque lorsqu’il s’agit du contenu de l’action politique. En s’attardant sur sa théorie du « jugement de goût », on peut néanmoins dessiner les contours d’un modèle concret : la démocratie culturelle.
On reproche souvent à Hannah Arendt une vision élitiste du politique. Au niveau conceptuel, c’est principalement en raison du fait que l’action, qui est l’activité politique pour la penseuse, est sans contenu précis, puisqu’elle se caractérise par sa capacité à créer de la nouveauté. Sa lecture passionnée des auteurs antiques ne l’a pas aidée à être plus concrète : déjà chez Aristote, la politique est moins une affaire pratique qu’une forme de vie, idéalement incarnée dans l’amitié et protégée des enjeux prosaïques qui remettraient en question la priorité de la relation sur le faire. Arendt aurait pareillement fait de la politique le privilège des quelques-uns dotés des moyens de consacrer leur vie à la discussion éclairée entre pairs, seuls à même de cultiver l’unicité de leur humanité, car non soumis à des impératifs matériels.
Une théorie politique inachevée
Il serait naïf de croire qu’Arendt, qui a évolué dans les cercles restreints des meilleures institutions américaines, soit restée imperméable à la forme-université, dont la sociologie la plus élémentaire a montré le caractère inégalitaire. Néanmoins, il y a peut-être une cause plus simplement pragmatique à l’absence de description univoque, chez Arendt, de ce que signifierait s’engager politiquement : son décès inopiné.
Durant les années 1960-70, donc à la fin de sa vie, une thématique traverse ses écrits et interventions : le jugement. Ce terme lui vient d’Emmanuel Kant (1724-1804) et de sa Critique de la faculté de juger (1790) où il est notamment question du « jugement de goût ». Arendt consacra un séminaire à la notion, publié de façon posthume sous le titre Cours sur la philosophie politique de Kant, matrice du volume conclusif, jamais rédigé, de sa trilogie sur la vie de l’esprit. La coïncidence a, sur le plan de l’histoire des idées, quelque chose de tragique : ces leçons devaient donner une formulation concrète à la pensée politique de Kant, qui n’est nulle part explicite, et ouvrir – c’est notre hypothèse – sur une clarification de la pensée politique d’Arendt. Nous voici donc assignés à la tâche que la penseuse s’était elle-même donnée : envisager une théorie politique sur la base d’une théorie du jugement de goût.
Juger ensemble le commun
La principale raison pour laquelle Arendt s’intéresse au jugement de goût est sa communicabilité. Le jugement de goût, notamment à l’égard des beaux objets, suppose une « publicité » : la présence d’autrui. L’autrice justifie cela assez simplement en précisant que le plaisir – qui est le thème majeur du jugement de goût – est intensifié lorsqu’il est partagé. On désire échanger une opinion sur un film apprécié afin d’obtenir une confirmation, et partant une amplification, de notre jouissance. De façon plus étonnante, Arendt estime que c’est à travers la publicité – le fait d’être au centre d’une délibération – que l’objet vient à l’existence. « Le jugement du spectateur crée l’espace sans lequel [les beaux objets] ne pourraient pas même apparaître », affirme-t-elle. Il n’y a, chez Arendt, de monde humain que dans le commun. Kant estimait d’ailleurs que la liberté de penser n’est rien sans la liberté de communiquer. Comment savoir, sans être compris par autrui, si nous pensons correctement, ou si la réalité est bien telle qu’on l’entrevoit ?
Le jugement de goût devient dès lors l’activité par laquelle un monde partagé se constitue. Ceci en fait une pratique politique ; il organise ce qui nous entoure, puisqu’il tranche sur ce qui est visible ou non. De surcroît, juger en matière de goût, ce n’est pas uniquement rendre l’objet digne d’intérêt, et par conséquent le faire apparaître publiquement ; c’est anticiper ce que ressentent les autres, soumettre ses propres impressions à la discussion et potentiellement changer d’opinion. Arendt est étonnamment claire à ce propos : « l’activité du goût décide comment voir et entendre ce monde ». Autrement dit : lorsqu’on juge, on met en question le sensible. On interroge le goût immédiat, qui s’impose nécessairement, en le plaçant à distance par le jeu de la discussion.
Interroger le sens commun
Arendt conclut ses cours sur Kant en indiquant que l’objet définitif sur lequel porte le jugement de goût n’est pas tant l’artéfact tangible comme l’est l’œuvre d’art mais le jugement lui-même. Le jugement qui procure potentiellement le plus de plaisir survient lorsqu’on évalue nos propres intuitions. On peut songer à la satisfaction éprouvée lorsqu’on constate, à propos d’une hypothèse, qu’on avait raison. Or le système des jugements de goûts partagés a pour nom le sens commun. Il s’agit, pour le dire rapidement, de l’ensemble des jugements tels qu’ils sont professés par l’intermédiaire, non pas des individus seuls, mais du collectif. Le sens commun intervient lorsque nous jugeons au nom de ce que tout le monde dirait, nous soumettant dès lors à la contrainte de l’universel. Puisque le jugement final, nous l’avons vu, est celui sur le jugement, la communauté qui évalue son propre sens commun est une communauté qui se demande si elle juge adéquatement le monde, ce qui est peut-être le sommet de l’inquiétude politique pour Arendt.
Le sens commun n’est pas, à ce titre, un refuge conservateur, mais jouit d’une profonde contingence. D’une part, il est remis en jeu au gré des jugements de goûts émis constamment par les individus, qui redéfinissent les contours du visible. D’autre part, le sens commun est subordonné à une communauté plus large, celle de l’humanité. Arendt, encore : « quelqu’un juge toujours comme le membre d’une communauté, guidé par [...] son sensus communis. Mais en dernière instance, ce quelqu’un est un membre d’une communauté mondiale par le simple fait d’être un être humain ». À ce titre, le jugement qui est le plus digne d’être posé est celui qui prend en considération la situation de toutes les subjectivités terrestres. C’est toute l’importance de l’hospitalité chez Kant : plus un jugement est communicable, plus universelle en est l’approbation, plus il est valide. Une telle épistémologie réclame une empathie radicale et revêt une actualité particulière à l’heure où nous cherchons globalement un rapport renouvelé à la nature pour sortir de l’impasse écologique.
La démocratie culturelle
Voici peut-être une clé afin de spéculer sur le contenu de l’action politique arendtienne. La proposition d’Arendt, basée sur le jugement de goût, serait une « démocratie culturelle », puisqu’elle qualifiait elle-même le jugement d’« activité culturelle ». La démocratie culturelle consiste à se saisir, dans le jugement collectif, du devenir de nos goûts et dégoûts. Ceci a pour effet d’étendre le champ de l’engagement politique à toute renégociation du sensible, et ce notamment au domaine de l’art, qui remet de fait constamment nos goûts en question. Aujourd’hui, on constate, sous l’angle de la démocratie culturelle, qu’on ne peut plus laisser impunément la société s’atomiser face aux plateformes et s’étonner à chaque élection que des rapports au monde délétères refassent surface : misogynie, fascination pour la force, racisme. Le goût entraîné par la consommation automatique des contenus réactionnaires se soustrait totalement à l’exercice du jugement, car il n’est jamais remis en cause et prend en considération uniquement le groupe des profils semblables. On n’accusera pourtant pas aussi facilement l’homme seul face à l’écran de s’abrutir, car sa solitude vint aussi, en première instance, du refus de quelques-uns de prendre en considération le goût des autres.
[Jean-Baptiste Ghins est diplômé en philosophie de la KULeuven (Belgique) et de l’ENS de Paris. Il est actuellement doctorant en philosophie contemporaine à l’UCLouvain et membre de la chaire « Valeurs et politiques des informations personnelles » (Institut Mines-Télécom). Ses recherches concernent principalement la relation entre esthétique et politique telle qu'elle se matérialise dans les industries culturelles numériques.]
Jean-Baptiste Ghins
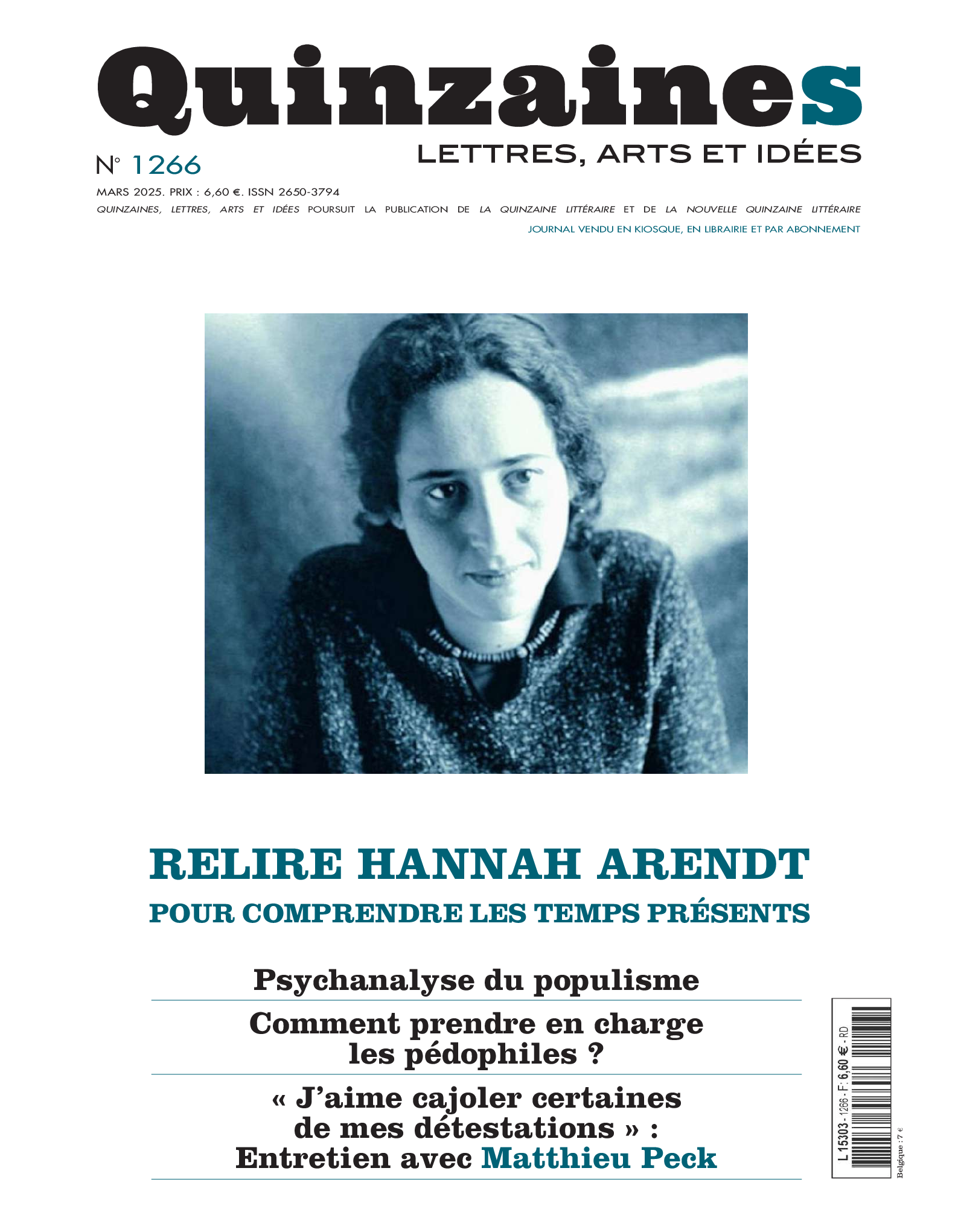
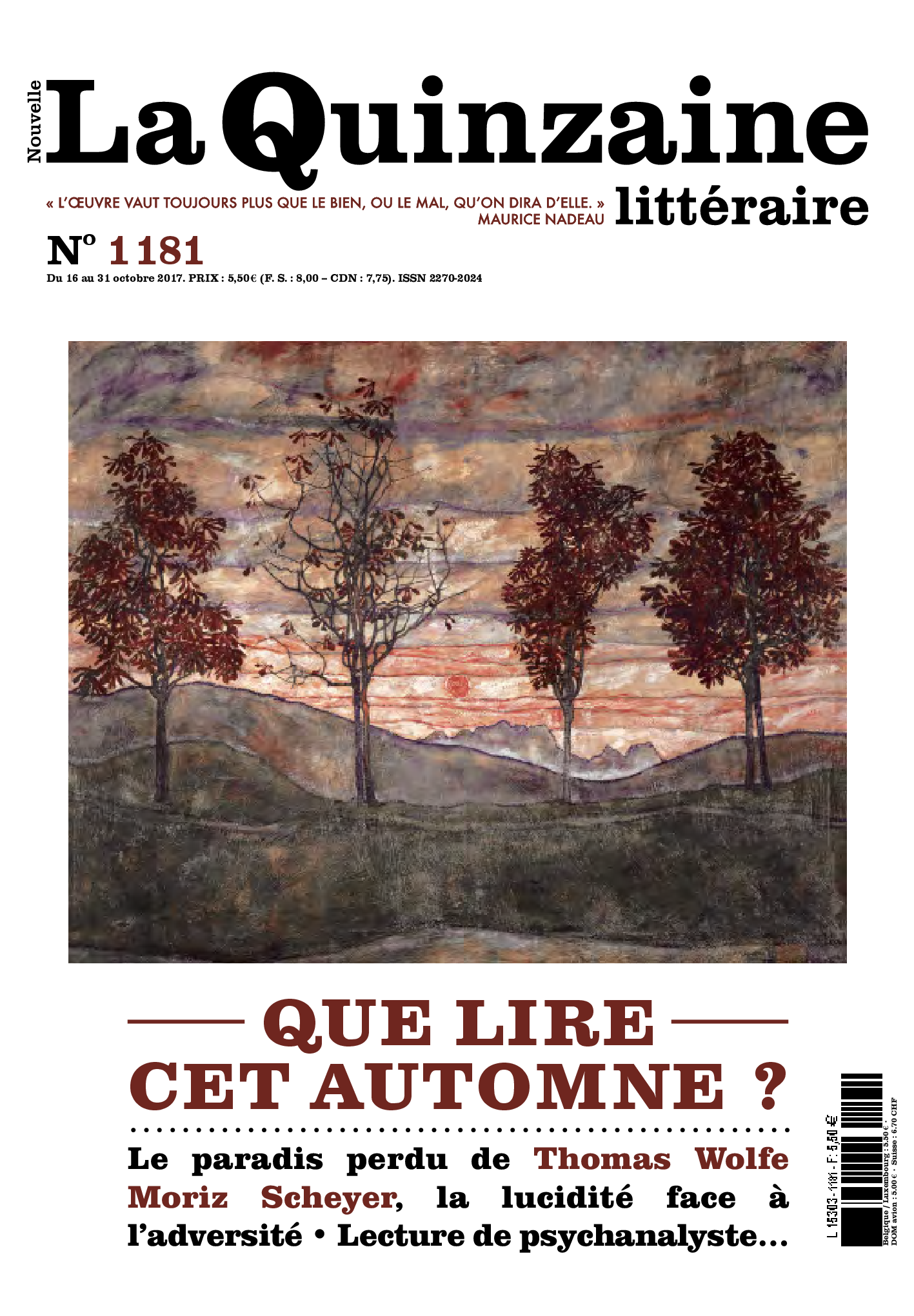
Commentaires (identifiez-vous pour commenter)