La rentrée cinématographique est là, d’autant plus présente qu’il n’y a plus de pause dans l’exploitation : à l’image des étés précédents, la distribution n’a pas connu de mortes-eaux. Dès le début du mois d’août, Claude Miller a ouvert le bal des cinéastes réputés avec Voyez comme ils dansent, invitation mal suivie par les spectateurs, d’ailleurs peu encouragés par une critique dont on s’explique mal les raisons qui l’ont fait renâcler devant les derniers titres d’un réalisateur longtemps célébré et qui ne démérite pourtant en rien. Il ose multiplier les points de vue, joue avec la chronologie, déroule sans prévenir quelques retours arrière – il y avait là de quoi déstabiliser un public habitué à la narration linéaire désormais dominante. Miller a pourtant signé son film le plus formellement audacieux depuis longtemps et le plus attachant : Maya Sansa est aussi troublante que dans ses rôles italiens et Marina Hands parvient même à faire passer quelques sentiments sur l’écran. Mais le public a toujours raison – on peut parfois le regretter.
Comme on peut regretter qu’il n’ait pas réservé à Melancholia l’accueil que ce chef-d’œuvre réclamait – nous le disons avec d’autant plus de force que les films de Lars von Trier ne nous arrachent pas d’ordinaire des sanglots d’admiration, bien au contraire. Quelques dizaines de milliers de sièges furent occupés durant la première semaine, certes, mais le compte n’y est pas, eu égard à la richesse de l’œuvre. Faut-il y voir la résultante des déclarations confondantes proférées à Cannes par le cinéaste, pourtant déjà bien oubliées ? Ou un manque d’appétence estivale pour aller savourer les derniers soubresauts d’un monde qui s’éteint ? Melancholia réussit pourtant à faire ressentir, profondément, l’inéluctable, ce qui n’est pas si courant. L’auteur, débarrassé des artifices tape-à-l’œil dont son précédent Anti-Christ dressait le catalogue, a trouvé la mesure et la tonalité qui convenaient à cette valse mortelle au bord du gouffre. Le propos n’était peut-être pas de saison, entre austérité, ouragan Irène et guerre civile lybienne, mais s’il faut que la Terre soit calmée pour apprécier un film qui pense un peu au-dessus de Captain America ou de Harry Potter, la route risque d’être longue.
Quant à La piel que habito, de Pedro Almodovar, nous continuons à balancer entre l’admiration devant la facture, glacée mais impeccable, et déception devant le sujet, digne des « nanars » de Jesus Franco. Tout était dans le roman original, Mygale, mais ce que l’écriture experte de Thierry Jonquet faisait passer peine à franchir l’écran. Il manque à cette vision qui mêle Frankenstein, L’Ève future et autres folies scientifiques, le petit rien dans le décalage, un sourire, une mise à distance, qui permettraient d’accepter l’énormité du postulat – créer une femme (superbe) à partir d’un homme. Entre bricolage rigolard et démesure inspirée, Almodovar a choisi la voie médiane, descriptive et impersonnelle. Ce qui n’enlève rien à la qualité visuelle de son film, mais on peut raisonnablement attendre plus de lui, en souvenir de ses anciennes réussites divaguantes.
Nous ne romprons pas de lances pour défendre les deux autres productions françaises de la mi-août, Impardonnables (André Téchiné) et Les Bien-aimés (Christophe Honoré). Le premier, parce que, par-delà l’agrément de Venise – ville qui nous a fait frémir devant bien d’autres titres sans noblesse (et jusque devant la série télévisée du commissaire Brunetti) –, le roman d’amour et de mystère entre un écrivain et une agente immobilière qu’il nous conte n’a d’intérêt qu’anecdotique. Le second, parce que les limites du système Honoré, coqueluche du petit monde, y apparaissent pleinement : un scénario ambitieux (à la Lelouch jadis : trente ans d’amours entrelacées d’Histoire européenne) mais bâclé, des recettes immuables – une dose de drame, une dose de chansonnettes sussurées, une dose de miel pour lier le tout – mises en œuvre par une troupe d’acteurs ligotés par la répétitivité de leurs rôles. Les distributeurs automatiques d’éloges ont eu quelques difficultés à se mettre en marche, ce qui laisse peut-être augurer d’une remise à un niveau plus juste de la réception de ce jeune homme très actif.
Les épithètes superlatives ont toutes été réservées (il ne manque que « génial ») à La guerre est déclarée de Valérie Donzelli. Le film avait déjà fait impression à Cannes (Semaine de la Critique), sa transplantation parisienne s’est accompagnée du même fracas critique et d’un accueil public à la mesure. On sait surabondamment que cette histoire de parents d’un enfant atteint d’une tumeur au cerveau est réelle, puisque les acteurs du film, la réalisatrice elle-même et Jérémie Elkaïm, l’ont vécue. Reconnaître un manque d’empathie pour ce drame serait faire preuve d’une sécheresse de cœur condamnable – prière de s’incliner devant la douleur humaine ! Mais cette douleur, qu’on imagine véritable, nous semble recréée avec trop d’affèteries, de « mise en scène » au sens propre, d’effets tire-émotion. Le projet même d’afficher cette expérience intime dramatique, par ailleurs heureusement conclue, est douteux – on tremble pour eux et pour l’enfant, mais, ouf, tout se termine bien. Quelle morale en tirer ? Avertir les parents frappés d’un tel malheur que le Bien peut arriver ? Un peu court. Nous sommes loin du magnifique Petit prince a dit, de Christine Pascal, autrement plus touchant sur un argument similaire, et d’un autre film cannois, Arrêt en pleine voie, de l’Allemand Andreas Dresen, dans lequel le cancer du cerveau du héros n’est pas prétexte à jolies images émouvantes, mais au spectacle de la douleur et de la mort, sales et sans recours. Sur le plan du filmage, La guerre a au moins le mérite de nous ramener quatre décennies en arrière, la rencontre des héros et leur romance sur fond de cartes postales parisiennes étant ce que l’on a vu de plus kitsch cette année. Par ailleurs, le public a toujours raison, cf. supra.
En attendant le 21 décembre, date de sortie du dernier film cannois important, Le Havre, d’Aki Kaurismaki, notre Palme d’or privée, l’exceptionnelle cuvée 2011 va continuer à alimenter les salles de l’automne. Dès la fin septembre, We Need to Talk about Kevin, de Lynne Ramsay, injustement oublié lors du palmarès, va nous prouver que la maternité n’est pas la plus belle chose au monde, surtout lorsque, du nourrisson à l’adolescent, le produit est l’incarnation du Mal absolu. La cinéaste justifie tous les espoirs contenus dans ses premiers films déjà anciens, Ratcatcher (1999) et Morvern Callar (2002). À l’égal de Nicolas Winding Refn, dont Drive (Prix de la mise en scène, sortie le 5 octobre) ne fait que confirmer la certitude qui est la nôtre qu’il s’agit d’un auteur de la grande espèce – la trilogie Pusher le laissait pressentir, la vision récente de Bronson (2008) et de Vallalha Rising (2009) l’installe parmi notre peloton de visionnaires scandinaves choisis, Roy Andersson, Bent Hamer et autres Baltasar Kormakur.
Et n’oublions pas Nanni Moretti, qui fait l’objet d’une rétrospective à la Cinémathèque française (6 au 28 septembre), à l’occasion de la sortie d’Habemus Papam – encore un oubli du jury cannois, ébloui par les pétards lancés par Terrence Malick –, réjouissant apologue (ou parabole réjouissante, au choix) sur les coulisses vaticanes, qui nous console de l’envahissant jamboree espagnol des JMJ qui a parasité il y a peu nos écrans. Michel Piccoli, en futur pontife inquiet, découvrant, le temps d’une fugue, le petit peuple romain, tandis que Moretti, psychanalyste de service, transforme la Curie en championnat de volley-ball, constitue un de nos plus savoureux souvenirs de la Croisette. Souhaitons que le public suive ce chemin de traverse.
P.-S. Ressort en salle, le 7 septembre, Alice (1988) de Jan Svankmajer, assurément la plus belle et la plus inventive de toutes les adaptations de Lewis Carroll. Par ailleurs, le British Film Institute vient d’éditer un coffret de 3 DVD reprenant les 26 courts métrages tournés par le cinéaste surréaliste tchèque, entre 1964 et 1992 (dont des titres éblouissants comme Jabberwocky et Les Possibilités du dialogue). Prière de ne pas manquer…
Lucien Logette
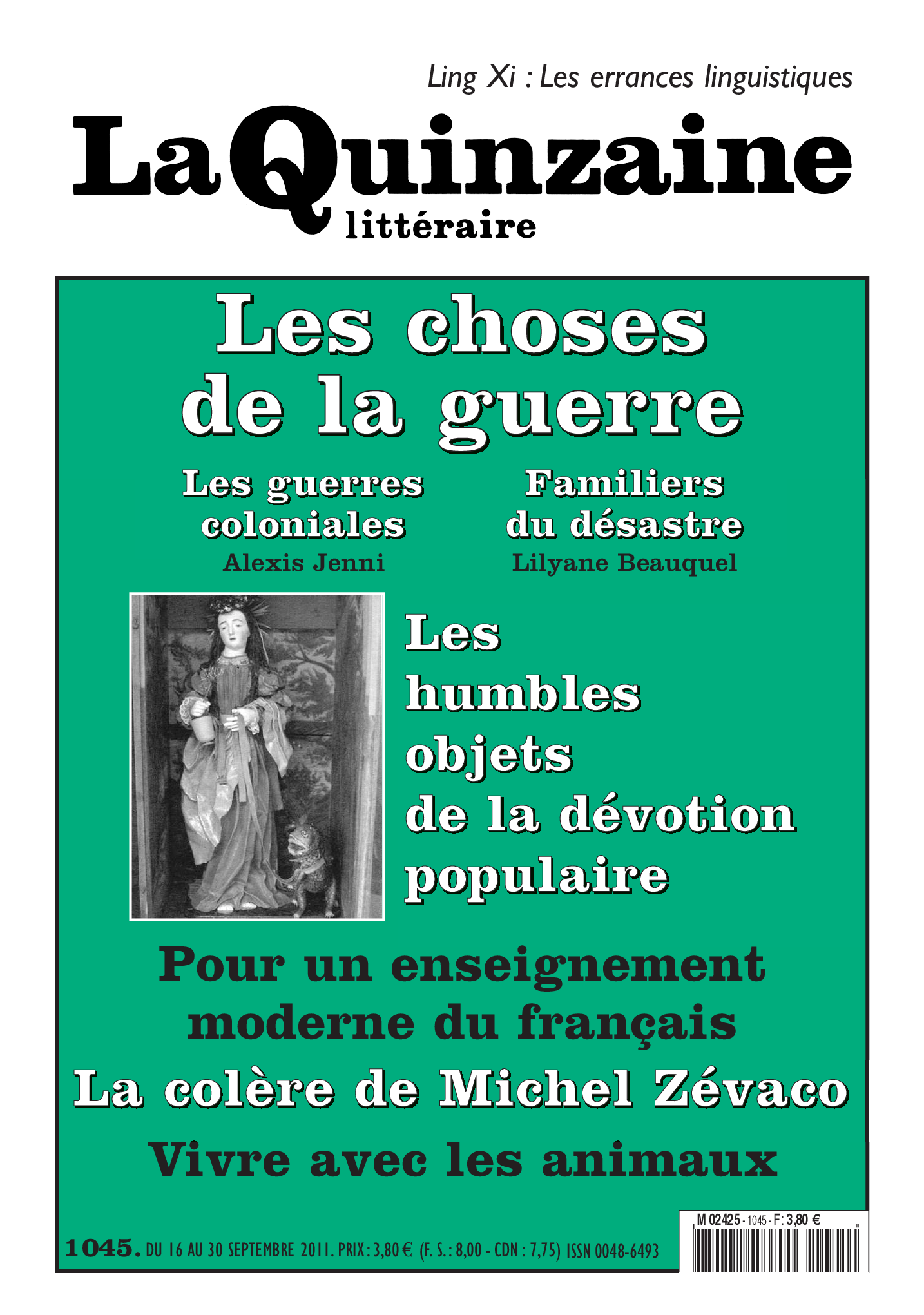

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)