On avait déjà croisé Emmanuel Godo, avec plaisir, du côté prolifique de l’essai littéraire : sur Barrès, dont il est spécialiste, sur Nerval, sur Duras, sur Hugo, sur Huysmans, Claudel ou Léon Bloy[1] ; on avait apprécié son bel essai érudit et tonique sur la conversation[2], suivi ses conférences toujours précises et passionnées, découvert un premier récit rêveur[3] et un journal sur la passion littéraire[4], entendu aussi une pensée spirituelle, dans tous les sens que l’on voudra.
On s’attendait donc assez peu à ce qu’il envoie ce signal en vers, issu pourtant d’une pratique ancienne, depuis le territoire du chant et du poème, « un feu / imprévisible / et doux » venu « de l’autre côté » du monde.La conversation continue ici avec soi, sous la forme d’un journal puis de poèmes épars, liés entre eux par l’onde de sensations qui se concentrent sur l’assomption des deuils, des fins, des paysages intérieurs refoulés et enfin contemplés, sans peur, ou avec moins de peur : « Je suis heureux comme l’homme / Qui n’a plus peur que son amour se perde ». La parole s’attache à certaines stations concrètes d’une réconciliation, mais aussi à d’autres moments rêvés, qu’il faut décrypter, accompagner de cette empathie que déclenchent le murmure discret des confessions, le choc lent des consolations, le langage des tristesses diffuses.
Du mètre irrégulièrement régulier du vers – où se libère ici et là un verset très claudélien, mais aussi, plus surprenant, aragonien – émane une tonalité douce, traversée de douleurs fulgurantes aussitôt absorbées, avec des vers pudiques comme des vagues retirées. La parole prend soin du monde et laisse proliférer les allusions au bonheur, à la solitude, aux « fraternités de terrier », à la ferveur, au désarroi. À la manière d’une marche – fortement thématisée dans ce recueil au titre antinomique –, le journal poétique acte les pas et les marques d’un pèlerinage, d’une ascension, d’un dépassement, très rousseauiste, circulaire et contradictoire (« Tout plutôt que rester immobile sur le chemin de mort »), où s’affirme aussi parfois une naïveté métaphorique volontaire, qui n’est pas sans efficacité : « Sur le chemin qui mène en haut / Il y a des failles / On peut tomber en soi-même / Et disparaître », ou encore : « L’oiseau pas plus gros qu’une fleur / Lance à qui veut l’entendre sa joie d’être là ».
L’univers qui apparaît dans cette douceur méditative cristallise une écriture singulière du temps émotionnel, d’abord concentré dans un micro-journal de quelques poèmes (2009-2014), puis diffracté en plusieurs moments ou recueils internes plus anciens : « Qui est le vivant ? », « Le sac à poèmes (1980-2000) », « Lumière d’éclipse », « Je n’ai jamais voyagé », « Le pays de la mémoire », « Le pain le soir ».La plupart des poèmes sont instants d’épiphanies où la force de l’aveu et de la découverte rejoint l’initiation à soi : « Ne laissez jamais personne / Écrire à votre place / Le poème de votre vie ».
Conseils aux jeunes vivants, aux jeunes poètes peut-être, Je n’ai jamais voyagé avance justement, sur le plan moral, contre l’immobilité et la passivité de l’âme pour contempler et encourager la force d’une vie complète, connectée à soi, aux autres, aux morts, aux beautés qui surgissent pour peu qu’on ouvre les yeux.
Il faut ajouter à cela un recul très humain du sujet : cette tendre renaissance, musicale et douce, synthèse d’un ensemble de doutes et de bilans, décale le regard sur soi vers les horizons du « nous », du « on », ou encore du « tu » apollinarien, jouant des effets de distanciation ou des fusions avec l’universel. Mais il se place aussi volontiers à la lisière d’un humour et d’une ironie qui intègrent l’autodérision (« Avec ta gueule d’écrivain du dimanche »), le détail drolatique où les chiens jouent un rôle certain (« Les bras en croix au milieu des deux chiens / Je redeviendrai prince sous leur salive au goût de navet », ou encore : « Devant l’Hôtel-Dieu un homme tient en laisse / Un bichon noir qu’il appelle Laure »), la notation amusée ou familière : « Le Poète ? C’est le type qui est là-bas / De l’autre côté de ta vie / Il bat des bras comme un oiseau devenu fou / À force de parler des amours intenables / Et cela fait des calligraphies d’épileptique / Au bord du paysage ».
Dans ce mélange délicat et sincère du chagrin et du sourire, il s’agit bien de générosité, de bras enfin librement ouverts sur ce qui a été manqué, mal dit, trop crié et non vécu. Le bout du voyage, incertain, avec la sensation, malgré la foi ou avec elle (« [imiter l’oiseau de notre enfance] dans la solitude écrasante que fait le regard de Dieu / Avec cette maladresse d’amour / Quand il presse son vide sur nous »), d’une solitude immense, n’occulte pas la joie du parcours : la réparation et la cicatrisation salvatrice marchent ici ensemble à côté d’une forme très concentrée de courage. Autobiographique à distance, Je n’ai jamais voyagé, « roman inachevé » certainement, peut se lire dans l’ordre ou par prélèvements, comme ces recueils de sagesses d’autrefois, mais aussi comme le roman d’une âme, de l’enfance à la maturité suractive, comme un feuilleté sensible de la mémoire et un plaidoyer très pur : ici, ou de l’autre côté, à travers tout paysage, il faut avancer avec le cœur.
[1]. La plupart sont édités aux Éditions du Cerf.
[2]. Emmanuel Godo, Histoire de la conversation, PUF, coll. « Perspectives littéraires », 2003.
[3]. Emmanuel Godo, Un prince, Desclée de Brouwer, coll. « Littérature ouverte », 2012.
[4]. Emmanuel Godo, Les Trois Vies de l’écrivain Mort-Debout, Éditions des Busclats, 2018.
Emmanuel Godo a bien voulu répondre à nos questions sur sa manière d’écrire et de travailler le poème.
Dans ces deux extraits [voir les illustrations p. 15] se mêlent des citations, des ébauches, des notes de lecture, parfois des choses notées sur le vif, mais très peu, quelques dessins – le dessin est toujours le signal que je n’arrive à rien du côté de l’écriture. Les deux exemples pourraient laisser penser que le poème se conçoit déjà comme un tout. C’est loin d’être toujours le cas. Il y a des aimantations qui s’opèrent avec des sauts de pages considérables: deux vers notés à la page 4 et datant de mars pourront venir rejoindre trois vers orphelins écrits en octobre.
Par ailleurs, je dois distinguer des premiers jets très fluides (assez peu nombreux, avec de notables exceptions comme la « Supplique pour mourir dans un merci », quasiment venue d’un seul jet et conservée dans son état naïf parce que sans cette naïveté la supplique n’a plus aucun sens) et la pratique la plus usuelle de la reprise indéfinie : c’est une forme d’instinct très brutal et très sûr qui me guide, surtout pas la pensée consciente : elle, elle se contente d’orienter, elle justifie, mais le plus souvent après coup, ou comme une impulsion première qu’il faut très vite abandonner pour ne pas piéger le poème dans l’intention, ne pas le rabattre sur le discours. J’ajoute qu’entre la version écrite au brouillon et la version finale (tapuscrite), il y a des transformations, souvent considérables, la page sur l’écran de l’ordinateur fonctionne comme un aperçu avant impression : d’autres possibilités se font jour, et des choses qui tenaient au brouillon, par la force vaguement orale que conserve l’écrit à ce stade et l’impact de l’écriture à l’encre (qui a le don parfois d’auréoler d’un vague mystère un enfantillage), sont implacablement abandonnées et supplantées par d’autres qui arrivent avec une froideur de maîtrise assez glaçante mais souvent indubitable.
J’ai l’impression qu’il y a plusieurs opérateurs qui se combinent : un enfant, un flâneur, un archiviste, un faussaire, un professeur amnésique (puits de science mais entretenant une sorte d’idiotie farouche sans laquelle il ne pourrait pas être poète), une oreille et un œil (tous les deux complètement maniaques, passant des semaines à trouver le mot juste, accordé), un sabreur (lui sonne la fin de la récréation, détruit tous les bricolages, il agit sans état d’âme, ne laisse rien passer, préfère supprimer plutôt que de laisser passer un futur remords). Il doit y en avoir d’autres, de ces opérateurs mystérieux du poème. Je crois qu’aucune des virtualités de mon être n’est hors jeu. La poésie est une façon de banquet ou d’auberge espagnole où toutes les parts de mon être sont les bienvenues, à condition qu’elles jouent une partition impeccable.
Luc Vigier
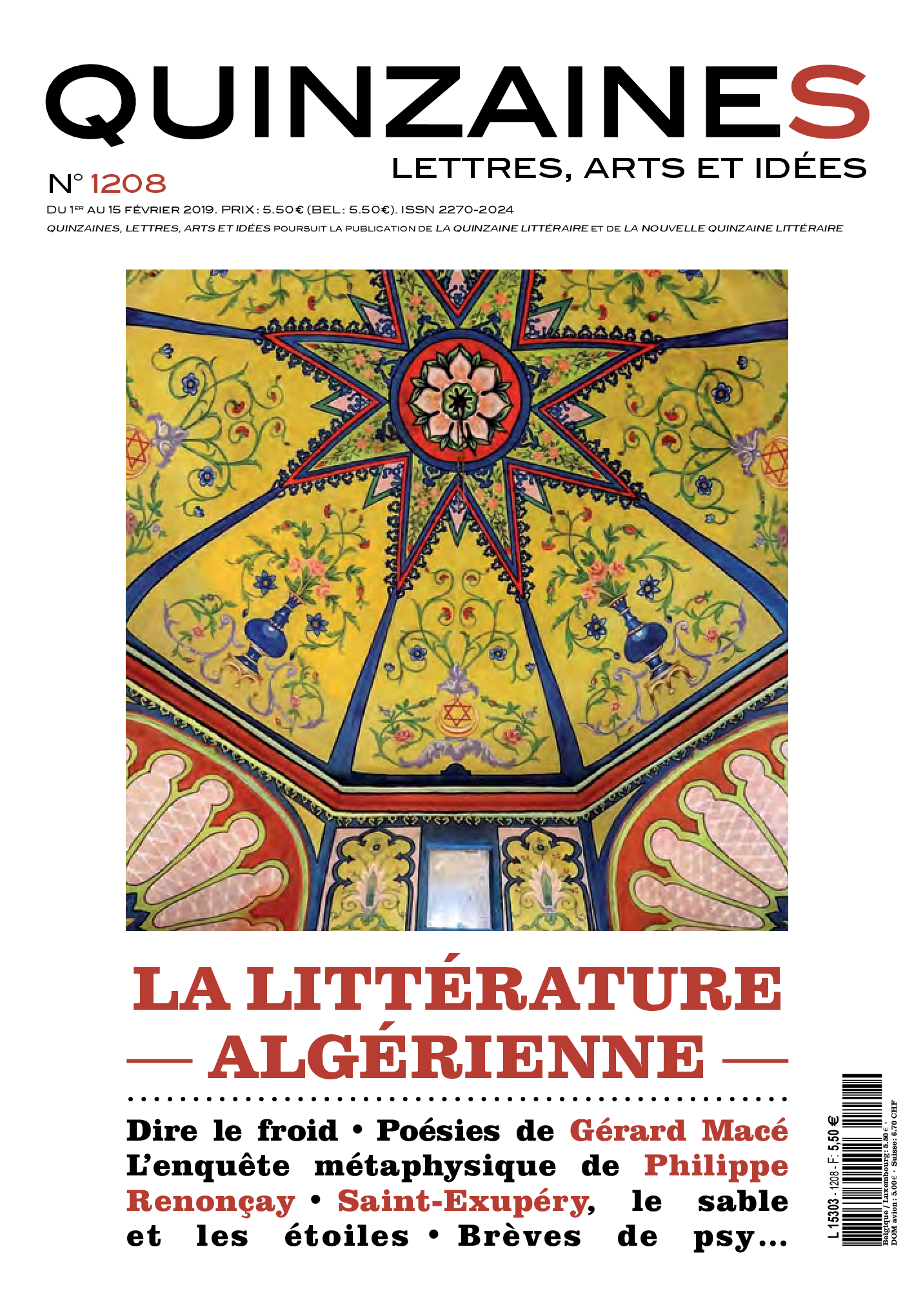

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)