Crocus nous présente donc Paula Rego[1] et Toni Grand, nés en 1935, puis Robert Creeley, mort en 2005 comme Toni Grand. Le poète américain, mort à Odessa (Texas), croise Isaac Babel, né à Odessa (Ukraine). Nombreux sont les fils qui relient entre eux ces créateurs dans la fraternité de Jean Daive.
Le titre, Crocus, fait entrevoir le surgissement de la beauté à la fin de l’hiver et celui de la poésie par un poème de Paul Celan qui débute ainsi : « Crocus de chaux, dans / l’éclaircie : ton / De-là-...

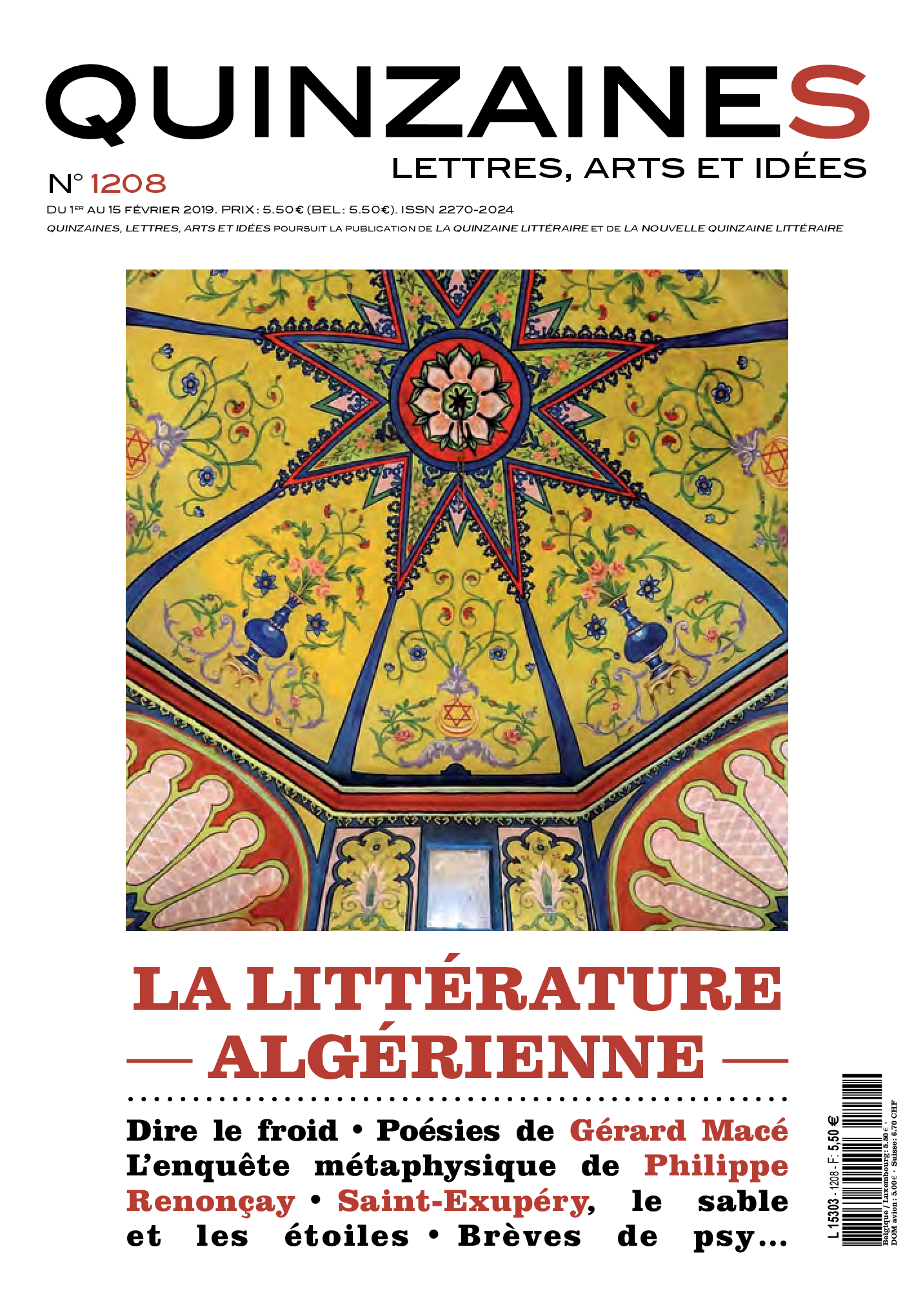

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)