Aussi la naissance d’un fils de ce Païti constitue-t-elle pour la mère du petit une sorte d’accès au Paradis, le moyen d’échapper à sa condition servile et d’acquérir tout simplement le droit à être. Cela explique suffisamment que, malgré la haine légitime qu’elle voue à son propre-à-rien de mari, Kissa élève avec dévotion Wélou, destiné à devenir sans doute un autre tyran domestique, mais le futur ne la préoccupe pas, elle essaie de survivre au présent. Est-ce de l’amour qu’elle éprouve pour Wélou ? Rien ne l’indique expressément. On optera plutôt pour une reconnaissance éperdue envers le bébé qui lui a permis d’émerger du néant.
Naturellement, le Ciel dans son immense bonté récompensant toujours les personnes méritantes, à trois ans le garçonnet est mordu par un cobra et meurt. La pauvre Kissa - crise de folie véritable causée par la profondeur de son chagrin ou réaction de fureur et de crainte devant la perte brutale de sa nouvelle dignité de mère d’un fils : ce type d’incertitude fait la subtilité du livre – n’accepte pas cette mort. Portant dans ses bras le cadavre de l’enfant auquel elle continue de parler, qu’elle protège de la pluie, qu’elle traite jusqu’au bout comme un vivant, elle court et bat la campagne, au sens propre comme au sens figuré, cherchant désespérément un médecin capable de guérir (ou de ressusciter ?) son seul soutien désormais perdu.
Telle est la trame, extrêmement simple, linéaire et pathétique, de ce récit halluciné. Elle est presque aussi rigoureuse, dans sa structuration, que celle d’une tragédie de Racine, sauf que la règle des trois unités est ici réduite à deux : action (on ne quitte jamais Kissa et le but unique qu’elle poursuit), temps (fin d’une journée, crépuscule, nuit d’orage qui suit). En revanche, la topographie, bien qu’elle se limite – après l’exposé préalable des conditions de vie dans la maison du mari – aux alentours de la ville de Savatthi, varie en fonction de la quête haletante de Kissa : campagne, villages traversés, enfin temple où réside le moine Gautama encore jeune et pas encore immortalisé ou quasi déifié en Sakyamuni : le Bouddha. Une seule dérogation à la sécheresse classique, mais elle suffit à faire basculer le récit dans le vertige du baroque.
Chacun des lieux où la mater dolorosa transporte sa détresse figure une des stations de son chemin de croix. Tout la refuse, lui est hostile, la repousse nettement, comme si son attitude de réfractaire absolue à l’ordre immuable des choses – elle est celle qui objecte à la mort – représentait le suprême scandale, qu’il importe de faire cesser à tout prix. Car c’est en fait sa démence à elle qui désaxe le monde. Le marécage infranchissable, la forêt, la nuit, la pluie se déclarent d’emblée contre elle. La nature (plantes, forces impalpables, animaux) voudrait l’expulser de son sein. Aux hommes des bourgades, elle apparaît, s’ils ne sont pas des brutes – chose rare –, comme une malade mentale à plaindre, au mieux on lui fait l’aumône ; s’ils sont méchants, ils ont tôt fait de profiter de sa jeunesse et de sa beauté, de la houspiller, de tenter de la violer. Elle apporte avec elle le trouble, et par exemple perturbe par sa véhémence irrationnelle un couple malheureux qui procédait, sous l’averse battante, à la difficile crémation de son propre enfant.
Aucun des lieux visités ne veut de Kissa, à l’exception d’un seul : le temple où Gautama, à l’aide d’une parabole (« je rendrai la vie à ton fils si tu m’apportes les graines de moutarde d’un village où personne ne meurt »), lui permet de remettre les pieds sur cette terre où la souffrance et le malheur sont les seules réalités. Alors, apaisée par l’expression sereine d’une vérité qui balaye les mensonges faussement consolateurs des sectes, la nouvelle candidate à l’Éveil brûlera le cadavre de son enfant, se fera nonne, insultera et bannira de sa vue le mari venu récupérer son bien, enfin racontera aux novices dont elle est devenue la Vénérable mère cette édifiante histoire, sur son lit de mort.
On se doute que le présent livre peut être reçu, dans le contexte thaïlandais, comme une leçon relevant du catéchisme bouddhique. On se doute aussi que, limité à cet usage, il n’aurait aucune chance de séduire un Occidental athée peu sensible aux sermons. Or, de bout en bout, le texte d’un auteur inconnu (au moins de moi) suscite adhésion immédiate et admiration sans réserve. On mettra cette réussite inattendue sur le compte d’une écriture parfaite (dans le sens qu’aurait l’adjectif féminin « perfecta » en latin, soit : complètement achevée, accomplie, calquée sur son objet, « située » comme aurait dit Max Jacob), où aucune faute de goût ne vient encombrer d’un pathos oiseux la force du souffle romanesque.
Certes, on est frappé d’abord par la puissance subversive du conte. Le personnage de Kissa n’est pas celui d’une victime consentante et geignarde. Elle s’insurge avec une liberté de langage vengeresse contre la société de son temps, son conformisme machiste, sa soumission apeurée à ce qui la domine, sur la terre comme au ciel. Il est donc probable que la violence qu’elle manifeste autorise aussi, en contexte thaïlandais actuel, une lecture moins traditionnelle que sociale et peut-être même politique.
Cependant, la beauté de l’épisode central, celui de la fuite à travers la forêt maléfique et le « ciel dément », épisode presque féerique qui rappellera aux cinéphiles La Nuit du chasseur, unique et géniale réalisation de l’acteur anglais Charles Laughton, tient avant tout à son statut de long poème en prose. Un poème assurément descriptif, riche en couleurs, en détails pittoresques et pour nous exotiques (odeurs, bruits, faune sauvage de cette jungle du piémont himalayen), en rencontres dangereuses dont Kissa ne triomphe que par l’ingénuité de sa vertu. Mais tout baigne ici dans un climat symboliste, onirique, fantastique presque, que la splendeur et la sensualité des images, la précision visuelle ou auditive des apparitions animales et humaines construisent sous nos yeux de toutes pièces avec la sûreté de frappe d’un poète en pleine possession de son art.
Maurice Mourier
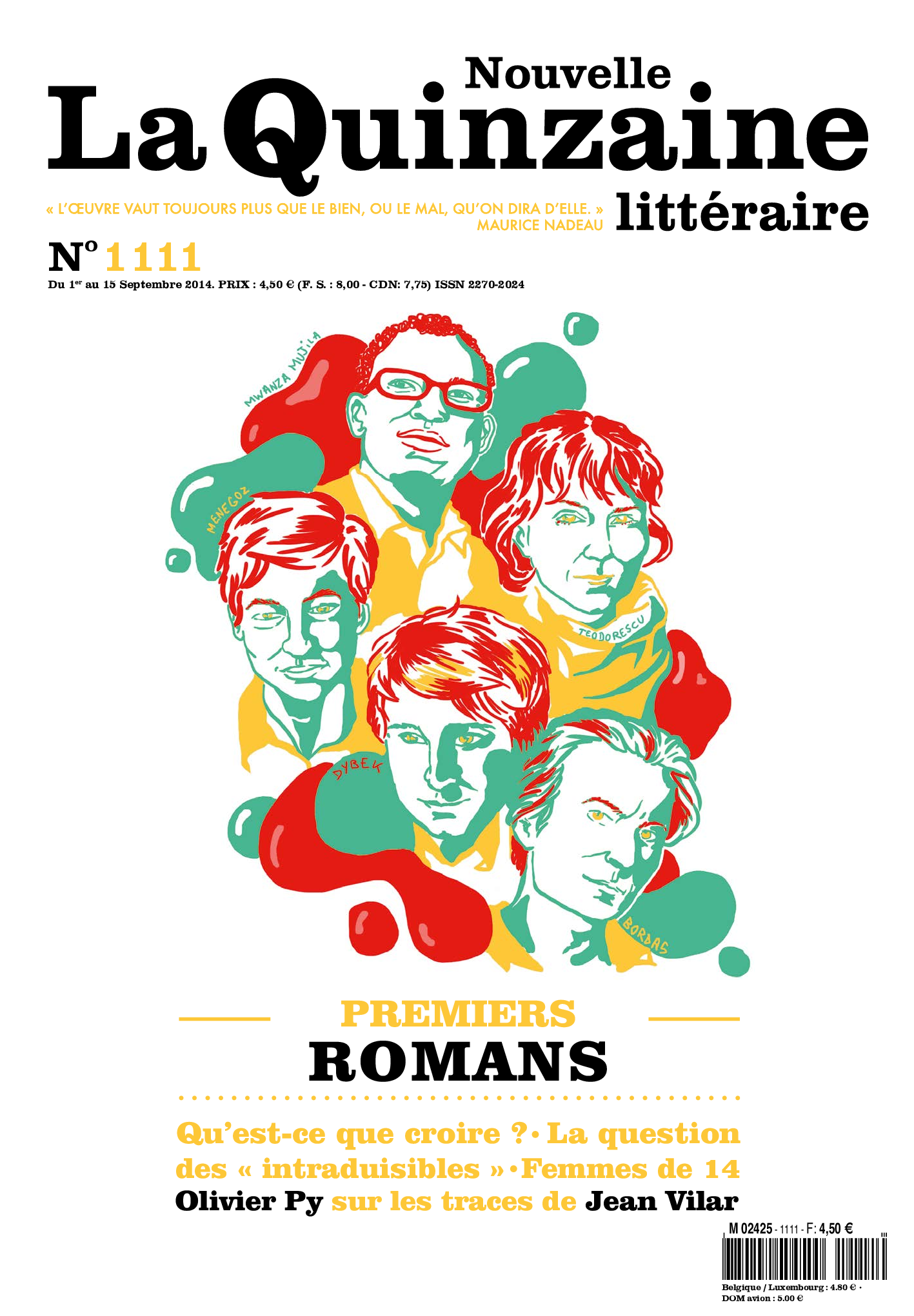

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)