Chaque « portrait-robot » (Suchbild), qui va à la recherche quasi judiciaire ou policière d’un de ces parents, fut écrit « à un moment qui s’avéra sans exception être… le seul moment possible… le seul qui recèle ce dont on a besoin pour faire vivre grâce à la langue un être humain : l’imagination et la fantaisie, l’empathie, l’intérêt ; le souvenir vivant et précis que l’on rappelle à notre guise ». Ainsi, le livre sur sa mère, écrit en cinq mois, mais qui ne pouvait paraître tant que cette femme était en vie, il le laisse de côté pendant dix-neuf ans (manuscrit qui « vieillissait de façon étrange puis fantomatique »), puis, à sa mort, le réécrit aux deux tiers.
Cette quête, cette inquiétude de la génération d’« après » ont été portées et exprimées par nombre d’Allemands. Mais, on l’a compris en lisant la citation ci-dessus, Christoph Meckel a su attendre que viennent ses mots, et même si ses évocations sont parfois sévères, elles sont portées par une langue précise et claire, spontanée et mûrie, juste aux deux sens du mot.
Le père, écrivain non dénué de talent : « Tandis que Brecht, Döblin et Heinrich Mann émigraient…, que des collègues étaient diffamés, persécutés et censurés, les livres brûlés et les tableaux confisqués, il écrivait tranquillement de la poésie traditionnelle et construisait une maison dans laquelle il voulait vieillir. » Originaire de Fribourg en Brisgau, le pays du poète Hebel et de Heidegger, il est attaché à son sol, aux mœurs de sa région (« le pays », écrit le fils, « c’était l’enduit de graisse contre la froidure du monde »), à ce qu’il nomme l’honneur de sa patrie : « il sombrait toujours plus avant dans l’idée de la dignité de l’esprit à une époque indigne ». Mobilisé en Pologne, « le vernis de l’esthétisme se craquelait. La brutalité de l’officier s’affermissait ». Il regarde les civils avec mépris (« un peuple lamentable ») et, dans une note de son journal que son fils retrouve, il note, le 24 janvier 1944 : « Nous avons un honneur que personne ne peut nous enlever. » Puis, trois jours après, ceci : « Lors d’un détour pour aller déjeuner, assiste à la fusillade de 28 Polonais, qui se déroule publiquement au bas du talus le long d’un terrain de sport… Un amas de cadavres dans toute son horreur et laideur, qui pourtant me laisse indifférent. Les fusillés avaient agressé et assommé deux soldats et un Allemand du Reich. » Blessé, capturé par les Français sur l’île d’Elbe, il est emprisonné en Corse, puis en Algérie, où il souffre physiquement et moralement, et lit Hölderlin. Puis il retrouve miraculeusement au pays de Bade sa famille, partie pendant la guerre dans l’est de l’Allemagne, et qui a pu s’échapper de la zone soviétique. « Le dilemme de mon père résidait dans le fait que sa représentation surannée de la patrie, de l’art et de la famille ait été pervertie, et dès lors anéantie, par le Troisième Reich, mais lui-même, revenu brisé de la guerre et de captivité, en était de plus en plus dépendant. »
La mère : « Je n’ai pas aimé ma mère. » Une vie « inassouvie ». Avec son époux, elle « s’aimait elle-même dans le rayonnement de l’amour qu’il lui vouait ». Mais « lassante, un peu sèche, revêche et péremptoire », marquée par « le protestantisme prussien, avec sa conception stricte, prude de la morale ». L’auteur la regarde veuve, vieillie, « vieillarde ». « Elle est à un tel point créature de convention qu’elle ne comprend rien qui soit direct. » Et après la guerre, « elle étouffa la vérité dans son amour-propre, empêcha examen, connaissance et prise de conscience… laissa penser son mari irréprochable, fit avaler à ses fils chaque mensonge et parapha la fausse image ».
Ce serait donner une idée faussée de ces livres accolés que d’insister sur ces jugements. L’écrivain nourrit sa recherche de ses propres souvenirs d’enfant qui fut témoin de la vie de ses père et mère, souvenirs à la fois de la « carence immense » de la vie familiale – et de la richesse savoureuse de tout le reste : d’où des passages merveilleux sur Lucie, la bonne : « elle peignait ses cheveux secs et tout emmêlés, elle était dévêtue, je voyais sa poitrine nue. C’est ce que j’avais vu de plus beau » ; sur Fribourg, sur la vie à la campagne l’été : « Odeur du bétail dans les réduits des commis, linge dans le couloir, lard fumé, fruits et pommes de terre dans l’agitation des cuisines étouffantes : la graisse giclant dans les poêles, les chats à l’affût, l’autel domestique, les asters, le tic-tac de l’horloge », et tant d’autres.
Amertume apparente d’un pareil livre : « Écrire sur un homme signifie : détruire la réalité de sa vie pour la réalité d’une langue. La structure de la phrase exige à nouveau la mort du défunt. » « La mort du défunt » pour l’écrivain, certes, mais pas pour le lecteur : ces deux personnages surgissent des pages bien vivants, et avec eux l’Allemagne de ces années-là. La recherche de Christoph Meckel m’a fait penser au livre trop peu connu de Raymond Guérin sur son père, Quand vient la fin (publié en 1941 quand l’auteur était prisonnier en Allemagne), où la reconstitution précise d’une vie que l’auteur regardait avec désapprobation devient une sorte de célébration.
Pierre Pachet
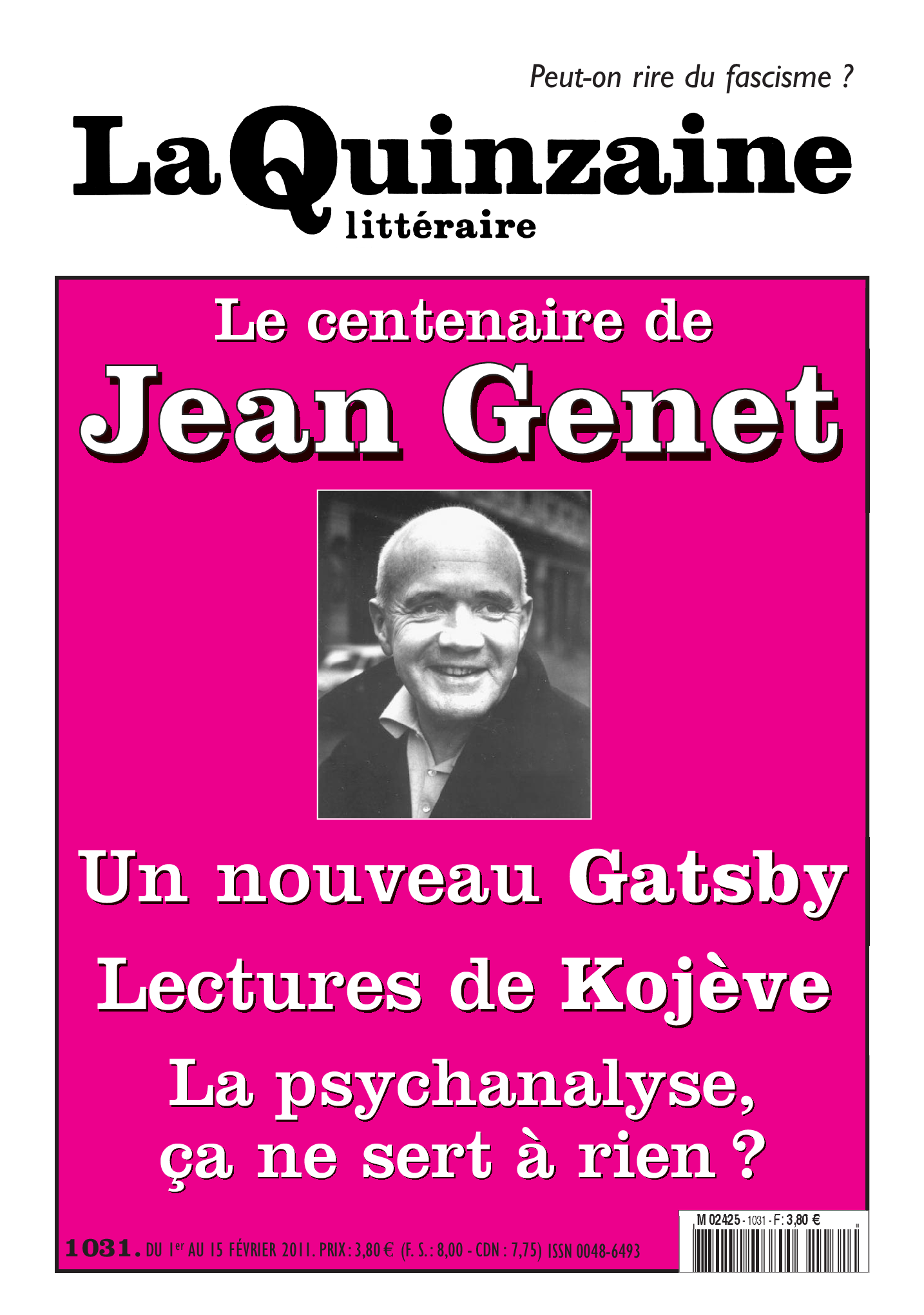

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)