Au moment où ce récit a paru, le père d’Arno Geiger vivait toujours. L’auteur narrateur tenait à ce qu’August Geiger soit encore là, parce que « comme tout homme, [il] mérite que son destin reste ouvert ». Pourtant, quand on lit ce récit sur un vieil homme atteint d’Alzheimer, on se doute que son destin est loin d’être ouvert. Le nom de cette maladie ne doit pourtant pas effrayer le lecteur ou déterminer la façon dont il lit ce livre. Le ton presque égal de l’auteur, la douceur avec laquelle il traite de ce thème en font un livre plein de beauté, de sérénité et de justesse.
D’ailleurs, plus que de la maladie, il est question dans ces pages de la relation qu’elle induit entre le père et le fils, des transformations qu’elle impose aux uns et aux autres, dans cette vieillesse que Geiger qualifie de « glissade ». Comme toute glissade, elle se fait plus ou moins vite. Le récit est aussi une sorte d’enquête, puisqu’un chapitre rapporte les propos d’amis ou de témoins qui ont vécu la maladie avec un de leurs proches. Parler de la maladie et écrire sur elle est une manière de la tenir à distance, d’en montrer la dimension humaine, si humaine.
Tout commence par un souvenir, celui du grand-père du narrateur perdant la mémoire et ne sachant plus comment il se nomme. « L’ancêtre », c’est le surnom donné à cet homme, n’était pas un homme commode. Il avait la main leste et les enfants étaient « tenus » comme le sont les vaches. L’« ancienne » envisageait la vie comme une « préparation au ciel ». Leur fils est moins brutal. Les premiers signes de la maladie chez lui n’alertent pas le narrateur. Il se laisse aller, arrête de bricoler ou de surveiller ses plants de tomates, semble amorphe. Un curieux jeu du chat et de la souris s’engage, dans lequel la souris sera la maladie. L’inactivité soudaine du père le fait ressembler au « vieux roi en son exil », qui « déambule sans trêve ni repos ». La comparaison avec ce vieux roi shakespearien reviendra, marquant les étapes de la maladie.
Bientôt, la perte d’objets précieux alerte le fils : un vélo disparaît, une photo vieille de soixante ans qui restait rangée dans le portefeuille, puis la notion du chez-soi, de la maison. Alors l’histoire passée reflue, même si elle ne donne pas l’explication. August Geiger, comme toute sa famille, est ancré depuis longtemps tout près de Bregenz, à proximité du lac de Constance. La famille d’origine paysanne est catholique, et cette foi la protège du poison nazi. On peut même dire qu’elle l’exclut entre 1938 et 1945 d’une communauté qui sera moins scrupuleuse. Les trois fils de l’ancêtre se trouvent enrôlés. August finira la guerre dans une sorte d’hôpital de campagne tenu par les Soviétiques et échappera de peu à la mort, la mort causée par des maladies, par la dysenterie en particulier. À son retour en 1945, il décide de ne plus bouger de son village. Il renonce aux études dont il rêvait, et travaille comme secrétaire de mairie. Son père l’empêche de se marier une première fois ; la jeune femme n’a pas de parents connus. Il se mariera sur le tard avec une femme en tout différente de lui. Cet échec programmé est une souffrance pour les deux êtres. Tous les membres de la famille vivent dans une forme de solitude, de chacun pour soi. La seule lecture du père était Robinson Crusoé, et tout laisse penser qu’il s’identifiait au héros de Defoe. Son épouse le quitte au bout de trente ans, une fois les enfants élevés Cette séparation pourrait expliquer la maladie, mais pour le narrateur, c’est plutôt la maladie qui éclaire l’existence : « Parler d’Alzheimer, c’est parler de la maladie du siècle. Il se trouve que la vie de mon père est symptomatique de cette évolution. Sa vie commença son cours à une époque où les piliers étaient nombreux et solides (famille, religion, structures de pouvoir, idéologies, rôles dévolus à chaque sexe, patrie) et déboucha dans la maladie lorsque la société occidentale se trouvait déjà, tous piliers effondrés, dans un champ de ruines. »
L’histoire familiale, les habitudes du père, son goût pour le travail manuel (il a entièrement bâti la maison lui-même), sa solitude, tout éclaire ce qu’il est devenu. Et de souffrance, ou de fatalité, le narrateur transforme la maladie en mode de découverte de son père comme du monde : « de mes rapports quotidiens avec mon père, je ne ressortais plus seulement épuisé, mais, de plus en plus souvent, dans un état d’inspiration. C’était toujours aussi éprouvant psychologiquement, mais je constatais une modification de mes sentiments à son égard. Sa personnalité me semblait restaurée, c’était comme s’il était celui d’avant, juste un peu changé. Et moi-même je changeais. La maladie nous transformait tous ».
Le ton du récit s’en ressent, parfois désinvolte, ou poétique, accordant une certaine place aux inventions langagières du père, à ses adages qui donnent sens aux faits. De brefs intermèdes dialogués en italique donnent à imaginer la relation entre le père et le fils ; c’est léger, plein de tendresse, souvent drôle.
Les références aux écrivains et philosophes, comme Kundera, Bernhard ou Derrida, souvent brèves, sont autant de lumières jetées sur ce qui unit un père à son fils. Elles ouvrent des voies, montrent ce qui rend notre histoire personnelle si proche de celle des autres. Mettre en relation, donner une dimension universelle à ce qui semble si intime et ancré en un lieu, cela s’appelle la littérature. Et à ce degré-là, on peut parler de classique.
Norbert Czarny
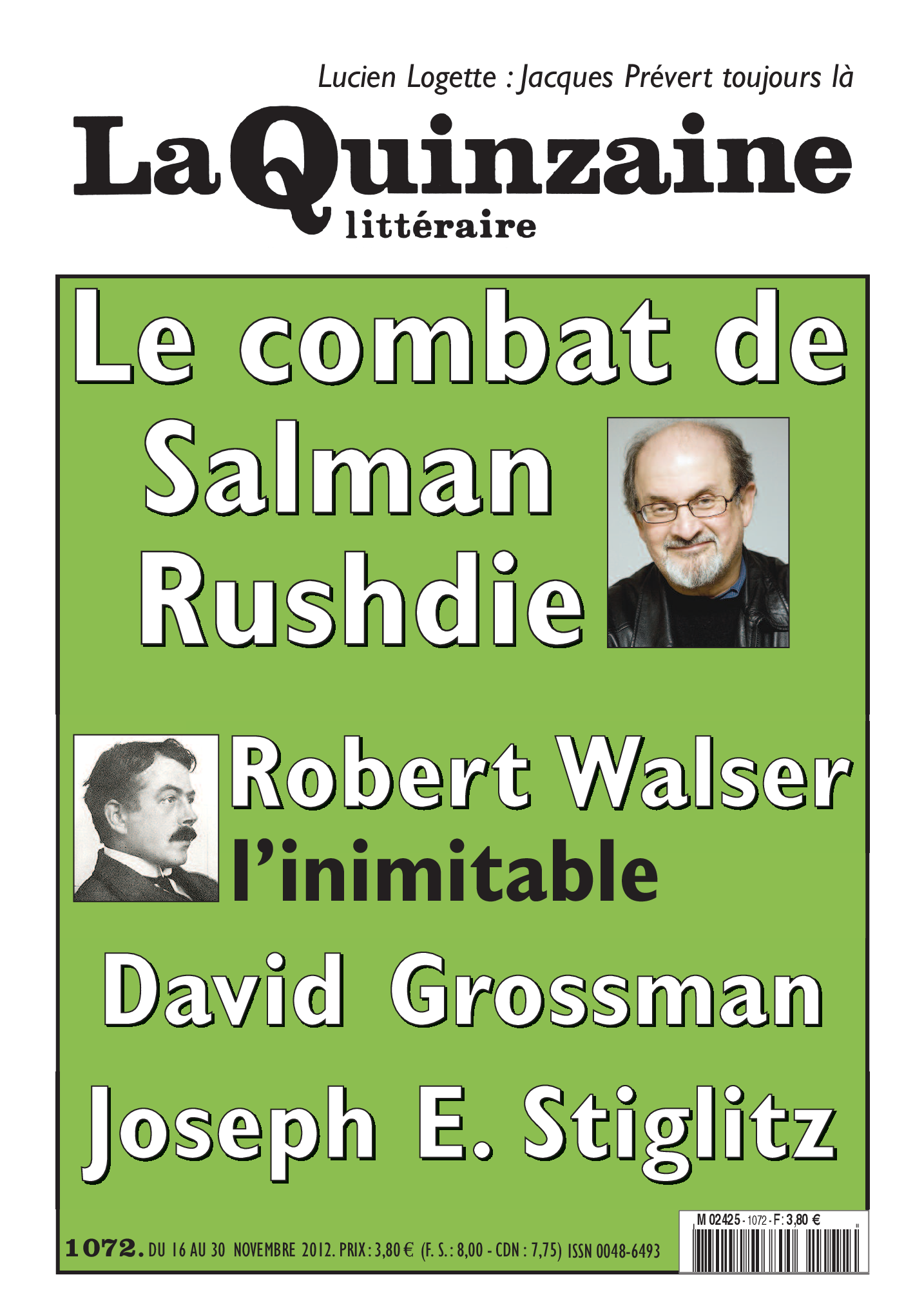

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)