Il est des voix et des livres qui semblent s’extraire de confins mystérieux, comme nimbés d’une brume qui ne les rend que plus désirables, à la fois lointains comme le bout du bout du monde et proches comme un organe palpitant. Ils sont présents et absents, évidents et abscons, vrais et faux. Ce sont des territoires où tout semble possible, sur les marges et au centre desquels se jouent tous les paradoxes, toutes les formes que peuvent emprunter les sens, divergents ô combien, que nous concédons au réel, à ses ramifications, jusqu’à défaire nos certitudes, abolir l’ensemble des frontières, déjouer toutes les lectures, empêcher la marche même de la conscience.
Ainsi, le sens, la signification, la dénomination disparaissent et s’effacent dans le monde étrange des Bieresch. Tout n’y est qu’éternelle permanence, reprise infinie, reconduction traumatique, glose d’un texte presque absent, retour incessant d’une tradition, profération d’une énigme angoissante. Tout y est possible et pourtant rien ne s’y produit. L’immuable, le permanent endossent les atours de l’évolution. Pourtant rien n’est vraiment présent, les discours se reconduisent sans fin, le monde ne semble être que la répétition de ses formes, son questionnement abstrait en quelque sorte. C’est un livre dont nous ne nous échappons pas. Comme un texte fondateur, il exerce une sorte de fascination mystérieuse qui reconduit la lecture toujours plus avant, comme lorsque nous nous abîmons dans des gloses exégétiques.
Voici un livre difficilement résumable tant ce qui s’y déroule semble abstrus, dénué de sens, emportant dans les rets d’une rhétorique implacable, toute borgésienne, et les ramifications d’une intrigue qui s’étend sans cesse, tout ce que nous nommons sens et logique, ne racontant presque rien, ou plutôt, ne fixant rien de ce qui se raconte. Hans, jeune citadin, revient ainsi chez les Bieresch, étrange peuplade d’Europe centrale, à la fois proche et étrangère, à l’occasion de la mort de son oncle qu’il doit, selon une tradition monstrueuse, remplacer pour la durée d’un an afin que son fantôme ne vienne pas hanter les vivants. À l’incongruité de cette situation s’ajoutent les rencontres successives qu’il fera dans cette campagne froide et isolée – sa tante Lina, femme étrange et soumise qui le reprend sans cesse pour se soumettre à ce jeune homme qu’elle ne comprend pas, les « parrains » qui le harcèlent sans rémission, le servant de messe qui l’accapare, l’épicier qui l’emploie, l’équarisseur ou encore Moritz, le manchot… Le roman n’est que la succession de leurs discours plus ou moins compréhensibles qui commentent les mystérieux Écrits des Bieresch et l’égarent dans le dédale de leurs codes, des voix qui les font exister, de leurs conflits ancestraux et d’une conception ontologique délirante. L’aventure de Hans au pays des Bieresch ne se stabilise jamais et le pauvre ne fait que s’égarer plus profondément dans les méandres des discours que les natifs lui tiennent à tour de rôle, les doutes et les souvenirs qu’ils entretiennent.
Une faute, irrémédiablement, pèse sur cet univers quasi insaisissable, sur les êtres innommables (2) qui le hantent, reprenant toujours les même formes – discours, gestes, pensées, occupations –, selon les mêmes termes, reconduisant toujours un même qui ne cesse de s’abolir. « La malédiction pèse sur nous depuis le premier jour ! Chaque ligne, chaque mot de nos Écrits maudit les Bieresch. Le mal du pays n’existe qu’à la maison, disons-nous, parce que nous ne pouvons pas partir d’ici, parce que nous sommes éternellement enfermés dans le labyrinthe de notre malheureuse histoire des Bieresch. Nous sommes nostalgiques de nous-mêmes, car personne ne peut être comme il est. » Le monde y est conçu comme le lieu d’une expiation sans fin, d’une ascèse collective et délirante, d’une mémoire stérilisante, d’une fuite perpétuelle. Le roman de Hoffer ne consiste qu’en l’immense exégèse des écrits traditionnels de ce peuple inconnu, qu’en la faillite de la lecture et de l’interprétation pour ne laisser que l’absence de sens et l’inaboutissement du discours. Suivant une pensée dualiste, il reconfigure sans cesse ses enjeux propres dans une manière de répétition sans borne, faisant du ressassement de la faute et de la disjonction de l’être qui se confond avec son objet, le moteur inaltérable de la fiction. Car le héros de ce livre n’est autre que le texte lui-même et les possibles qu’il organise, la voix qui se perd dans sa propre profération, interrogeant notre étrangeté, notre mystère, l’impossibilité de la fin.
Le livre de Klaus Hoffer n’appelle pas une lecture conventionnelle. Il n’a ni commencement ni fin, ce n’est qu’un cycle, une longue reprise qui ne peut que revenir à son point de départ, la voix traditionnelle en quelque sorte. Chez les Bieresch n’est pas un plan mais un (hyper) volume, une œuvre qui se déploie dans l’espace et que résume bien les célèbres mots de Borges : « La ligne est composée d’un nombre infini de points ; le plan d’un nombre infini de lignes ; le volume d’un nombre infini de plans ; l’hypervolume d’un nombre infini de volumes (3)… » C’est une œuvre mobile, dans laquelle tous les possibles peuvent advenir. Nous nous y perdons, ne sachant plus rien, ne saisissant que des bribes toujours reconfigurées, perdus dans le dédale de voix qui défont notre identité et nous plongent sans fin au cœur d’une interprétation qui ne peut advenir, toujours égarés, « à mi-chemin ».
- Klaus Hoffer est né en 1942 à Graz en Autriche, il est poète et traducteur. Ce roman paru en 1980 (prix Alfred-Döblin) est traduit ici pour la première fois.
- La question des noms est essentielle dans le roman et réclamerait une étude approfondie que nous ne pouvons mener ici.
- Ce sont les premières lignes du Livre de sable, Gallimard, coll. « Du monde entier », 1979, p. 135.

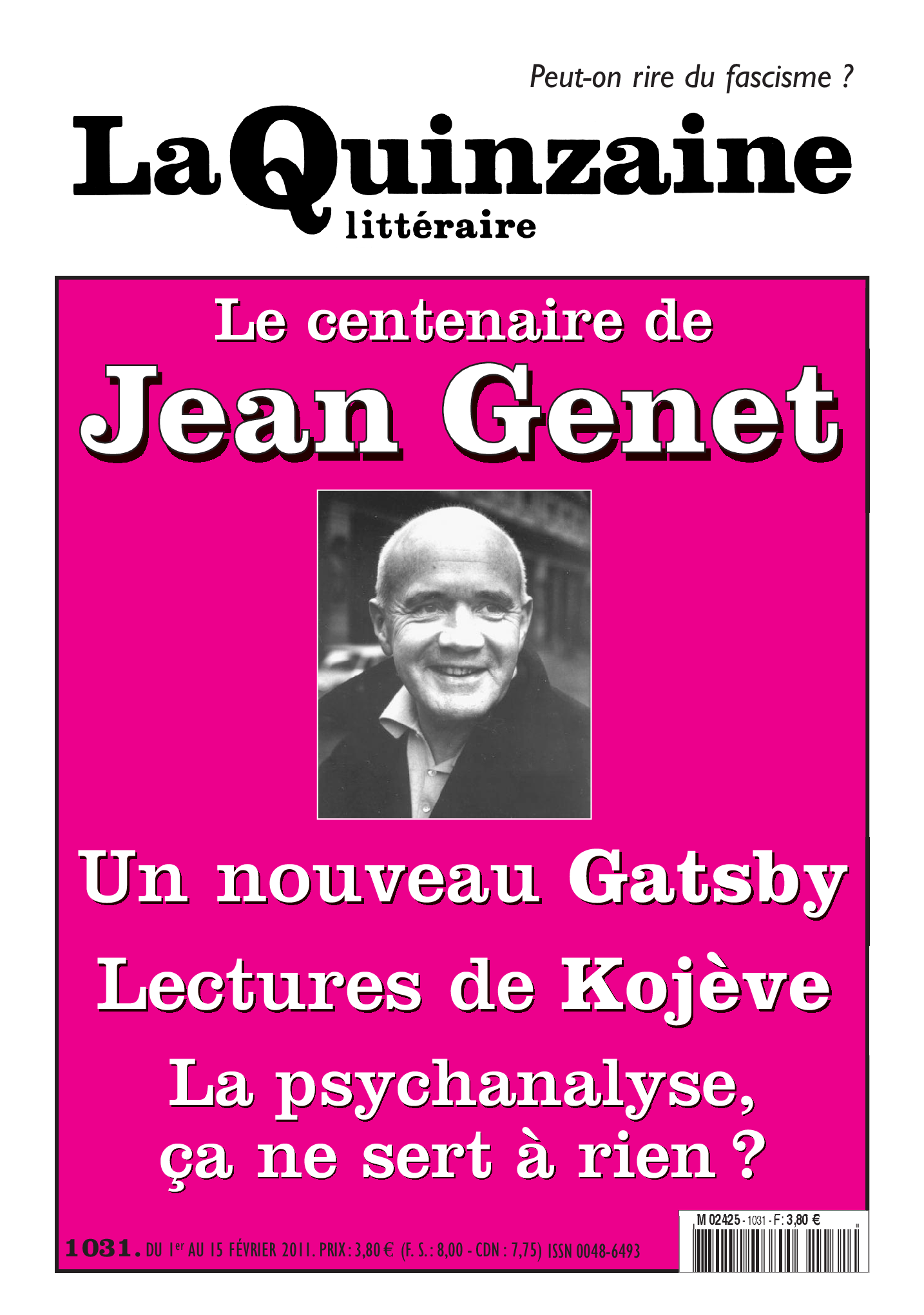

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)