Depuis Séfarade, son roman le plus riche, le plus original aussi par sa forme, Muñoz Molina plonge plus profondément dans les vagues de l’Histoire, du XXe siècle en particulier. À l’aventure que vivent Ignacio Abel et Judith Biély, de Madrid à la campagne américaine, fait écho l’Histoire de la guerre civile, autour d’une date fatidique, le 19 juillet 1936. Le récit commence avant ce jour d’été lors duquel éclate le coup d’État franquiste, tandis qu’Ignacio cherche dans tout Madrid celle qu’il aime. Mais à compter de cette date, il est un homme traqué, qui n’a d’autre choix que de fuir son pays.
Avant, pourtant Ignacio Abel a été un homme presque comblé. Architecte de son état, il a pour mission de bâtir la Cité universitaire de Madrid. Issu d’un milieu pauvre, il a réussi à étudier, a appris son art avec les maîtres du Bauhaus. C’est un humaniste qui a sa carte du Parti socialiste et du syndicat dominant, en un temps où chacun doit choisir. Il consacre l’essentiel de son temps au chantier, discute avec Negrin, l’une des figures historiques de l’Espagne que l’on croise dans le roman, avec Bergamin ou Moreno Villa, rêve d’une Espagne nouvelle qui vaincrait la misère, l’absence d’hygiène et l’analphabétisme. Ignacio Abel est marié avec Adela, une fille de la bourgeoisie madrilène, catholique, un peu ennuyeuse, attachée à des traditions familiales qui fleurent bon l’Espagne des clichés. Dans une page amusante, le narrateur fait l’inventaire de ce kitsch qui colla longtemps aux basques du pays. Il y a dans la description fouillée que propose le narrateur, sans doute proche de l’auteur en ces pages, une sorte de volonté archéologique. Comme si exhumant ces images, il se rappelait sa propre enfance, qu’il a racontée dans son précédent livre, Le Vent de la lune. Entre l’Espagne de 1935 et celle de 1969, rien n’avait changé.
Le roman prend son élan lors de la rencontre entre le héros et Judith. Jeune juive américaine, passionnée par l’Espagne de Perez-Galdos, ou imaginée sous la plume de Henry James, elle a quitté New York pour découvrir l’Europe, apprendre et écrire. Elle admire aussi Dos Passos, romancier emblématique d’une certaine intelligentsia américaine. Un coup de foudre unit les deux êtres. Ils vivront leur amour en clandestins, dans des maisons de passe, allant et venant dans la capitale espagnole, jusqu’à la rupture, sur fond de violences diverses, arrestations, exécutions ou attentats. Mais ce n’est pas ce qui les sépare. Bientôt, Ignacio Abel est lui-même en danger. Il connaît les tourments de l’exil, les papiers d’identité qui ne suffisent jamais, les vêtements qui s’usent, les insultes des gendarmes français. Mais il parvient à émigrer aux États-Unis où Van Doren, un riche mécène, l’a invité. Il reconstruira sa vie, en même temps qu’il bâtira dans une université paisible de Pennsylvanie.
La force de ce roman ne tient pas bien sûr à son originalité, moins patente que dans Séfarade ou dans d’autres textes de l’auteur. Muñoz Molina a choisi le romanesque le plus classique, quelque chose qui rappellerait le grand roman russe, et Tolstoï en particulier. Ce n’est pas un mince compliment que de le comparer par son ambition et par ce qu’il réussit à faire, que de songer à Guerre et Paix. Classique dans sa construction, le roman joue sur des retours en arrière qui donnent à comprendre qui est Ignacio Abel, comment il en est arrivé là et en quoi il incarne son pays. Confronté à la violence des groupes révolutionnaires, et à l’impuissance du gouvernement républicain, il est cette classe moyenne qui voudrait entrer dans la modernité. Les nombreuses descriptions de bâtiments, les trajets en voiture du personnage à travers les rues de Madrid, ses projets, ses rêves, tout dit l’homme moderne que l’on trouve aussi dans les cités des États-Unis ou des grandes villes d’Europe. On songe à certains héros de King Vidor, de Capra, portés par un optimisme neuf. Mais tout se ligue contre lui et Ignacio Abel est près de finir contre un mur sanglant, comme Rossman, l’un de ses professeurs à Dessau, exilé allemand dans la capitale espagnole, fusillé on ne sait par qui, ni pourquoi. Son accent, ses manies ont paru suspects à quelques enragés et cet homme de gauche, antifasciste résolu, a sans doute fini sous les balles staliniennes ou anarchistes. Il aura échappé à l’autre péril qu’on voit dans le roman, figuré par Victor, beau-frère d’Ignacio Abel. Ce jeune homme sans envergure trouvera une posture grâce à l’uniforme de la Phalange mais devra survivre dans Madrid à feu et à sang, après le 19 juillet.
L’Histoire est là, pesante, angoissante, menaçant tous les êtres qu’on croise dans ces pages. La campagne de Castille à l’automne 36 ressemble à celle que traversaient les hordes de Napoléon quand Goya peignait. L’horreur se mêle à l’absurde et annonce des tragédies encore plus immenses tandis que les stukas des nazis bombardent l’Espagne. Le peintre espagnol aurait pu nommer « Insoutenable » ce que l’on voit à travers certaines pages descriptives. Muñoz Molina explique que l’idée de ce roman lui est venue lors du conflit en ex-Yougoslavie : le sort des exilés lui rappelait celui des siens, et il est vrai qu’en lisant Dans la grande nuit des temps, on a le sentiment que le temps s’est arrêté, ou pourrait revenir, sur notre continent comme sur d’autres.
Ce roman tient aussi sa puissance de sa précision, « précision d’un rapport de police ou d’un rêve ». Le narrateur, qui signe son texte comme le peintre se glisse dans sa toile (on songe à Vélasquez) insiste sur son désir de ne rien oublier ou mal montrer. Il prend appui sur des photos, les décrit, use d’une prose qui traque le détail, joue sur les contrastes, montre l’ombre autant que la lumière. La scène de la rencontre entre Judith et Ignacio, chez le mécène Van Doren, dans un appartement de la Gran Via doit beaucoup au cinéma. Mais on pourrait en dire autant de tout le roman qui semble cadré par l’un de ces chefs opérateurs arrivés de Berlin ou de Vienne à Hollywood pour travailler avec Preminger ou Siodmak. Les deux assassinats qui déclenchent la sédition franquiste sont racontés sous forme de montage : des pages de journaux défilent, l’objectif et le subjectif se mêlent. Dos Passos n’est pas loin. Et puis les dialogues, parfois un peu didactiques (notamment quand Judith veut retourner en Espagne dans les Brigades internationales), rappellent ce que le cinéma doit au théâtre ou à l’art de la parole.
Le roman, on le sait, est un espace dans lequel le jugement gagne à être suspendu. Il n’y a plus de bons et de méchants, d’assassins et de victimes. C’est même ce qui nous angoisse dans Dans la grande nuit des temps, comme cela nous embarrassait dans Les Soldats de Salamine de Javier Cercas. Tout serait plus simple si cette guerre civile opposait le noir et le blanc. Ici, tous les « seconds rôles » existent, ont de la place pour contredire, moduler, modifier l’image qu’on se fait des héros. Don Francisco de Asis, père d’Adela, grand bourgeois de droite, ne saurait ainsi se réduire à une caricature, pas plus que Bergamin, dont le philo-communisme a quelque chose d’exaspérant, rétrospectivement. Et puis si l’on sent l’empathie du narrateur pour Ignacio et Judith, la longue lettre d’Adela que le héros relit par intermittence offre l’autre point de vue et rend justice à cette femme tout occupée à sa mission de mère (sans doute trop d’ailleurs). La lettre est le contrepoint indispensable au récit centré sur le héros et sur son parcours. De même, les lettres et carnets qu’Ignacio cache, constituent le journal de son amour secret et donnent à imaginer un récit dans le récit. Le roman est un labyrinthe – lieu familier dans l’univers de Muñoz Molina – on se perd dans ses détours, on repère des figures semblables ou identiques en des endroits divers et l’art de l’écrivain consiste à ne pas trop mener le lecteur, sans jamais l’égarer totalement.
On n’oublie pas aisément les héros de ce livre. On est entré dans la gare de Pennsylvanie avec Ignacio, on sort du roman avec Judith. Entre-temps, on a traversé une époque, on a partagé une expérience. Faut-il ajouter, mais la place manque ici pour le prouver, que l’écriture de Muñoz Molina, très bien traduite par Philippe Bataillon, est délicate et élégante ?

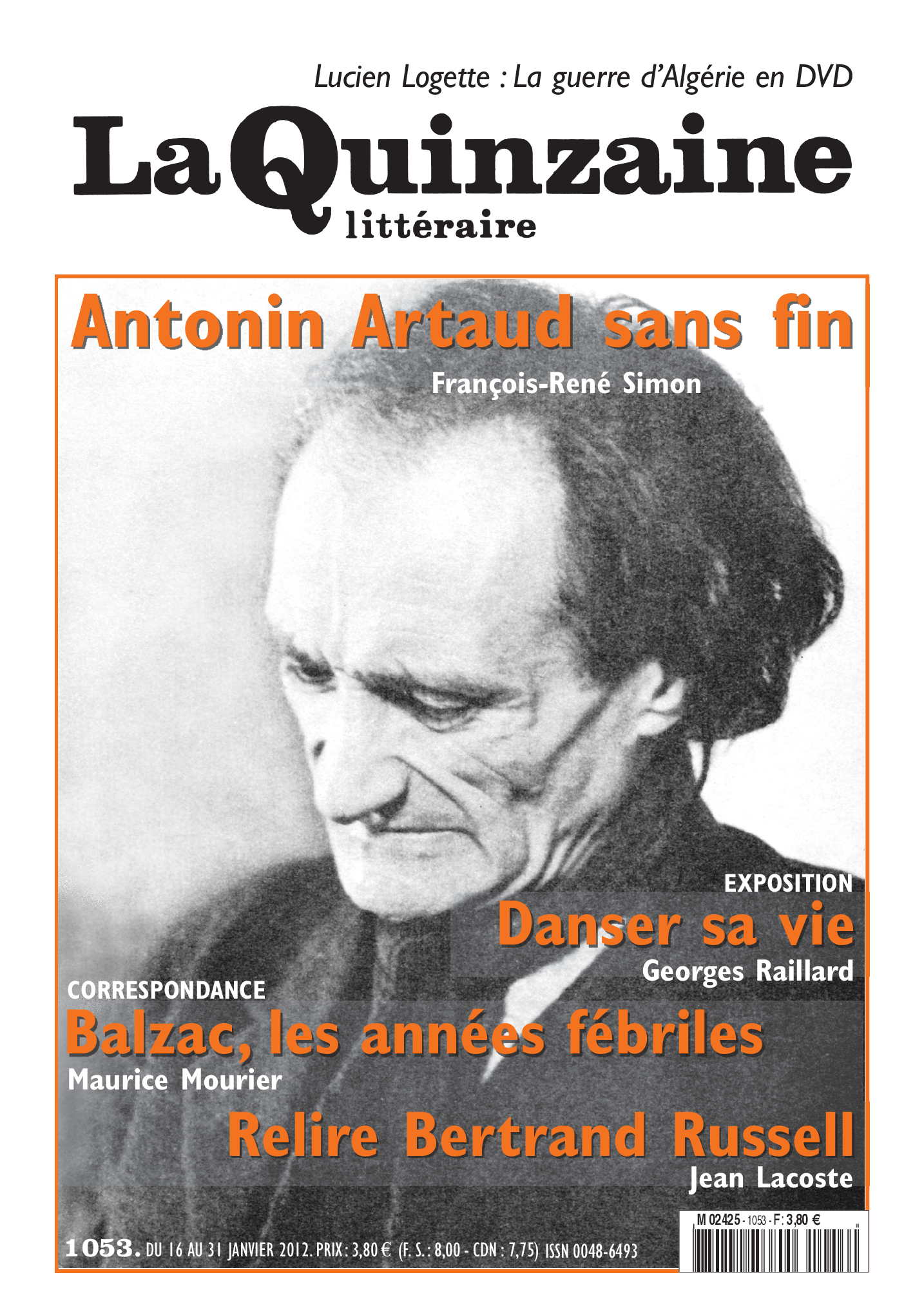

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)