Son auteur m’était inconnu, mais non pas la contrée disparue dont il parle. Disparue, en effet, car le développement économique fulgurant des six décennies nous séparant de la partition du 27 juillet 1953 (qui succédait à une guerre civile de trois ans) l’a transformée au point que les habitants actuels de la Corée du Sud, à l’exception des vieillards, n’ont aucune idée de ce qu’était cette contrée exsangue et misérable dans les années 1960. Or ce sont celles de l’adolescence de l’auteur-narrateur et il en restitue la couleur spéciale, d’une beauté poignante et morbide, avec une exactitude frémissante, qui ne manquera pas de frapper ceux qui, comme moi, ont parcouru en ce temps-là la partie sud d’une péninsule unie jusqu’au funeste été de 1950.
Quand Park Bum-shin ouvre nos yeux sur les déambulations de son héros Yushin, qui lui ressemble comme un fils, ce dernier a quinze ans et suit vers l’école un chemin poussiéreux. Nous sommes en province, le pays est alors constitué surtout de villages aux toits de chaume où s’allument, par les hivers glacés et secs, les petits lampions oranges des kakis. Les maisons sont de bois et l’on y dort sur un mince matelas qui sépare à peine de l’ondol, le plancher recouvert de papier huilé sous lequel s’accumule l’air chaud apporté par des conduits depuis un foyer extérieur. Entre les villes, que la guerre a ravagées, circulent des trains vétustes mais les routes, défoncées, sont parcourues à toute allure, au péril des ruptures d’essieux, par toute espèce de véhicule datant de l’occupation japonaise (1910-1945) ou mis au rebut par les Américains qui avaient sauvé le Sud de l’envahissement par le Nord communiste.
Dans les villes, y compris les principales (Séoul, Pusan, Mokpo), les hôtels et les quartiers chauds abritent une énorme population de prostituées, vendues par leurs familles pour subsister, ou coupées de celles-ci par la partition et l’exode qui a suivi, orphelines de guerre ou victimes de la terrible disette ambiante. Tout est sinistré, sauf le paysage, partout bucolique et fleuri, sauf les temples, sauf les hommes parfois, les femmes surtout, d’une beauté si fière et si frappante dans la longue tunique flottante, unie, de couleur pastel rose, bleue, verte, qu’elles revêtent le soir au creux des vallons, et alors elles dansent des rondes, créatures aussi féeriques que les Muses chantées par Du Bellay dans ses Regrets.
Un visiteur malgré tout nostalgique – comme l’auteur du livre lui-même – de cette ancienne Corée retrouvera ici toutes ses émotions et ressentira le malaise contradictoire qui étreint Park Bum-shin lorsque, devenu célèbre, il retourne dans sa ville natale pour y donner des conférences, et ne peut s’empêcher de pleurer les après-midis passés, au cœur du bidonville des prostituées, avec ses copains étudiants, à manger des nouilles chez la coiffeuse-maquerelle, au milieu des filles affligées et riantes.
En même temps certes, il se juge, se condamne, et s’exalte aujourd’hui, quarante ans plus tard – nous sommes donc en 2003, date de la sortie du livre –, en vrai patriote d’une Corée devenue méconnaissable, riche, mondialisée, orgueilleuse d’elle-même à juste titre, quoique, d’une certaine façon, déshumanisée ou au moins privée de cette chaleur solidaire qui rendait vivable le cauchemar de l’après-guerre.
Mais, me direz-vous, c’est donc que l’écrivain de maintenant, le presque sexagénaire qui écrit son livre, se confond absolument avec son protagoniste, qu’il n’a pas composé un roman, mais un banal récit de vie, enfin, pas si banal en vérité car la personnalité de Yushin, le jeune héros, est fort singulière et fort attachante cette singularité.
Eh bien ! pourtant non, il s’agit bien d’un véritable roman, et d’un roman d’une structure complexe. Le récit, apparemment linéaire, suit l’ordre chronologique des « pupitres », de celui de l’écolier de quinze ans (seize, selon l’habitude coréenne qui donne à l’enfant l’âge d’un an à la naissance) à celui de l’étudiant de vingt, qui aura durant ces cinq années ingurgité un livre par jour, et notamment des textes français (Genet, Camus, Sartre, Gide, Michaux, Baudelaire, par exemple, lui sont familiers).
Mais c’est un récit entièrement machiné par un narrateur dont le statut change constamment, parfois d’un paragraphe l’autre. Tantôt il suit pas à pas le jeune homme comme un personnage maintenu à distance et Yushin occupe le devant de la scène. Tantôt l’ambiguïté s’installe, grâce au très simple procédé consistant à n’utiliser que rarement le prénom de l’état-civil, et à lui substituer un « lui » que le lecteur met spontanément en rapport avec un « moi » sous-entendu. Or ce moi est à d’autres moments explicite, et il arrive même que le narrateur se campe en pied comme écrivain, et surtout s’explique avec une franchise jouée sur la relation anormale qu’il entretient avec cet adolescent qu’il fut.
Mais le fut-il, ce garçon désespéré dès l’enfance, suicidaire, qui un jour se bourre de somnifères et doit subir un lavage d’estomac, que pour cette raison un professeur attentionné ménage, veille à entourer de bons éléments au dortoir, bons éléments que son étrange impunité lui permet – car il est destructeur et pas seulement de lui-même – d’entraîner hors du droit chemin (alcool, filles, paresse) ? Le lecteur est tenté de le croire mais une seconde tentative de suicide, horrible et radicale cette fois, qui semble dans un premier temps concerner le même personnage mais en fait ne le peut car c’est un camarade, K (comme celui de Kafka), qui la commet réellement et meurt déchiqueté par un train.
Réellement ? Du moins dans la « réalité », peut-être fabriquée de toutes pièces, de ce qui n’est de toute façon qu’une fiction. Et le lecteur se rappelle alors que Genet et son Journal du voleur sont un modèle pour « lui », cet enfant malheureux, ce pervers polymorphe qui ne s’est jamais remis d’avoir vécu en pleine lucidité, de l’intérieur de la matrice, son expulsion au jour par une mère déjà vieillie, et qui l’aurait étouffé s’il avait été une nouvelle fille - scène inaugurale impossible que sa perfection d’écriture préserve de tout voyeurisme et rend presque lyrique, développant en quelque sorte de façon moderne le cri de Chateaubriand : « ma mère m’a infligé la vie ».
Un découpage en trois parties correspondant à trois « pupitres » qu’il faut occuper successivement « sous la mer » au risque de suffocation (on pense à Michaux, une des sources évidentes du livre et à son « traîner un landau sous l’eau. Les nés fatigués me comprendront » de Tranches de savoir) structure le livre. Mais chacune de ces parties est émiettée, et presque pulvérisée en courtes vignettes contenant une image clé, un fragment de paysage frappant, une anecdote marquante, le tout vu avec une acuité du regard quasi naturaliste.
On comprend que le narrateur s’épuise – il a lu, entre autres philosophes pessimistes, Schopenhauer – dans le fallacieux espoir de retrouver, au miroir de Genet, la présence charnelle de Yushin. Plusieurs fois, il confesse cependant que cet espoir même recouvre une aporie, car pourquoi pister un enfant roi que d’un double mouvement on adore et on déteste, qu’on se lamente de ne plus être et qu’on ne voudrait à aucun prix redevenir ?
Un dernier inspirateur sous-jacent, jamais nommé, de ce roman révélateur d’un écrivain, d’une création authentique et aboutie, est Proust. La déceptive recherche d’un temps perdu s’ébauche ici sans trêve, construit quelques pans de mur, commence un édifice, et d’un revers rageur le détruit. Au lieu d’être le miracle qui rédime, la résurrection de la Corée morte, si elle était possible, le surgissement du fond des eaux du jeune Yoshin, s’il s’accomplissait tout de bon, coïncideraient avec cette catastrophe qu’est la révélation du rouleau compresseur du temps.
Encore presque enfant, le héros s’amuse à répandre des pétales rouges de cosmos sur les rails de la voie de chemin de fer qui passe près de chez lui et, dès que le train les a transformés en une bouillie de sang, s’enfuit en pleurs. Pour lui, l’extase et le chagrin se touchent, formant un indissociable amalgame qui pourrira à coup sûr. Il ne croit pas que rien, y compris la littérature, puisse être sauvé. C’est pourquoi il est un personnage littéraire à part entière et son inventeur est un grand écrivain.
Maurice Mourier
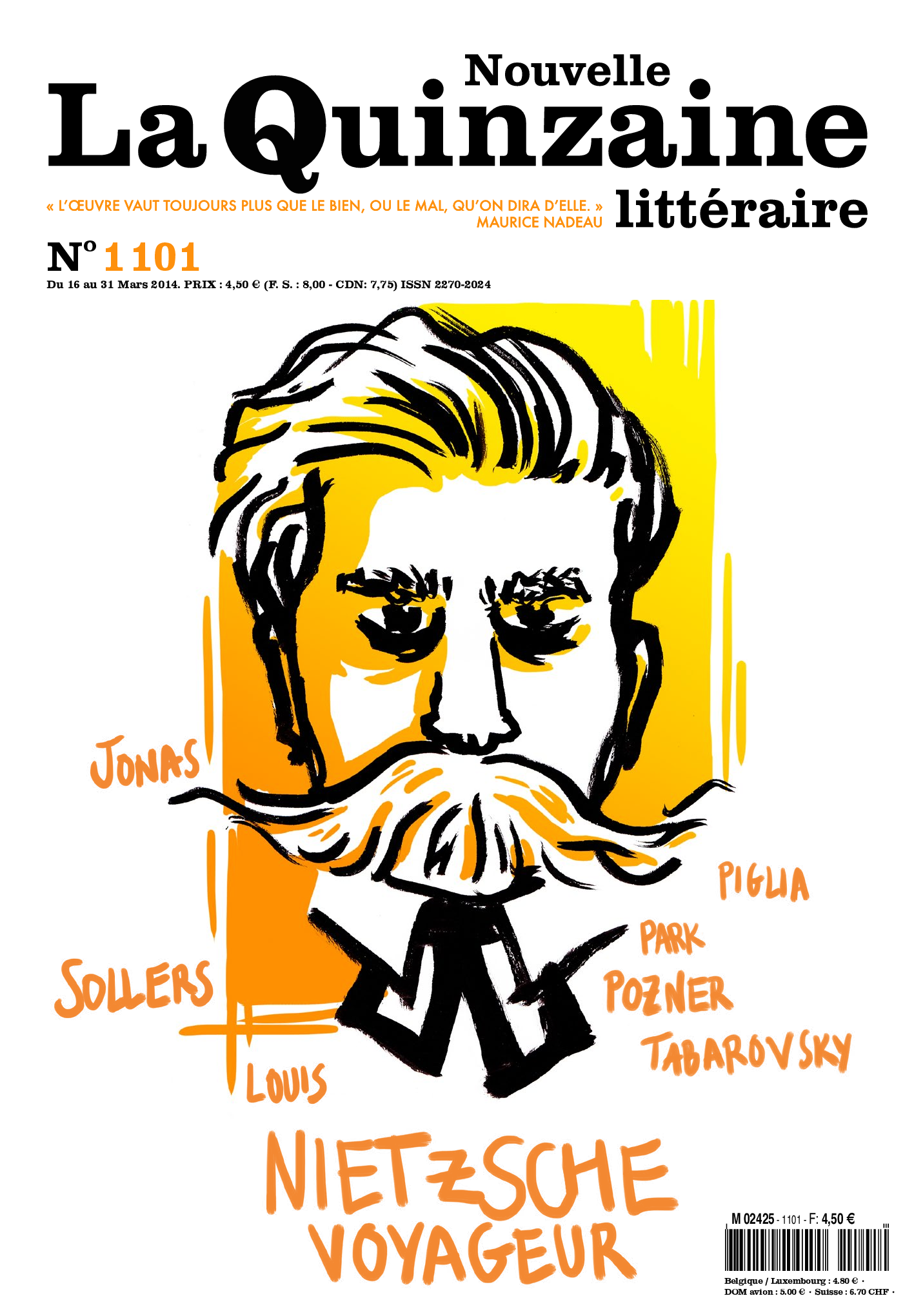

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)