Dans Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus, Ivan Jablonka fait à la fois œuvre d’historien et d’écrivain, presque de romancier. Il retrace par le détail l’existence de Matès et Idesa, ses grands-parents, nés dans un shtetl non loin de Lublin. Issus d’une famille juive pratiquante, ils ont rompu avec elle et adopté la « foi » communiste. Traqués par la police polonaise, ils ont connu les geôles de leur pays natal avant de s’exiler. La France des années trente supportait déjà mal les vagues immigrées, qu’elles arrivent de l’Allemagne, de l’Italie ou de l’Espagne républicaine. L’hostilité des autorités et de certaines franges de la population n’a pas empêché ces exilés de s’engager contre Hitler en 1939. La débâcle puis l’Occupation ont suivi ; les rafles et Auschwitz ont eu raison de ces hommes et de ces femmes. Le livre du petit-fils les sauve de l’oubli. Nous avons voulu l’interroger sur Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus.
Norbert Czarny – On apprend beaucoup sur la vie des Juifs en Pologne entre les deux guerres, dans ce livre. Certes, des historiens ont déjà abordé ce sujet, mais vous pointez avec vigueur certains aspects. Ainsi du passage entre la tradition à la modernité, la rupture entre religieux et communistes, mais aussi l’énorme hostilité entre sionistes et communistes. Qu’est-ce que l’historien que vous êtes apprenait en écrivant ?
Ivan Jablonka – À cette époque, la vie juive polonaise est d’une très grande richesse : 200 journaux en yiddish et en hébreu dans tout le pays ; des bibliothèques, des conférences-débats, des cours du soir, des clubs de sport dans la moindre bourgade. On compte des dizaines de partis et de syndicats juifs. Dans cette nébuleuse, les communistes sont très isolés : ils luttent à la fois contre les religieux, les partis « bourgeois » et le sionisme, qui est une sorte de messianisme concurrent. J’ai découvert à quel point la civilisation du shtetl était vivante, complexe, foisonnante. Il n’est pas facile d’en avoir conscience aujourd’hui, non seulement parce que les nazis l’ont détruite, mais aussi parce que leur antisémitisme meurtrier donne l’illusion rétrospective que les victimes avaient pour unique caractéristique leur judéité.
N. C. – Votre livre n’est pas sans parenté avec Les Disparus de Daniel Mendelsohn, dans le sens où il montre des êtres vivants, où il raconte comment ils ont vécu, avant de disparaître…
I. J. – Les Disparus est une réussite. On reste admiratif devant la ténacité de l’enquêteur, sa recherche de la vérité et du détail, la manière dont les témoignages sont entrecroisés, la célébration de la vie dans l’hommage aux morts. C’est un grand livre sur la Shoah et l’histoire des Juifs d’Europe de l’Est. Mendelsohn a aussi donné voix à une aspiration universelle, car, des « disparus », tout le monde en a dans sa famille. Nos démarches sont proches en effet, mais elles diffèrent en ceci, que Mendelsohn ne travaille pas en historien.
N. C. – Vous êtes historien et l’énorme travail sur l’archive, la recherche du fait précis en atteste. En même temps, on sent que vous vouliez « écrire » ce livre. Pouvez-vous expliquer qui a pris le pas sur l’autre ou comment les deux « métiers » se sont articulés ?
I. J. – L’histoire n’est pas un discours comme les autres ; elle a des règles et elle produit de la connaissance. Mais tout historien « écrit » son livre, en ce sens qu’il fait des choix littéraires : construction du récit, mise en intrigue, tempo, hiérarchisation des protagonistes (par exemple ces personnages abstraits que sont l’« État » ou la « Méditerranée »), etc. En tant qu’historien, j’aime écrire et, en tant qu’écrivain, je fais de l’histoire. Les historiens devraient pleinement assumer la dimension littéraire de leur travail, à condition évidemment que celle-ci ne soit pas synonyme de fiction, de roman, de scepticisme. L’histoire dite « romancée » court le risque de n’être ni l’une, ni l’autre. On pourrait définir mon livre comme une littérature qui satisfait aux exigences de la méthode historique.
N. C. – Trois écrivains sont présents en filigrane dans ces pages : Perec, Grumberg et Primo Levi. Quel rôle ont-ils joué pour vous ?
I. J. – J’ai beaucoup d’admiration pour leur inventivité, leur humour, leur pudeur, l’économie de moyens dont ils font preuve pour dire les choses les plus tragiques. Ils ont mené une réflexion irremplaçable sur la destruction du judaïsme européen. Ce qui m’intéresse plus précisément, c’est la manière dont ils placent le raisonnement historique au cœur de l’écriture. W ou le Souvenir d’enfance de Perec et Mon père, inventaire de Grumberg s’appuient sur des souvenirs et des témoignages, mais aussi des documents, pièces d’état civil, archives, photos, lettres, etc. Si c’est un homme et La Trêve constituent un témoignage historique de première importance. On cite souvent la belle formule de Perec, « l’Histoire avec sa grande hache », mais on oublie que sa littérature est autant hantée par l’histoire qu’elle est une réflexion sur la manière d’écrire l’histoire. Ainsi, son premier livre, Les Choses, est une « histoire des années soixante ».
N. C. – Votre livre est ancré dans l’Histoire du XXe siècle, dans ses espérances messianiques et ses horreurs, mais vous intitulez un chapitre « Les sans-papiers juifs de ma famille ». Pouvez-vous revenir sur ce titre ?
I. J. – Il y a dans cette expression un jeu d’anachronisme assumé. Dans les années 1930, les étrangers clandestins n’étaient pas en effet des « sans-papiers », mais des « indésirables ». Question de vocabulaire, car leur situation était à peu près la même qu’aujourd’hui : pas de papiers, pas de travail légal, pas de droits sociaux, une existence misérable, à la merci des policiers et de tous les exploiteurs. Aujourd’hui encore, le sans-papiers fait figure de repoussoir. On croit qu’un sans-papiers ne peut être que Malien, Chinois ou Rom. Mais il y avait en France des sans-papiers juifs et, pendant la guerre, ils ont été les premiers à être arrêtés et déportés. J’ai voulu revendiquer cette filiation.
N. C. – Le dernier chapitre, dans lequel vous essayez de raconter ce qui a pu se passer à Auschwitz, est très impressionnant. Vous partez des textes laissés par les Sonderkommandos et vous vous interrogez sur le rôle que votre grand-père y a joué. Il y a quelque chose de vertigineux…
I. J. – Les hommes du Sonderkommando (le « commando spécial ») étaient des déportés juifs chargés d’extraire les cadavres des chambres à gaz et de les brûler. Ils étaient régulièrement tués et remplacés par d’autres. Dans ces conditions inouïes, certains ont réussi à écrire, puis à enterrer leurs textes à proximité des crématoires, où on les a retrouvés après la guerre : Chaïm Herman a laissé une longue lettre à sa famille, Lewental, ancien étudiant de yeshiva, est l’auteur d’une « chronique » sur la vie à Birkenau, Zalmen Gradowski a écrit un texte bouleversant intitulé « Au cœur de l’enfer ». La nature de ces textes est indécidable : lettre d’adieu, prière, témoignage historique, littérature. En dépit de ces écrits, la vie au sein du Sonderkommando reste une expérience limite, proprement inimaginable. Ces hommes sont les esclaves de la mort et du crime, avant d’en devenir à leur tour les victimes.
N. C. – Comment sort-on d’un tel travail, qui par bien des côtés s’apparente à l’écriture du fameux roman familial ?
I. J. – L’expression « roman familial » est héritée de la psychanalyse : elle désigne le récit par lequel les enfants fantasment leurs origines, en s’inventant une autre famille, généralement de milieu social supérieur. Les analyses d’Otto Rank dans Le Mythe de la naissance du héros m’ont été utiles quand j’ai travaillé sur les enfants de l’Assistance publique (notamment sur le parcours et l’œuvre de Jean Genet). Pour ce qui concerne mon essai de biographie familiale, l’aspect de « roman » m’est complètement étranger : il n’y a dans mon livre rien de fictif, d’inventé, de fantasmé, de fantaisiste. Mais si l’expression « roman familial » renvoie à la catharsis, au travail que l’enfant plus ou moins orphelin effectue sur lui-même et le monde pour retrouver les ascendants disparus, alors, oui, je m’y reconnais. Ce travail achevé, je ressens un mélange de joie et de peine. J’ai fait la connaissance de ces grands-parents que je n’ai pas connus, mais je n’ai rencontré que des êtres de papier, des fantômes.
Propos recueillis par Norbert Czarny.
- QL n° 890 du 16 décembre 2004.

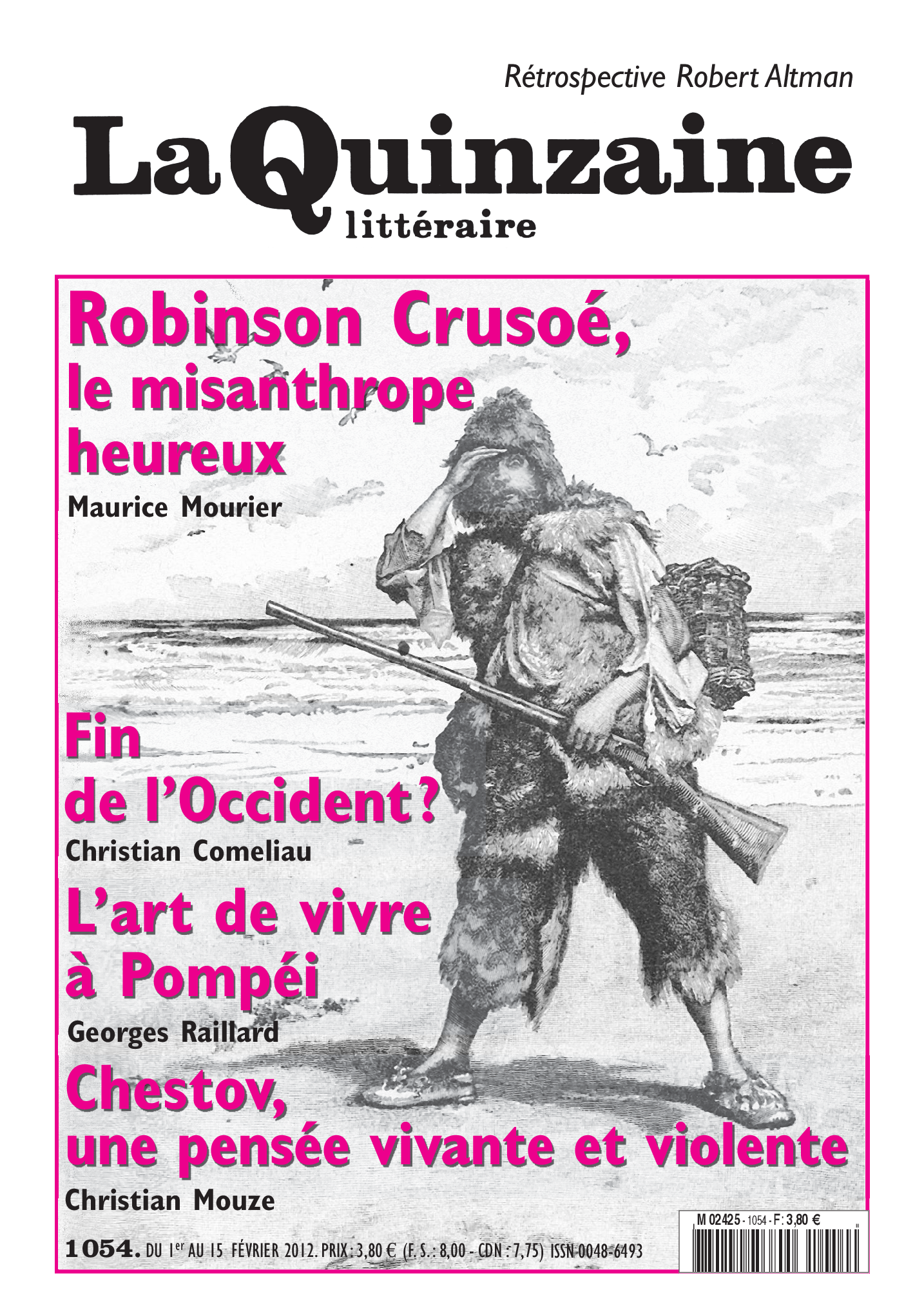

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)