L’existence de Nussbaum débute pourtant sous les meilleurs auspices. Né dans une famille bourgeoise d’Osnabrück, il passe une enfance heureuse. Son père est peintre amateur et ne fait rien pour contrarier le désir de Felix. Il fera des études d’art. Ses premières toiles montrent la famille, des scènes de la vie juive locale. Un chapeau vert, une certaine touche, rappellent l’influence de Van Gogh chez le jeune peintre. On est en 1927 et les courants esthétiques qui dominent en Allemagne, autour de Christian Schaad, de Dix ou de Grosz sont ceux de la Neue Sächlichkeit. Nussbaum est intéressé par les œuvres qui naissent alors, comme par la Nuova metafisica italienne, dont Chirico est le principal représentant. L’artifice et le rêve imprègnent certaines de ses toiles. En 1931, La Place folle incarne une première rupture avec l’Académie prussienne des arts, que l’on voit défiler en rangs serrés non loin de la Porte de Brandebourg. Max Liebermann indéboulonnable président de cette académie est la cible désignée par le jeune peintre. La toile a du succès ; Nussbaum est invité à la villa Massimo en Italie. Ses œuvres de l’époque traduisent une déception. L’Italie ne l’inspire pas ; les ruines, les références sont surtout la cible de son ironie, dans des toiles rarement exemptes de sarcasme.
En 1934, il quitte l’Italie pour la Belgique. Son atelier berlinois a entretemps brûlé et une partie de son œuvre a disparu. Cela le contrarie mais n’arrête en rien son désir de créer. Les années qui s’écouleront jusqu’à sa mort à Auschwitz, en 1944, sont celles de l’inquiétude, puis de la peur, et de la prémonition du pire. Pas un tableau, dès lors, qui ne traduise l’un de ces sentiments. Et comme beaucoup de ces tableaux sont des autoportraits, le regard du peintre rencontre celui du spectateur, pris à témoin, comme engagé dans le destin de Nussbaum.
C’est d’abord affaire d’horizon : Ferry pour Douvres ou Forêt de mâts, deux toiles peintes à Ostende en 1935 et 1938 disent l’impossibilité de s’échapper, de quitter cette Europe continentale sur laquelle la menace grandit. Nussbaum veut-il d’ailleurs partir ? Sa compagne et lui vivotent, ne peuvent occuper d’emploi rémunéré en Belgique, n’ont qu’un visa provisoire, à renouveler chaque année. La famille du peintre a quitté l’Allemagne sans rien. Le frère est à Amsterdam, les parents en Belgique, dans une précarité semblable à la sienne. Dans Mascarade comme dans Le Secret, ce sont des faces un peu déformées, bouches à moitié ouverte, qui bouchent la perspective, sauf quand elle est fuyante et vide, ne proposant pas de réponse. Nussbaum qui aime les masques, les déguisements, en emprunte sur les toiles, mais rien de bien drôle là-dedans. Les nombreux autoportraits peints ou crayonnés vont tous dans le même sens : solitude, absence de perspective à tous les sens du mot folie.
Le comble est atteint en 1940 quand le gouvernement fait interner les réfugiés allemands dans des camps. Juif allemand, Nussbaum se retrouve comme bien d’autres à Saint-Cyprien, dans les Pyrénées-Atlantiques. La faim, le froid, la solitude, le manque de l’essentiel, tout cela apparaît dans des toiles qui sont autant de plans fixes sur la misère de l’enfermement. Une œuvre de 1942 appelée Saint-Cyprien en est le symbole ou le résumé : quelques détenus se tiennent devant des barbelés, autour d’une mappemonde bricolée, dans des teintes ocre et marron. Ceux que l’on voit de face incarnent les quatre « fils », quatre figures-clés de la Pâques juive : le sage, le méchant, le simple et celui qui ne sait pas. On attend une sortie d’Égypte dont atteste un homme portant baluchon, mais rien ne se produira, contrairement à ce qu’évoque le récit mettant en scène Moïse.
Nussbaum parvient à s’enfuir et à rejoindre sa compagne en Belgique. Des amis les hébergent, les cachent, ils se savent traqués, mais il peint. Les natures mortes sont le produit de ce confinement. Peu de choses suffisent pour travailler. Sur certaines toiles, on voit des morceaux de journaux évoquant la « tempête » qui s’abat sur l’Europe ou bien l’annonce d’une dérisoire « tombola ». La peur grandit, le sentiment de ne pouvoir échapper au sort tragique s’amplifie. Les toiles qui se succèdent montrent un homme enfermé dans des villes ou entre des murs, sans qu’aucune issue ne s’ouvre. En fond, souvent, des squelettes, des masques mortuaires, rappellent le goût du peintre pour l’œuvre de Beckmann, et celle d’Ensor qu’il avait croisé à Ostende, en des temps moins violents. Mais le rire du peintre belge est devenu rictus. Les bouches ouvertes, si nombreuses dans les toiles de Nussbaum, semblent hurler, ou se clore : on se tait, on est résigné ou abattu. Le Triomphe de la mort, peint en 1944 dans la clandestinité est une sorte de danse de mort, une sarabande sinistre illustrant le chaos : statues antiques en morceaux, partitions en lambeaux, pellicules de films déroulées, c’est tout un monde qui s’écroule tandis que des squelettes jouent des instruments, comme chez Bosch ou Bruegel. Nussbaum qui a sans doute vu le Guernica de Picasso s’en inspire, comme des œuvres terribles de Dix.
Exposer Nussbaum aujourd’hui est une façon de lui répondre à travers le temps, de placer son regard de spectateur dans le sien. C’est aussi partager une inquiétude qui ne nous quitte pas, une fois qu’on est sorti de la salle d’exposition. Les réfugiés ne manquent pas, les exilés sont nombreux, sans refuge, sans perspective. Le sort de ce Juif allemand était scellé dès 1933, peut-être avant ; quand on regarde les œuvres intenses et violentes de Dix, Grosz et de quelques autres de leurs contemporains, on sent que la furie approche, et que son déferlement sera terrible. Les espaces figés de Nussbaum, les bouches qui murmurent ou sont près de crier nous l’annoncent.
Norbert Czarny
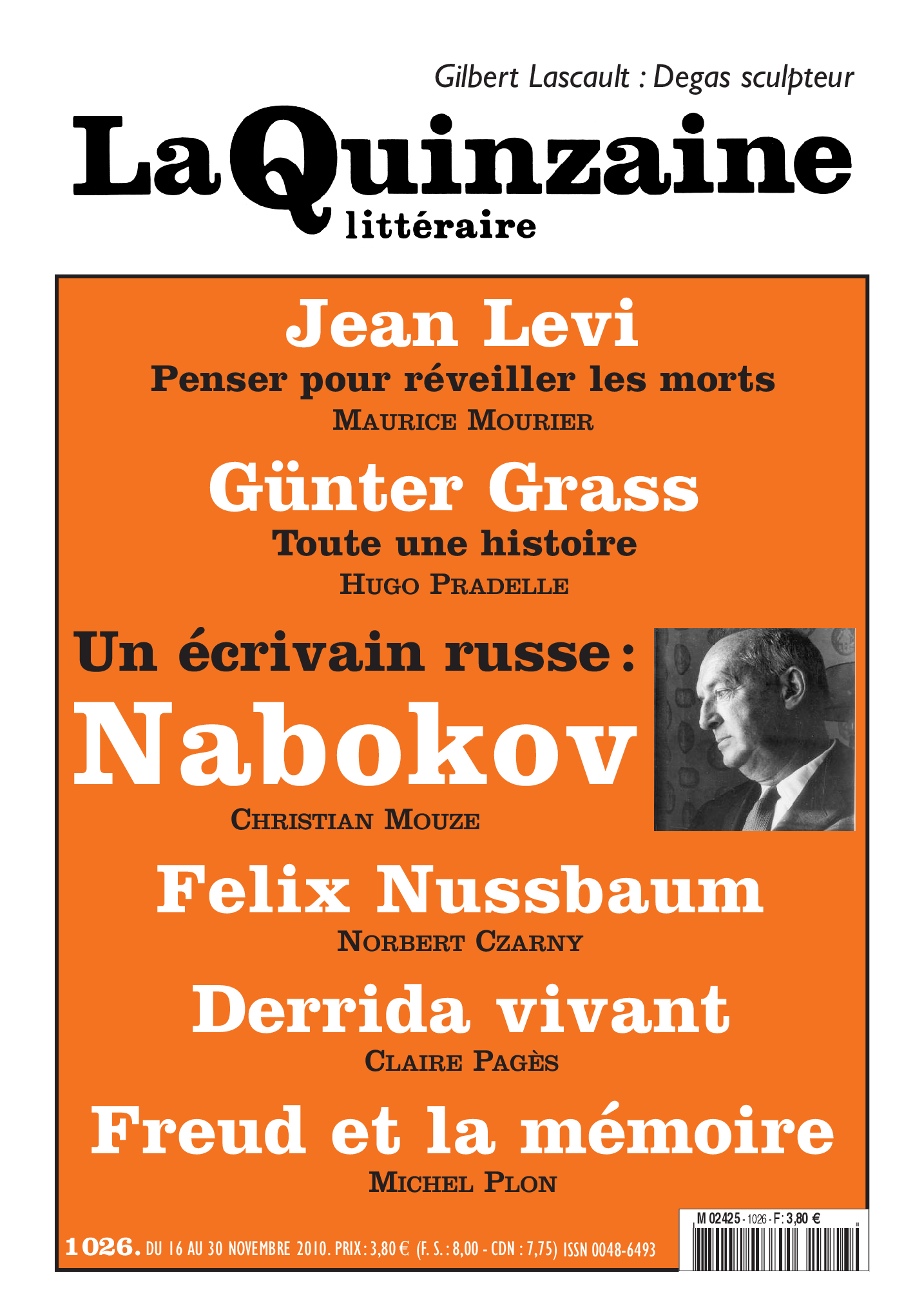

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)