La programmation avait été annoncée, par le service communication de chaque chaîne, comme un événement. D’abord parce que l’on allait tout savoir sur la tambouille des dircoms et des attachés de presse, ceux qui fabriquent des hommes politiques et accessoirement, des présidents. Ensuite parce que, vertigineuse audace, le personnage principal en quête du pouvoir suprême était, dans chaque cas, une femme. Les images télévisuelles s’impriment certes moins fortement dans notre mémoire, mais quelques téléspectateurs de 2006 se souviennent encore de L’État de Grace, série de six épisodes signée Pascal Chaumeil, dans laquelle Anne Consigny interprétait, de façon très convaincante (comme toujours), une présidente de la République, confrontée à tous les problèmes de sa fonction aggravés par ceux liés à son genre. Argument assez neuf à une époque où Ségolène Royal n’était même pas encore candidate à la candidature.
C’était également oublier un peu rapidement l’excellent film de Pierre Schoeller L’Exercice de l’État, récent prix 2011 du Syndicat français de la Critique, dans lequel les coulisses du pouvoir, au moins ministériel, étaient éclairées avec justesse. Mais c’était surtout oublier les grands précurseurs américains : si Tanner ‘88 de Robert Altman, évoqué ici même (QL n° 1 054), est toujours inédit, À la Maison Blanche (The West Wing) a été diffusé sur France 2 et sur France 4 – en 2001 et 2005, il est vrai, c’est-à-dire quasiment au Moyen Âge. Pourtant, quel que soit l’intérêt des deux séries présentées aujourd’hui, il faut admettre qu’elle font pâle figure comparées à leurs homologues anciennes.
Faute d’être spécialiste de la télévision étatsunienne, on ne peut affirmer que Tanner ‘88 est la mère du genre « électoral ». En tout cas, puisque la rétrospective Altman de la Cinémathèque nous a permis d’en déguster les deux parties (onze épisodes de 1988, quatre de 2004), on a pu admirer combien la série avait été pionnière : bien que le scénario soit seulement signé Garry Trudeau (Prix Pulitzer du dessin de presse 1975), on vérifie le génie d’Altman à jouer sur plusieurs niveaux, à joindre sans traces de suture réalité et fiction. L’idée de profiter des primaires démocrates pour l’élection présidentielle de 1988 en inventant un candidat et en lui faisant mener campagne était en soi intéressante, mais faire de ce candidat virtuel un « vrai » candidat, en le faisant rencontrer les autres protagonistes de l’élection (qui ont tous joué le jeu) et en le faisant participer, après des semaines sur le terrain, à la Convention démocrate de Chicago, donnait à cette idée une force et une véracité impressionnantes. Tout y était, les levées de fonds, le recrutement des bénévoles, les trajets en bus avec les journalistes embarqués d’une ville à l’autre, les alliances tactiques, la frénésie des derniers instants du vote, jusqu’à la défaite du héros (qui, dans une « vraie » fiction, aurait évidemment triomphé), le tout filmé magistralement, en un seul souffle.
L’impact de la série fut tel que, seize ans plus tard, Altman, au moment des primaires démocrates de 2004, put remettre ses pions dans le circuit sans avoir besoin de rappeler qui ils étaient. Plus question d’élection cette fois-ci, mais d’un documentaire sur la campagne de 1988, avec les mêmes acteurs incarnant les mêmes personnages (d’où le titre, Tanner on Tanner) et dans des situations semblables. Au fil des quatre épisodes, on voit ainsi défiler tout ce qui compte dans l’establishment, éditorialistes télévisuels et les candidats John Kerry et John Edwards (et même la première apparition d’Obama), qui plaisantent avec Tanner en souvenir des combats passés, dans un jeu de miroirs fascinant, qui sert de coda extrêmement réussie à la série d’origine.
Mais au même moment, une autre série politique occupait le haut de l’antenne. Lancée en 1999, The West Wing allait tenir en haleine sept ans durant les téléspectateurs. L’ambition du projet était majuscule : montrer l’arrivée à la Maison-Blanche d’un président démocrate (on était à la fin des années Clinton) et la machinerie du pouvoir, au plus haut niveau, dans l’aile ouest du bâtiment, là où les décisions s’élaborent dans le secret du premier cercle. Nul doute qu’Aaron Sorkin, le scénariste, ait puisé dans Tanner ‘88 quelques idées, ne serait-ce que le recours au réel (de véritables « personnalités » interviennent dans l’action). Mais les 155 épisodes constituent, à notre connaissance, le corpus le plus intelligent sur le plan politique jamais produit par l’usine hollywoodienne (en l’occurrence la Warner). Et le plus remarquable par sa réactivité, intégrant à la narration tous les événements extérieurs : parmi vingt autres, le scénario de l’épisode qui a suivi le 11 Septembre est un modèle d’analyse et de retenue. Pas d’auteur à la Altman derrière ça, mais, comme d’usage dans les séries, une quinzaine de réalisateurs en alternance donnant à l’ensemble l’air de famille nécessaire (1).
La fréquentation de tels sommets rend forcément la descente vers la vallée un peu délicate. Non que les six épisodes des Hommes de l’ombre (réalisés par Frédéric Tellier) soient particulièrement décevants, mais quel que soit le professionnalisme du scénariste (Dan Franck, galérien de l’écriture, capable d’écrire sur tout), ou peut-être à cause de celui-ci, les ingrédients réunis semblent surtout provenir d’un placard à clichés : magiciens de la communication capables de sauver une situation catastrophique avec trois slogans et une opération blitzkrieg, politiciens prêts à vendre leur ralliement pour un maroquin, conseillers véreux, etc., avec les quelques inévitables rasades de sexe torride, il faut bien que le corps exulte. Certes, tout cela est vraisemblable (quoique l’on doive se pincer pour croire au policier sincère bataillant contre un mensonge d’État au péril de sa vie), mais la systématisation des camps – tous les bons d’un côté, tous les méchants de l’autre – rend le jeu univoque : une habitude, même moyenne, des séries télévisées permet de prévoir les retournements à la bobine près. Le seul élément moins convenu est d’avoir choisi une femme comme protagoniste principale, mais, bien que Nathalie Baye se donne du mal pour être à la hauteur de son personnage, elle souffre d’un défaut d’envergure majeur : que cette centriste sans aura, ex-maîtresse du président défunt, passe de quelques points dans les sondages à la victoire au second tour grâce à la baguette magique de son communicant, est d’ordre quasi miraculeux. Nonobstant, si le sérail garde ses mystères et l’ombre ses hommes, l’ensemble se consomme sans ennui.
Seconde offensive, les dix épisodes de Borgen que la chaîne Arte nous dispense jusqu’au 8 mars. Situation et personnages similaires – une Première ministre plutôt qu’une présidente, puisque nous sommes au Danemark. Sur le plan narratif, la série se place plutôt du côté de West Wing, par son choix de ne traiter que des affaires de pouvoir et non les arrière-plans douteux ou sexuels comme sa cousine française. Une responsable d’un parti centriste – décidément ! –, devenue, contre toute attente, chef du gouvernement, doit affronter toutes les tempêtes inhérentes à la position : coups fourrés, trahisons, alliances contre nature, retournements de parkas. Rien de neuf, sinon, a priori, l’exotisme danois – on connaît peu les rouages du Borgen, le Matignon de Copenhague. A posteriori, les magouilles y affichent le même degré de crapulerie et la composition d’une coalition est régie par des règles de distribution identiques, entre rhubarbe et séné. Notons cependant que la vision générale est encore plus sinistre que chez nous : à l’exception de l’héroïne (Sidse Babette Knudsen, que les amateurs des films de Jonas Elmer connaissent bien), tous les chefs de partis, des Verts à la droite extrême, travaillistes inclus, ne sont que des margoulins ou des fanatiques. Alors, le centrisme comme horizon indépassable ? Help !
- La série est disponible en DVD. Impossible pour qui a mis le doigt dans l’engrenage du premier coffret de ne pas aller jusqu’au septième, toutes affaires cessantes.

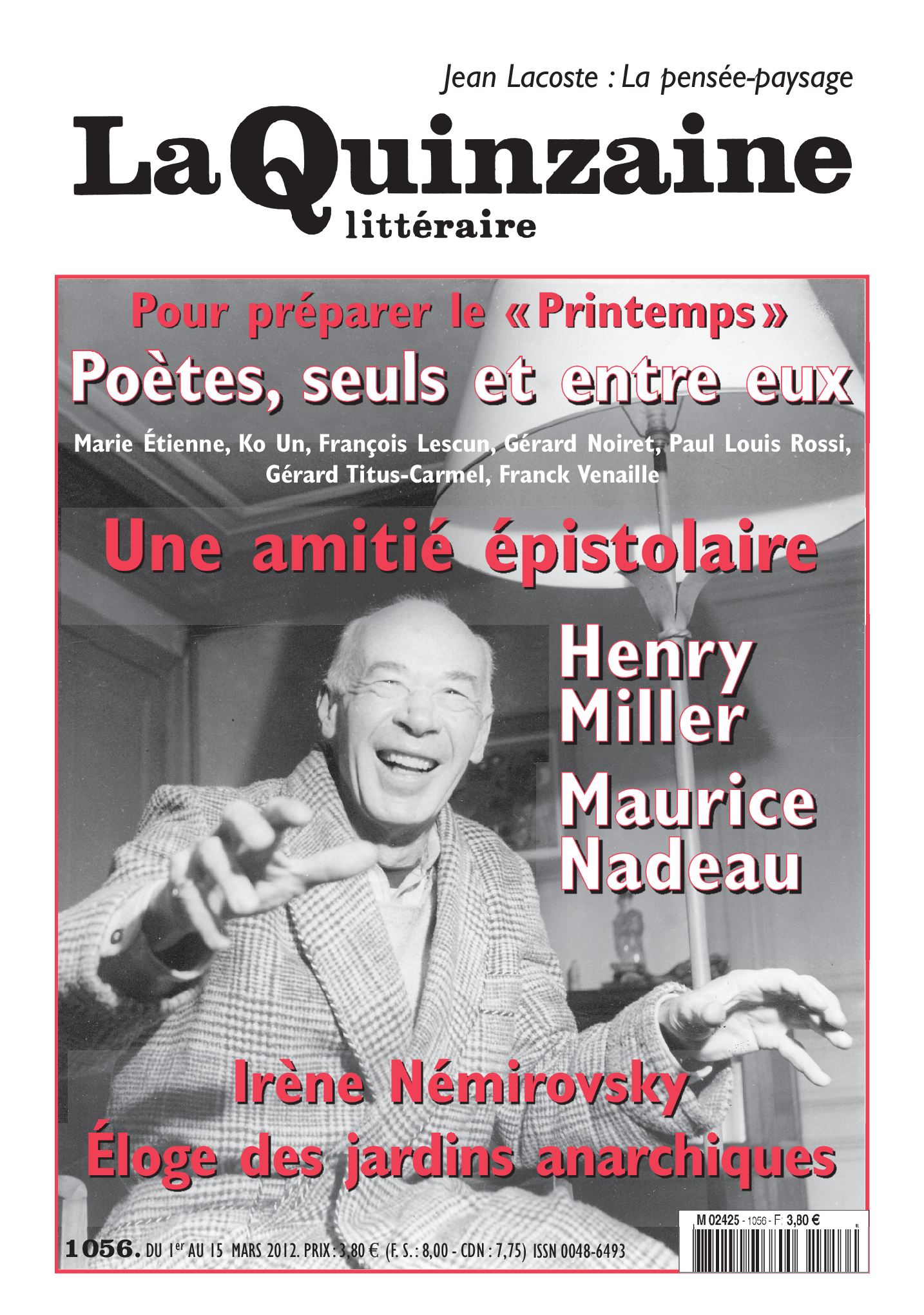

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)