Articulé en cinquante-deux courts chapitres abordant chacun un sujet particulier – de « Christianisme et nihilisme » à « Héraclite contre Spinoza » –, Penser encore est une sorte de livre-somme, de livre-confession ou testament d’un des grands penseurs de la seconde moitié du XXe siècle, qui s’appuie notamment sur la compilation d’écrits antérieurs. Un petit « Conche illustré » d’une grande clarté dans l’écriture et dans l’explicitation des concepts. À la manière de Montaigne, à qui il a consacré un volumineux ouvrage (Montaigne ou la conscience heureuse, Puf, 2015), Marcel Conche, après avoir offert à des générations d’étudiants de lumineuses leçons de vie et de sagesse, propose, « à sauts et à gambades », un ensemble composite de chroniques philosophiques développant, avec laconisme et pédagogie, un grand nombre de sujets qui lui tiennent à cœur. L’ouvrage est précédé d’une préface dans laquelle l’auteur rappelle sa définition, désormais classique, de la métaphysique : « La métaphysique a pour objet la totalité de ce qui est réel – le tout de ce qu’il y a –, et ne va pas sans une réflexion sur le "réel" ou l’" être", et la totalité. […] Il n’y a pas de preuves en métaphysique, mais seulement des arguments, dont la force convaincante dépend de la liberté de chacun ».
En quoi consiste par ailleurs la vérité de ce philosophe métaphysicien qui considère que, par essence, la Nature est artiste, qu’elle est le premier poète, le poète universel[3] ? « J’applique le critère de Kant, pour qui la pierre de touche de la solidité d’une conviction est le pari. Je veux bien parier ma vie que ma métaphysique athée est la vérité, et que ses adversaires vivent dans l’illusion. Des humains croient en une entité qu’ils nomment "Dieu" mais ce "Dieu" n’est que quelque chose dans leur esprit, alors que la Nature est sous nos yeux. » Considérée comme la source créatrice de la Totalité du réel, à l’exclusion du vide, la Nature naturante est infinie, donc simple, même si ses profondeurs restent invisibles. Mais il n’en est pas de même de la Nature naturée, c’est-à-dire de l’éphémère présence insaisissable des êtres qui étirent indéfiniment leur complexité vers un inconnaissable et mystérieux ailleurs.
Par conséquent, vu cette contradiction entre une source simple et infinie du réel (donc parfaite) et son devenir indéfini, donc inachevé, les secrets de la Nature interpellent vainement la pensée qui y perd ses primes intentions de recueillir l’universel à partir du simple, c’est-à-dire une vérité compréhensible par tous les hommes. Comme Marcel Conche l’explique dans son chapitre « Penser l’infini », la pensée métaphysique requiert donc de bien distinguer l’indéfini (la limite abstraite de l’horizon, la limite qui peut toujours être temporellement et spatialement repoussée) et l’infini qui lui inspire l’idée d’une totalité vivante, échappant pourtant à toute compréhension : « Dès lors l’infini ne peut consentir au fini aucune réalité indépendante en dehors de lui. Si Dieu crée le monde en dehors de lui, l’infinité de Dieu est un faux infini […]. L’infini englobe donc le fini. Mais si l’on imagine le fini comme statique au sein de l’infini, la conséquence est qu’il introduit la finité dans l’infini et en brise l’infinité. C’est pourquoi il faut concevoir que l’infini ne laisse pas le fini tel quel, mais le nie. Le nier n’est pas l’annuler, mais le conserver comme moyen et ayant part à la vie de l’infini ». La philosophie de Marcel Conche est en définitive un naturalisme tragique : la nature est éternelle, aucun monde ne l’est, ce qui débouche sur une sagesse singulière et sur une morale une et universelle. Elle apprend à habiter l’apparence et la nature, mais sans céder sur les droits de l’homme ; à penser l’infini, mais sans dévaloriser la finitude ; à se passer de Dieu, mais sans renoncer à aimer.
En outre, avec Pascal, Marcel Conche se demande : « Qu’est-ce que le moi ? » Existe-t-il un « signe du moi » ? Ce signe du moi, c’est la joie : « Il y a bien des degrés dans la joie, depuis les satisfactions banales, les petits contentements, jusqu’à la grande joie et de la grande joie jusqu’à la joie profonde. » Qu’en est-il par ailleurs de la nature du « moi » et des influences diverses qu’il subit ? Voici la réponse de Conche, pour qui le sujet est au fond ondoyant : « Mais beaucoup de personnes n’ont pas un moi unifié mais bariolé. Il y a des quantités de choses qu’elles ne savent pas rejeter, voyant leurs attraits – "ne savent pas", ou plutôt ne veulent pas, soit parce que leur volonté, faible face aux désirs et aux tentations, est ballottée au gré des influences, des circonstances et des occasions, soit parce qu’elles n’ont pas de volonté propre. Le moi bariolé est multiple ».
Comme dans son essai sur Montaigne, Marcel Conche met en avant l’idée que la conscience – celle de Montaigne comme celle de tout homme – est une conscience heureuse : être heureux est à portée de main, par la sagesse et le sentiment de l’être. Dès lors que l’on est sans faute et sans repentir, la condition du bonheur est simplement d’aimer la vie et de savoir la goûter à chaque moment, en réflexion et en sagesse – « sagesse » qui n’est que le « oui » de la vie elle-même. La vie est un don qui nous est fait et qu’il ne nous reste qu’à accepter avec gratitude. L’homme pourra ainsi atteindre l’ataraxie, concept auquel est consacré un court chapitre : « selon Épicure, l’ataraxie est la "fin" (télos) en laquelle consiste la vie bienheureuse. Pour moi, parce que la méditation suppose le calme, la dépréoccupation, le silence des passions, l’ataraxie est plutôt la condition du penser et de la vie philosophique ». L’ataraxie n’est pas le bonheur, elle est la condition du bonheur. Voici ce que Conche recommande à son lecteur : « Pour être heureux, il faut être délivré de la cura de Lucrèce, état de non-repos de l’homme qui ne trouve nulle part la paix et dont l’ataraxie est le contraire. »
La philosophie de Marcel Conche aurait-elle un côté négatif ? Reprenant un entretien avec Anita Kechikian paru dans Le Monde en novembre 1980 (« Nihilisme et sagesse tragique »), Marcel Conche, après avoir rappelé les difficultés que présente l’enseignement de la philosophie et particulièrement de la métaphysique, se demande si cet enseignement ne coûterait pas trop cher à la société. « À elle d’en juger. Je crois, toutefois, que la réflexion, bien conduite, est un principe de force et d’énergie pour l’individu et que la société ne perd rien, au contraire, à avoir en son sein des individus de cette sorte. » D’autre part, le nihilisme de Marcel Conche conduit-il à la désespérance ? « Il faut distinguer le nihilisme ontologique et le nihilisme moral – et politique. Le nihilisme ontologique et ce que j’appelle la "métaphysique du pire" n’entraînent aucunement le nihilisme moral, c’est-à-dire l’indifférentisme, la confusion et le nivellement des valeurs, le laisser-aller à un état de déliquescence et d’abandon. Ils invitent plutôt à une prise de conscience de l’autocréation et de l’absolue responsabilité de l’homme. » À l’homme donc de mettre en œuvre sa raison, que l’auteur définit comme « la capacité d’écouter autrui ». N’écrit-il pas, dans un chapitre intitulé « L’identité personnelle », que le moi est quelque chose à connaître ? Mais « le moi n’est ni une substance ni un être […] Reste qu’il est une liberté, et que tous les actes libres d’un individu ont en commun quelque chose qui soit la marque de cet individu. Cela c’est à chacun de le vérifier ».
En outre, dans la mesure où l’auteur, dès son enfance, s’est identifié à son âme philosophique (entendant par « âme » ce qu’il y a de plus personnel dans le moi), il en arrive à la conclusion suivante, qui est aussi une invitation adressée au lecteur : « Ma volonté, ou liberté, par laquelle se définit mon essence singulière, se voua à la recherche philosophique de la vérité, c’est-à-dire à l’élaboration d’un discours rationnel non scientifique au sujet du Tout de ce qu’il y a et de la place de l’homme dans le Tout. Ce choix de la philosophie comme choix de moi-même détermina l’axe de ma vie qui se continua au cours des années par une continuelle autocréation dans la fidélité à soi. » Or, un jour, ce moi ne sera plus. Comment alors aborder la question de la mort ? « La Nature, comme Vie, est immanente aux choses vivantes – et tout est vivant. Mais vie et mort sont des contraires et tout être fini est voué au changement en son contraire. Les vivants sont réduits par la mort en éléments inorganiques qui sont réemployés par la Nature. »
Dix chapitres sont consacrés à Spinoza. Marcel Conche, fils de paysan, a trouvé son chemin philosophique dans la physis grecque. Il est un admirateur de Pyrrhon, d’Héraclite et de Parménide, chez qui il est allé chercher la substance de sa philosophie naturaliste. « Physis » a été traduit par « natura » en latin, terme que Spinoza a repris abondamment dans sa philosophie. Comment Conche, qui reproche à la plupart de ses prédécesseurs occidentaux de n’être rien d’autre que des théologiens, peut-il fraterniser avec celui qui a consacré à Dieu le premier livre de son ouvrage majeur, l’Éthique ? Marcel Conche n’admet pas aisément sa proximité avec Spinoza – il faut en effet attendre l’un de ses derniers ouvrages, Présence de la nature (Puf, 2011), pour y trouver des références et un hommage appuyé au penseur du XVIIe siècle. Alors qu’il ironise une fois de plus à propos de Descartes et de Kant, qui ont prétendu trouver en eux-mêmes une idée de Dieu qu’ils devaient entièrement à leur éducation, il reproche à Spinoza d’avoir été incapable de libérer sa pensée de l’étreinte de la croyance. Or, Conche et Spinoza ont tous deux construit leur métaphysique à la fois contre le Dieu anthropomorphique de la tradition et contre le « cogito » cartésien. Finalement, la nature spinoziste, même si son autre nom est « Dieu », apparaît comme très proche de la nature conchienne. C’est moins Dieu qui sépare Conche de Spinoza que la question de la mort et de l’évaluation de l’existence humaine. Spinoza affirme que l’homme sent et expérimente le fait d’être éternel ; rien de tel chez Conche, dont la philosophie tente de nous débarrasser de tout désir d’éternité. Mais, par-dessus tout, il y a un « optimisme » chez Spinoza qu’on ne trouve pas chez Marcel Conche.
1. Marcel Conche, Sur Épicure, Les Belles Lettres, coll. « Encre marine », 2014.
2. Marcel Conche, Confession d’un philosophe : Réponses à André Comte-Sponville, Albin Michel, 2003, p. 10.
3. Marcel Conche, Épicure en Corrèze, Stock, 2014, p. 113.
Franck Colotte
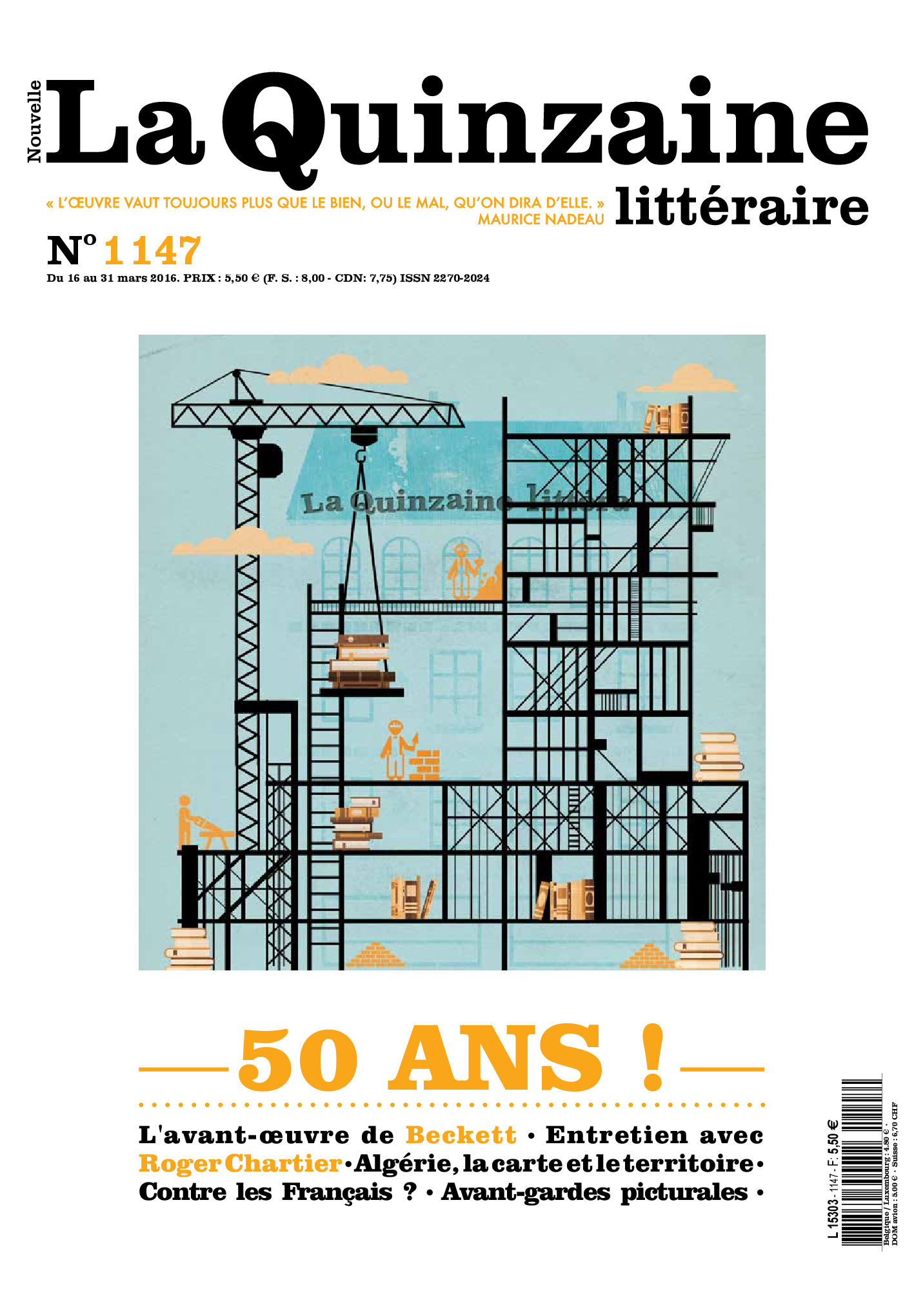

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)