P. D. P. : Selon vous, les travaux de Hannah Arendt influencent-ils encore les réflexions philosophiques contemporaines ?
Rémi Zanni : La question est difficile et ce particulièrement dans l'espace français et francophone. Bien qu'il n'en ait pas toujours été ainsi – elle-même aimait d'ailleurs à s'exclure du cénacle, se qualifiant plus volontiers de « théoricienne du politique » –, Hannah Arendt est aujourd'hui reconnue comme une philosophe à part entière. Son nom apparait relativement régulièrement dans la sphère publique et dans les réflexions intellectuelles, mais rarement de façon centrale. Une citation va être, de ci de là, mobilisée ; un argument arendtien particulier va être repris au service d'une autre pensée mais cette mobilisation s'avère bien souvent parcellaire. On convoque Arendt pour soutenir son propos mais il s'agit là d'un usage souvent utilitaire.
La chose peut s'expliquer. D'une part, l'anticonformisme (particulièrement vis-à-vis de la modernité) d'Arendt – trop à gauche pour la droite, trop à droite pour la gauche, aussi bien conspuée qu'invoquée par les conservateurs et les libéraux – rend intellectuellement bien plus facile de pratiquer l'inspiration à la découpe, ce qui occasionne parfois malheureusement des interprétations à l'honnêteté pour le moins discutable. D'autre part, Hannah Arendt n'a pas fait école. Peu de philosophes, et encore moins dans le monde universitaire, se réclament de l'ensemble de son œuvre ou de sa pensée. Sa méthode antisystématique, au caractère non-doctrinaire affirmé, son appétence à tenter de « penser sans barrière » en commentant des faits à l'actualité brulante, laissent peu de place à une descendance intellectuelle unifiée et rendent, certes pas impossible, mais étrangement problématique de se proclamer, aujourd'hui, ou de qualifier une idée ou une argument comme proprement « arendtien ».
Ainsi donc, paradoxalement, Arendt se trouve être massivement citée mais sa pensée très peu étudiée en profondeur, pour elle-même, comme une philosophie cohérente et subversive, et ce particulièrement à l'Université. C'est dans ce contexte et afin d'y remédier que nous avons fin 2024 fondé le Réseau Arendtien Francophone[1].
P. D. P. : On lit parfois que la pensée d’Hannah Arendt est et restera historiquement située. Cela pourrait-il expliquer qu’elle n’ait pas fait école ?
R. Z. : Certains – profitant du mépris affiché d'Arendt pour la pure contemplation et de son goût pour faire sourdre la pensée d'événements actuels – ont essayé d'accréditer l'idée d'une Hannah Arendt journaliste, dont seul l'emballage, en dernier recours, serait, du bout des lèvres, un tant soit peu conceptuel. Cela, effectivement, a pu participer à sa réception et à son isolement. On peut cependant – si l'on prend au sérieux et la philosophie exprimée d'Arendt et celle qui reste encore sous-jacente, à explorer – interpréter sa pratique comme, au contraire, relevant de la fidélité à l'idéal socratique contre un détournement platonicien. Peut-être la pensée arendtienne n'est-elle pas tant historiquement claquemurée que fondamentalement subversive à l'égard de la (grande) tradition philosophique, ce qui expliquerait, en sus des éléments que j'ai déjà soulignés, sa difficulté à se faire une place au cœur de l'institution académique.
P. D. P. : Quelle ambition poursuit le Réseau Arendtien Francophone, que vous mentionniez tout à l'heure ?
R. Z. : Je crois que l'ambition principale a été avant toute chose de créer un espace de discussion et d'écoute - qui n'existait plus vraiment, même au sein de l'Université - entre chercheurs, enseignants, doctorants, intellectuels et plus largement toutes les personnes intéressées par les textes et la pensée d'Hannah Arendt. Nous avons fait le constat de notre dispersion et avons réagi en conséquence. Notre site participatif nous permet de centraliser les publications et les événements consacrés à cette autrice, ainsi que de tenir un annuaire de tous ceux partageant notre intérêt, de près comme de loin et quels que soient leur statut, leur génération, le pays où ils habitent ou leur discipline favorite.
Cependant, je crois que notre démarche va aussi plus loin puisque, pour un certain nombre d'entre nous, l'enjeu consiste également à donner de l'élan à nos recherches, à stimuler les études francophones consacrées à cette philosophe, c'est-à-dire à affiner, grâce au débat et au travail commun de réflexion, notre approche de la pensée arendtienne. Peut-être cela nous permettra-t-il de proposer une compréhension plus élaborée, par exemple, du caractère profondément subversif de sa philosophie. Pour ce faire, nous avons mis en place un séminaire, qui commence doucement avec une séance en mars et en octobre 2025.
Par ailleurs, notre première journée d'étude (en ligne le 19 juin 2025) sera consacrée à cet adjectif qui peut à la fois qualifier une pensée ou un groupe d'individu se reconnaissant une filiation intellectuelle commune : « arendtien ». Que signifie-t-il ? A-t-il seulement un sens (et lequel ?) au vu de la pensée et de la méthode d'Hannah Arendt ou ne peut-il que trahir ? Nous étions, entre nous, en désaccord ; nous allons en parler et, s'il est probable que nous ne parvenions guère à établir une vérité éclatante à même de tous intellectuellement nous contraindre, sans doute aurons-nous tout de même compris plus avant nos concepts et notre monde.
P. D. P. : Si Arendt est inclassable et subversive, si elle s'est attiré tant d'inimitiés, peut-on envisager de « sortir d'Arendt » tout en intégrant ses théories à d'autres pensées constituées ?
R. Z. : C'est une très bonne question. On reproche parfois à Arendt d'avoir développé une conceptualité qui lui serait tellement propre qu'elle n'aurait de sens qu'en circuit fermé. Sa pensée tournerait dans le vide, si vous préférez. Elle serait esthétiquement agréable, plaisante à l'esprit, mais n'aurait aucune prise sur le réel. Sa conception du politique, par exemple, ne permettrait pas d'analyser les pratiques concrètes des gouvernants ou des citoyens.
Il me semble toutefois que cette critique ne résiste ni à l'épreuve des faits, ni à celle de la réflexion. Comment expliquer, si cela était le cas, qu'elle soit tant citée aujourd'hui, et ce dans autant de domaines, par des personnes qui ne se revendiquent pas particulièrement de sa pensée en général ? Et comment expliquer qu'elle se trouve, encore aujourd'hui, continuellement attaquée si, après tout, elle ne constituait qu'un système autoréférentiel ? Comment expliquer, enfin, qu'autant de ses textes tentent de penser à partir d'événements historiques, lointains ou proches, tels que le scandale des Pentagon Papers ou la révolution hongroise ?
Je crois que, bien au contraire, une des caractéristiques les plus appréciables de la pensée arendtienne réside dans sa disponibilité à la critique. Cela découle évidemment de l'antisystématisme d'Arendt. Que ça soit au travers des zones d'ombres subsistant dans ses raisonnements, des aspects qu'elle n'a jamais discutés ou sur lesquels elle ne s'est jamais appesantie, de certaines de ses affirmations dont on ne peut nier la nature parfois péremptoires ou des principes qu'elle affirma et défendit corps et âme et sur lesquels elle bâtit ses réflexions, il y a mille et une manières intellectuellement honnêtes de lui porter le fer, de la remettre en cause. La pluralité, qu'elle défendit si vivement en matière politique, semble véritablement à l'œuvre également au sein même de sa pensée, comme si celle-ci, de par ses partis pris ou l'attachement arendtien à la faire jaillir de l'analyse d'événements contemporains, avait été conçue pour pouvoir être critiquée.
Rien n'empêche de marier Arendt avec d'autres auteurs – et cela permet de penser. On peut prendre l'exemple d'Agamben qui l'a confrontée avec Foucault, dont on peut sans grand risque considérer la pensée comme radicalement divergente de celle de notre autrice. Certains des travaux exposés dans ce dossier le démontrent également. Pour ma part et pour prendre un troisième exemple, je pense qu'il y aurait des pistes très intéressantes à éclairer la pensée du travail d'Ivan Illich par celle d'Arendt mais aussi que ce dernier pourrait aider à élucider certaines apories laissées en legs par notre autrice. Une autre façon efficace de critiquer Arendt consiste à mettre à l'épreuve sa pensée en l'affrontant à ce qui nous arrive aujourd'hui, au monde tel qu'il est (devenu). Il ne s'agit bien entendu pas de tenter de savoir si Arendt aurait « prévu » telle ou telle dynamique, mais d'établir si et comment ses concepts peuvent nous être d'une quelconque utilité quant aux problèmes que nous affrontons, qu'ils soient politiques, moraux, techniques, sociaux, et donc s'ils disposent d'une certaine pertinence effective. Enfin, la meilleure arme critique envers Arendt, la façon la plus efficace de pointer ses limites et, éventuellement, les besoins d'élaboration conceptuelle plus poussée... est sans doute Arendt elle-même. Le caractère foisonnant de sa pensée nous permet de penser avec elle, contre elle, tout contre elle. Alors, sans doute dévoilons-nous rarement de nouveaux aspects de sa pensée mais, tout du moins, nous aiguillonnons la nôtre. Arendt aimait à rappeler la métaphore socratique du taon...
[1] http://www.reseau-arendt.fr
Patricia De Pas
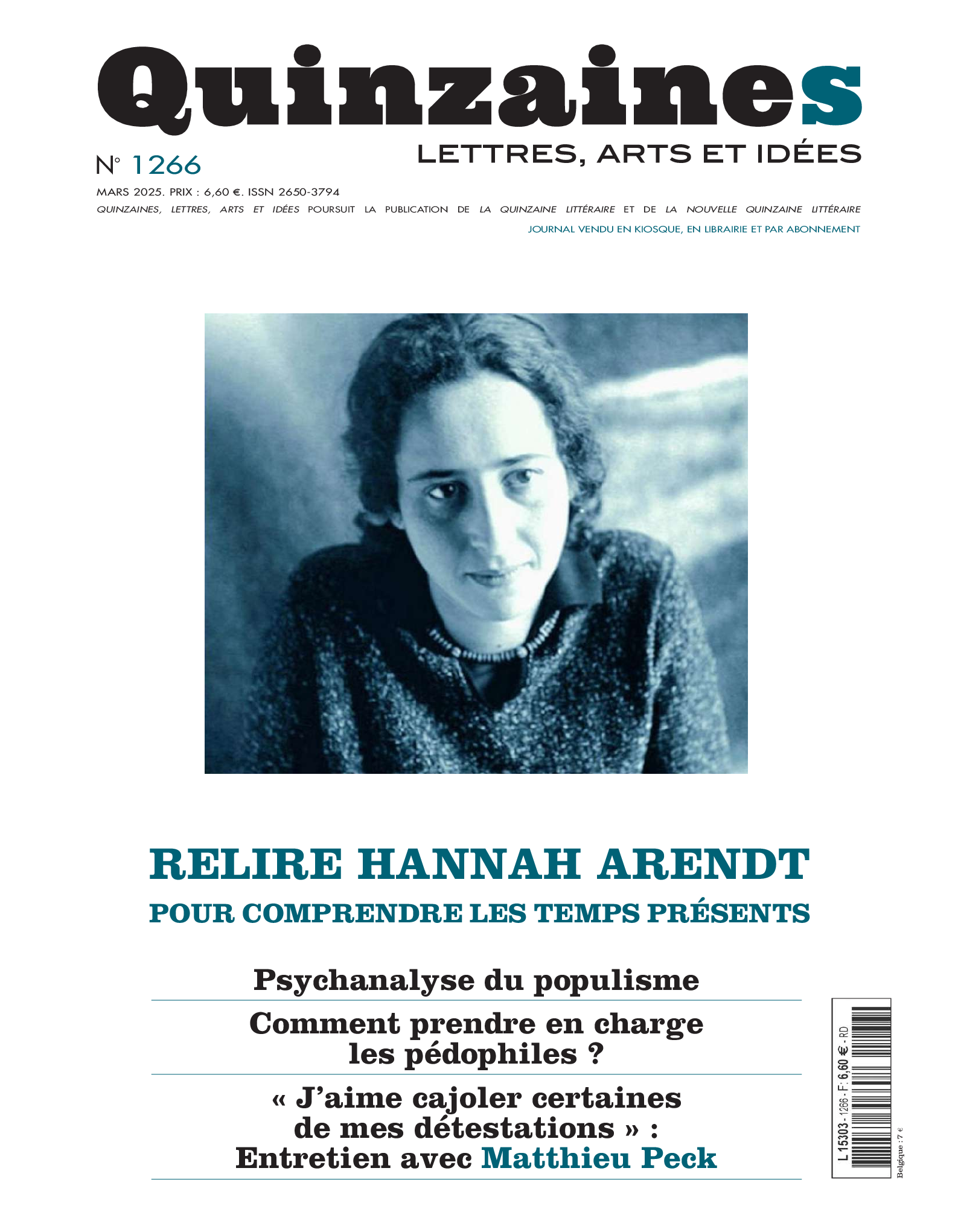
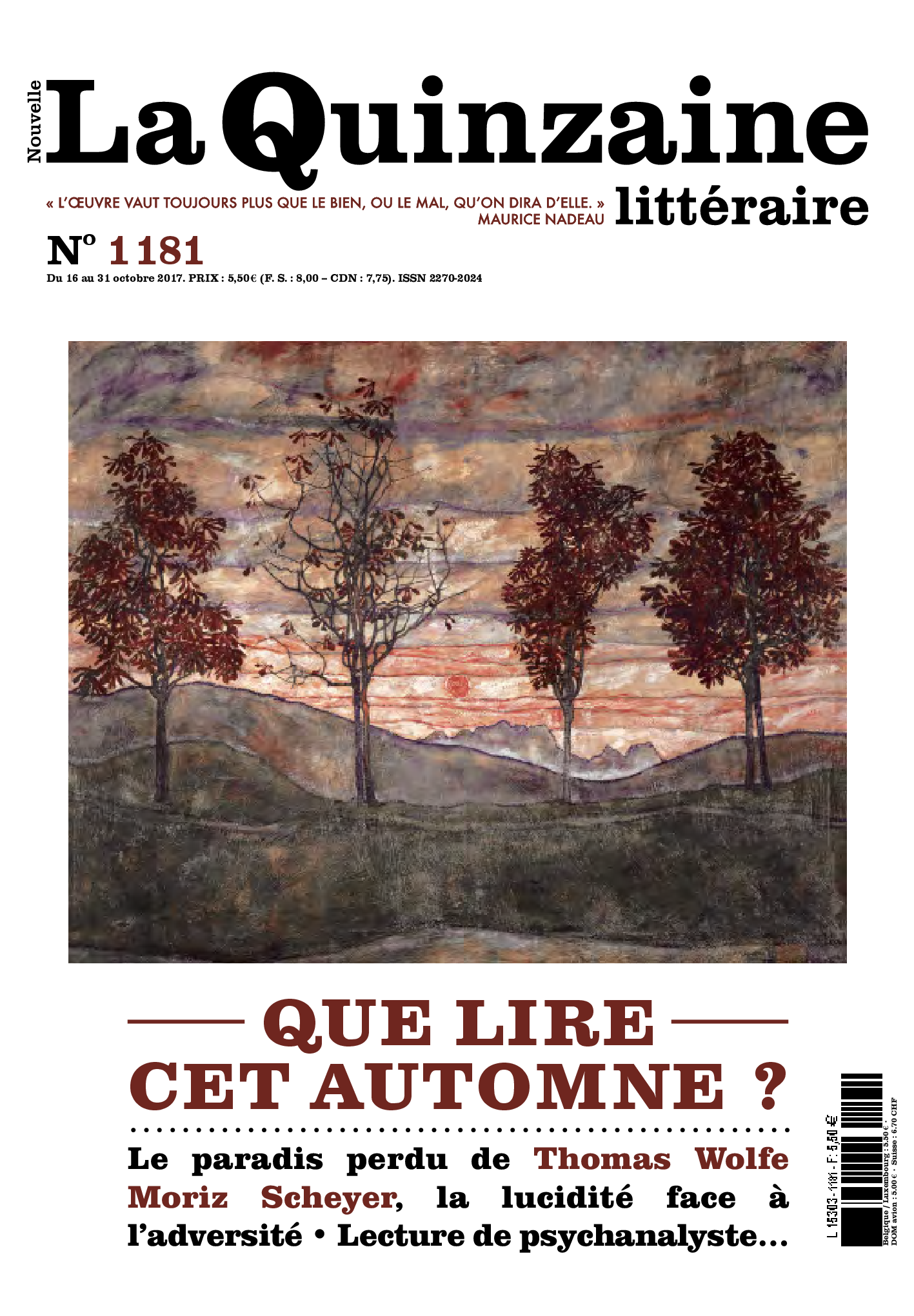
Commentaires (identifiez-vous pour commenter)