En prenant le temps de raconter chaque fait, aussi banal soit-il, et de montrer son incidence sur la vie psychique, l’auteur saisit avec une grande précision les angles morts de la conscience. Les normes de la société sont mises en brèche par sa faculté à restituer l’importance de ses propres perceptions et à faire de sa sensibilité toujours vive une force susceptible de dramatiser et d’embellir la réalité vécue dans l’instant présent. La vie intérieure devient beaucoup plus forte que la vie mondaine, car celle-ci n’a pas de prise sur celle-là.
En lisant Du côté de chez Swann, on peut être frappé par la paix qui règne à Combray : le malheur semble épargner le narrateur et sa famille. Le récit de l’enfance intensifie des expériences éprouvantes, quand il en minimise d’autres, peut-être plus graves, en les rendant anecdotiques : le narrateur explicite très bien son appréhension, voire son tourment, à l’idée que sa mère ne vienne pas l’embrasser le soir, alors que la mort de la tante Léonie, dont il est proche, est relatée au détour d’une phrase : « Je pris ensuite l’habitude d’aller, ces jours-là, marcher seul du côté de Méséglise-la-Vineuse, dans l’automne où nous dûmes venir à Combray pour la succession de ma tante Léonie, car elle était enfin morte. »
De même, toute possibilité d’un jugement critique qui aboutirait à une condamnation, qu’elle soit morale ou politique, est évincée. Les certitudes n’existent pas. La peur de se tromper, de mentir, non plus. L’écriture ne sert que l’acquiescement au monde tel qu’il est. L’ironie s’y glisse imperceptiblement, mais indulgente, moqueuse par dérision ou autodérision – comme lorsque le narrateur rit de lui-même, alors qu’il est à l’entrée de toilettes publiques et qu’il en apprécie la fraîcheur, cherchant ensuite à quoi lui faisait penser ce « parfum d’humidité » : « En attendant, il me sembla que je méritais vraiment le dédain de M. de Norpois : j’avais préféré jusqu’ici à tous les écrivains celui qu’il appelait un simple “joueur de flûte” et une véritable exaltation m’avait été communiquée, non par quelque idée importante, mais par une odeur de moisi » –, elle reste très en deçà de la volonté de restituer la force des perceptions sensorielles et l’émerveillement face au sentiment d’exister.
Que le narrateur soit naïf, qu’il se trompe à cause de son adhésion totale à l’instant présent, importe peu, puisque l’erreur humaine et la déception sont assimilées et dépassées, aussitôt qu’elles ont été rapportées. Ainsi en est-il de la représentation qu’il se faisait de son écrivain préféré, Bergotte, et de la désillusion au moment de la rencontre réelle : « Tout le Bergotte que j’avais lentement et délicatement élaboré moi-même, goutte à goutte, comme une stalactite, avec la transparente beauté de ses livres, ce Bergotte-là se trouvait d’un seul coup ne plus pouvoir être d’aucun usage, du moment qu’il fallait conserver le nez en colimaçon et utiliser la barbiche noire, – comme n’est plus bonne à rien la solution que nous avions trouvée pour un problème dont nous avions lu incomplètement la donnée et sans tenir compte que le total devait faire un certain chiffre. Le nez et la barbiche étaient des éléments aussi inéluctables, et d’autant plus gênants que, me forçant à réédifier entièrement le personnage de Bergotte, ils semblaient encore impliquer, produire, sécréter incessamment un certain genre d’esprit actif et satisfait de soi, ce qui n’était pas de jeu, car cet esprit-là n’avait rien à voir avec la sorte d’intelligence répandue dans ces livres, si bien connus de moi et que pénétrait une douce et divine sagesse. »
Le réajustement décrit est à l’image de la recomposition incessante du monde et des sphères qui l’animent, qu’elles soient psychologiques et révèlent les variations de l’âme, l’impermanence des sentiments, les attentes et les déceptions, les joies renouvelées de voir ceux que l’on aime ou qu’elles soient mondaines et montrent comment un même individu peut être porté aux nues ou déchu, selon le point de vue de celui qui le considère ou selon ce qu’il est devenu avec le temps. Ainsi ne s’agit-il pas de dresser des portraits d’hommes inaccessibles, vertueux ou monstrueux, mais de les montrer tels qu’ils sont, c’est-à-dire dans leur singularité et leur appartenance sociale, sans jugement de valeur. La retenue donne à l’écriture une rigueur et une élégance qui tiennent à la quête constante de la justesse et de la subtilité, seules à même de rendre compte de la complexité du vivant.
Dès lors, deux mondes coexistent : celui de Combray, paradis de l’enfance, lieu du refuge et des réjouissances intérieures, et celui de Paris, où les Verdurin puis Mme Swann tiennent leur salon. Aussi étrange que cela puisse paraître, jamais ces deux mondes ne s’excluent, ne se défient ni ne se rejettent. Et pourtant, tout les oppose : « Rien, moins que notre société de Combray, ne ressemblait au monde. Celle des Swann était déjà un acheminement vers lui, vers ses flots versatiles. » Dans ces milieux décrits, le trait le plus marquant est le snobisme : que ce soit celui des bourgeois ou celui des nobles aspirant à défendre leurs titres et leur « race », chacun exerce sur autrui son pouvoir d’intégration ou de discrimination. Ainsi les pages alternent-elles entre une vision très codifiée de la société et la solitude du jeune garçon, qui cultive, à l’insu de tous, le pouvoir d’enchantement de la vie.
Le narrateur est le garant d’une médiation possible, dans la mesure où il reçoit les moments heureux et les restitue sans les altérer. C’est l’écriture du consentement absolu. Une vision du ravissement et du transport de l’âme s’y déploie. Frustration et haine ont été bannies de l’univers mental au profit d’une forme d’enthousiasme, d’une persévérance à réaliser ses désirs, dont l’écriture restitue la force créatrice. Un événement anodin devient le territoire où l’aventure humaine s’écrit, comme s’il n’y avait aucune corrélation entre des faits exceptionnels et l’intensité de la vie, « le génie consistant dans le pouvoir réfléchissant et non dans la qualité intrinsèque du spectacle reflété ». Ainsi la narration est-elle abrasée, limitée aux seules rencontres éphémères ou déterminantes de l’existence, qu’il s’agisse de la vue d’un clocher, de la mer, d’une paysanne, de la femme la plus charmante de Paris ou des jeunes filles en fleurs… En une conscience décuplée et rayonnante, Proust traduit ces instants qui ouvrent à un sentiment de plénitude et d’exultation, et leur confère une gravité et une puissance qui innervent l’œuvre.
La beauté, qu’elle relève du raffinement ou de la splendeur d’un paysage, est saisie sans complaisance, avec exactitude, dans un va-et-vient permanent entre le monde extérieur, l’effet qu’il produit et la réminiscence, puisque la mémoire ne cesse de réactualiser la force de la sensation par la vibration de celles qu’on a oubliées. Ainsi, les travers de la société de Mme Swann, les conversations superficielles qui s’y tiennent, ont beau être restitués, ils n’enlèvent rien au bouleversement que ressent le jeune homme face à l’élégance de cette femme, présentée tantôt comme une cocotte écervelée et infréquentable, tantôt comme une femme qui exerce un charme sur tous les hommes, une femme qu’il ne cesse de contempler, alors même qu’il s’éloigne de sa fille tant aimée, Gilberte : « Et, comme la durée moyenne de la vie – la longévité relative – est beaucoup plus grande pour les souvenirs des sensations poétiques que pour ceux des souffrances du cœur, depuis si longtemps que se sont évanouis les chagrins que j’avais alors à cause de Gilberte, il leur a survécu, le plaisir que j’éprouve, chaque fois que je veux lire, en une sorte de cadran solaire, les minutes qu’il y a entre midi un quart et une heure, au mois de mai, à me revoir causant ainsi avec Mme Swann, sous son ombrelle, comme sous le reflet d’un berceau de glycines. »
Rien ne freine le narrateur dans ses élans et la recomposition des tableaux de la vie. Sa seule boussole est l’attention extrême à ce qu’il perçoit intimement et la restitution de ce qu’il a vu et senti. Rien n’est prévisible, dans la mesure où la volonté et les désirs sont incessamment déçus ou surpris. Trahir la moindre variation de l’âme, manquer la précision évocatoire, c’est s’éloigner du dessein qui consiste à faire de chaque instant un instant unique. Qu’on se sente étranger à cette société qui n’existe plus est un excellent signe : par la voix de son narrateur ou par celle de ses personnages purement fictifs, Proust ne tend pas à ériger des êtres universels, mais au contraire crée, pour chacun, une vision qui soit absolument singulière et par conséquent inimitable, à l’image de l’impermanence du monde et de la vie intérieure.
Valérie Rossignol
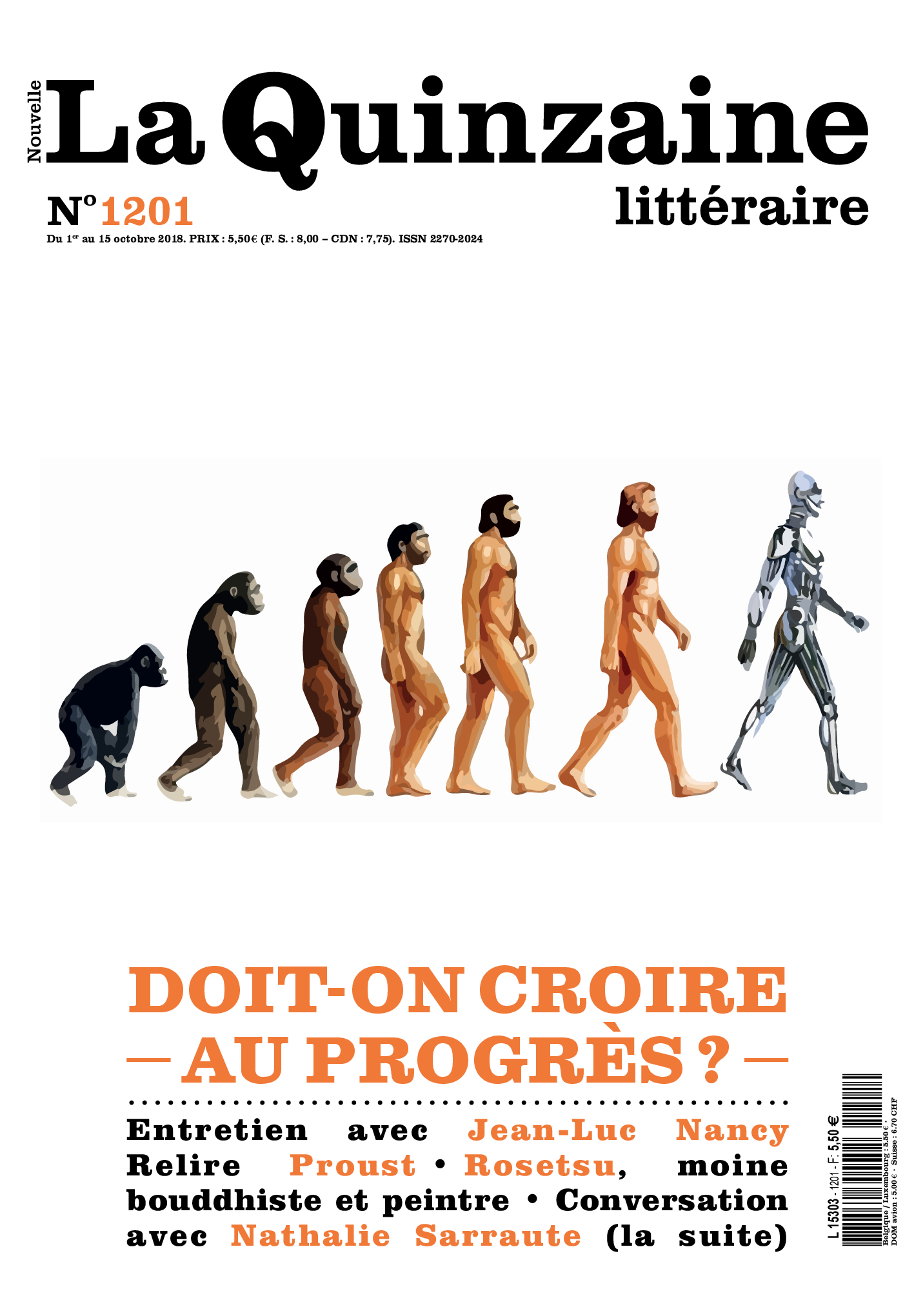

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)