En 1945, les Soviétiques au nord, les Américains au sud, se partagent de fait le territoire dont ils chassent les derniers soldats nippons. En 1948, l’indépendance de la Corée comme entité globale est proclamée dans l’attente d’élections générales qui n’auront jamais lieu, le Nord n’acceptant pas leur principe et le Sud organisant unilatéralement les siennes pour porter au pouvoir Syngman Rhee, vieil opposant aux Japonais qui se révélera très vite un dictateur anticommuniste obtus. N’empêche, pendant deux ans (1948-1950), au sud et au nord du 38e parallèle, certains se mettent à croire à la liberté.
Drôle de paix ! Elle est rompue le 25 juin 1950, quand le Nord envahit le Sud. S’ensuit un conflit atroce où l’URSS et la Chine s’opposent à l’Occident par guerre civile interposée, enfin, en 1953, un armistice précaire, ou plutôt une vague paix armée, qui dure encore et sépare radicalement deux peuples qui n’en ont pourtant toujours fait qu’un.
Dans ces conditions, est-ce une bonne idée de naître coréenne dans une famille de petits propriétaires terriens, sorte de bourgeoisie rurale, un peu au nord de Séoul et du futur parallèle de la discorde, en 1931, c’est-à-dire sous la botte japonaise ? En est-ce une meilleure d’avoir vingt ans au moment même où éclate la lutte fratricide qui va ruiner la péninsule, déchirer les clans familiaux, massacrer le peuple des villes et des campagnes ? Tel est le sort de Pak Wan-seo, qui deviendra, dans le Sud où elle a fini par échouer, un écrivain célèbre, et qui vient tout juste de disparaître, en 2011.
Hors les murs n’est pas un roman. L’auteur, qui l’avait publié en 1992, y raconte simplement sa vie, depuis sa toute petite enfance dans un village près de Kaesong, aujourd’hui en Corée du Nord mais tout près du no man’s land laissé en friche qui sert de rideau de fer entre les deux Corée, tout près de Séoul par conséquent, qui jouxte presque cette impénétrable frontière si sauvage qu’en 1963, quand on la contemplait depuis Pan Mun Jon, on n’apercevait que des bois hirsutes où les joyeux lurons de l’ex-bataillon français, maintenus en poste dans cette situation de ni guerre ni paix, se faisaient parfois parachuter nuitamment, en violation de tous les règlements, pour y chasser le gros gibier !
Pas un roman, certes, mais bien une œuvre littéraire et non pas un récit de vie insipide. C’est d’abord une question de matériau historique. Avec la succession d’épisodes dramatiques qui jalonnent le chemin suivi au cours de la première moitié du XXe siècle par la malheureuse Corée, même un compte rendu linéaire des événements comporterait suspense et coups de théâtre. Mais l’héroïne narratrice, dans la trame d’une chronique qu’elle semble suivre avec la naïveté de l’enfant puis de l’adolescente qu’elle fut, insère avec une discrète habileté l’aventure particulière de toute une lignée et l’atmosphère d’un pays disparu.
La Corée qui existait alors, des années trente aux années soixante, était une terre de paysans, au moins au sud, l’industrie étant concentrée au nord. Paysans aux plaisirs et aux mœurs très conditionnés par une nature qui, à la fin de la période, après bouclage de la frontière, commençait à peine à s’urbaniser. Sauf en quelques lieux circonscrits, on ne voyait encore partout que villages aux toits de chaume, entre lesquels, au cours des hivers de glace et de neige, les lampions rouges des kakis, attachés aux arbres dépouillés de leurs feuilles, mettaient comme une féerique décoration de Noël. Routes boueuses, mal empierrées, chauffage central par l’ondol, un plancher recouvert de carton huilé sous lequel circule, par un système de conduits situé sous la maison, l’air brûlant produit par un four à bois extérieur (on se couche directement sur cette surface unie et odorante, habillé de tissus molletonnés car la température extérieure peut descendre à moins trente degrés), printemps sec et éclatant qui ramène la joie de vivre : le récit d’une enfance heureuse est ici rempli de joies simples et profondes, de contact immédiat avec le réel le plus trivial (les premières pages du livre traitent avec beaucoup de verve rabelaisienne de l’excrément humain, essentielle denrée pour usage agricole), de courses dans les collines. Dix ans après l’époque où le récit s’achève sur la découverte à la fois horrifiante et extasiée de Séoul déserte et dévastée par trois ans de guerre, le spectacle du paysage naturel coréen restait enchanteur.
Ainsi l’expérience du monde qu’acquiert peu à peu l’héroïne, dans une famille où la mère, veuve, élève courageusement deux enfants, est-elle originellement conditionnée par la figure du grand-père, un « lettré » (du moins se croit-il tel) qui règne en tyran macho sur une maisonnée d’où les femmes n’ont pas le droit de sortir. Expérience utile, car la romancière future y forge ses premières notions de féminisme et cela d’autant que son frère aîné, devenu par le jeu d’un système clanique absurde et complexe un chef de lignage qui, dès la mort du grand-père, jouit d’une autorité étendue à toute la parentèle (même sur des adultes bien plus âgés que lui), ce garçon adulé et couvé par sa mère, déçoit rapidement tous les espoirs placés en lui.
Pour une part importante, l’histoire de la famille tourne autour de deux pôles : les alliances et la politique. Se marier est une grande et disons-le une sale affaire, dès lors qu’il s’agit, en principe, de demander l’avis de chacun, d’essayer de satisfaire tout le monde, et pour la belle-mère à qui a été imposée une bru souffrant de la tuberculose, de tout faire pour rendre à celle-ci la vie plus facile, même s’il faut, comme c’est le cas, la veiller à l’hôpital jusqu’à sa mort.
Ce mariage tragiquement interrompu apparaît donc comme le premier acte de rébellion d’un fils étrange, que sa mère et sa sœur admirent mais avec qui elles communiquent peu ou mal. Et les méandres de l’engagement politique n’arrangent rien. Sous l’occupation japonaise, la mère, femme audacieuse, à la personnalité attachante et déconcertante, a quitté la campagne pour Séoul, où sa pauvreté relative la force à habiter « hors les murs », dans un quartier populaire loin du centre. Toute son énergie, qui est grande, elle la mobilise pour gagner enfin ce centre convoité. Sa fille a eu la chance, grâce au grand-père, de parler et d’écrire le coréen, comme une paysanne, tout en commençant des études primaires en japonais, langue obligatoire. À l’école, puis au collège, bien que d’origine modeste, elle poursuit dans la voie officielle, cependant qu’au village ses oncles font des affaires avec l’occupant.
Au moment de la chute de l’Empire du Soleil levant, des personnes de ce genre sont des collabos et on le leur fait bien sentir. Mais le fils et la fille, à Séoul « hors les murs » puis au cœur de la ville, sont dans le même temps fortement attirés par le communisme, au point de militer dans des organisations plus ou moins clandestines, ou au moins de participer, à l’université, à des AG compromettantes, ce que désapprouve leur mère, fervente bouddhiste. Lors des troubles et des incessants revirements de la période de la drôle de paix, ils oscillent au gré du vent, surtout le frère que sa mère à la fois s’emploie à détacher du communisme, ne serait-ce que pour éviter des ennuis à ce jeune homme indécis et déjà père d’un enfant malingre, et finit pourtant par mépriser lorsqu’elle y a réussi, parce qu’un sens aigu de la fidélité la conduit à traiter en lâche qui a renié ses idéaux !
Admirable ambiguïté de l’amour maternel, séduisant personnage de femme inquiète, possessive, dépourvue de sens pratique mais non d’une vitalité hors du commun, d’une obsession noble et néanmoins ridicule de l’honneur ! À lui seul, ce portrait, non dénué du recul critique que permet un humour sous-jacent au texte et par là même décapant, confère un statut d’objet littéraire à ce qu’une lecture trop rapide aurait tort de classer dans la catégorie des mémoires sans prétention destinés à servir à l’intelligence d’une période désemparée.
Le texte s’interrompt ex abrupto sur l’évidence du fiasco de l’aventure coréenne moderne, dès l’abord si mal commencée. Mais une autre leçon se dessine en arrière-plan. L’héroïne narratrice, qui ramène avec sa mère courage, depuis le Nord qui va se verrouiller d’un coup jusqu’à Séoul en ruine, son frère blessé (et qui mourra), sur une vieille charrette déglinguée qu’elle traîne, s’est déjà transformée, sans le savoir autrement que par intuition soudaine, en cet individu autarcique, égoïste et inspiré qu’est, vaille que vaille, un écrivain.
Maurice Mourier
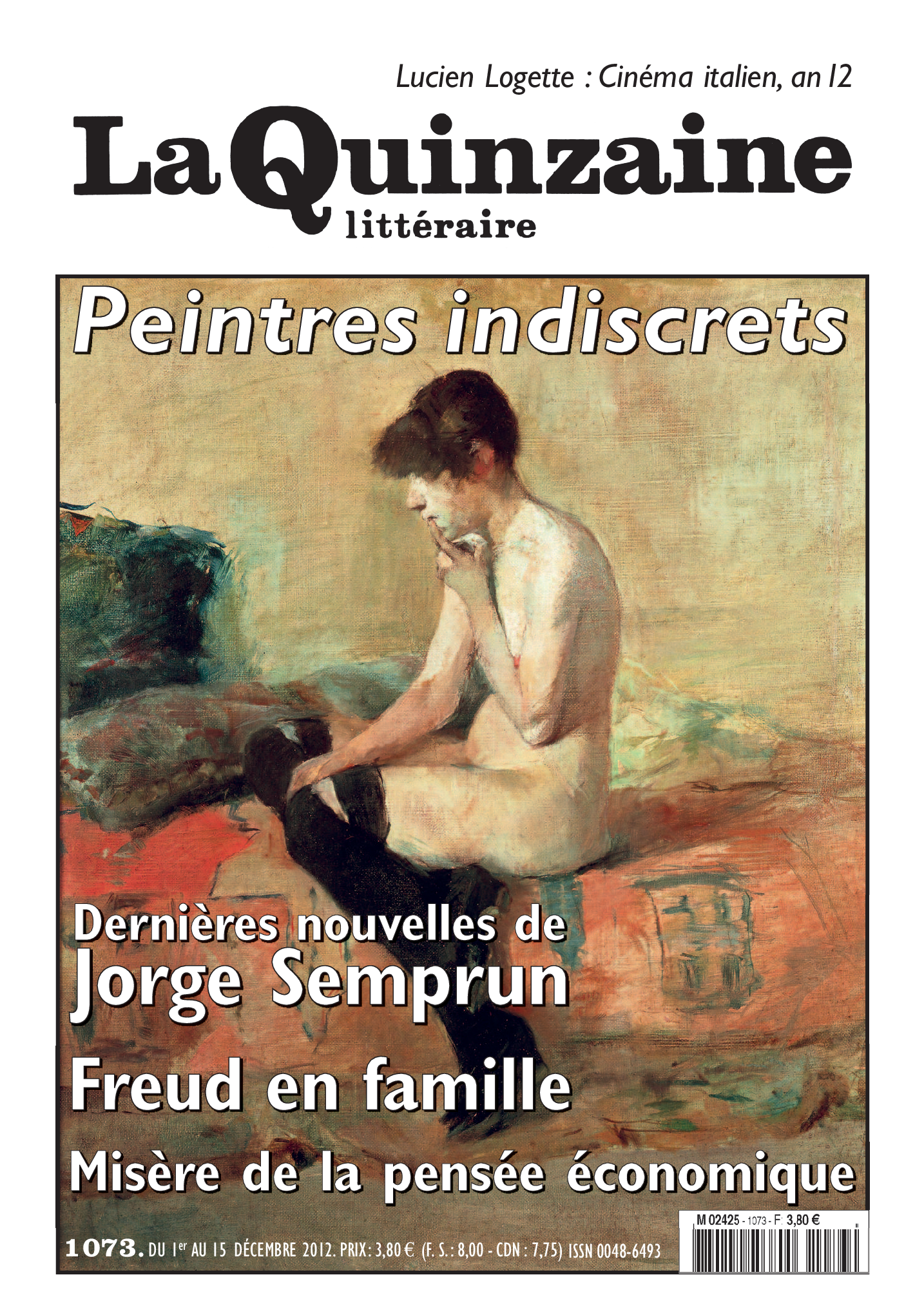

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)