De maison, Balzac changeait en effet souvent au cours de ces années (de ses 37 à ses 42 ans) qui auraient dû être celles de la consolidation définitive de sa fortune littéraire et de sa fortune tout court. Mais au fil des lettres, elles apparaissent plutôt comme celles de l’interminable fuite en avant, de l’épuisement physique, du jeu du chat et de la souris avec les créanciers et donc des déménagements successifs pour échapper à leurs griffes.
En 1836, il habite toujours rue Cassini (depuis 1826), près de l’Observatoire, mais il dispose aussi (depuis mars 1835) d’« une cellule inabordable » au 13, rue des Batailles à Chaillot, louée sous un nom qui n’est pas le sien (« Dr Mège »), où il se cache sous le patronyme inattendu de « Veuve Durand ». En 1837, après s’être réfugié dans l’appartement de ses amis Guidoboni-Visconti aux Champs-Élysées et y avoir été découvert par l’huissier de William Duckett, un de ses plus intraitables créanciers (ce sont ses hôtes qui paient la dette pour lui éviter la prison), il achète sur un coup de tête (le 16 septembre) une propriété avec jardin à Sèvres.
Commence alors la plus extraordinaire saga immobilière de Balzac. Cette demeure des Jardies, il n’a de cesse d’en agrandir le terrain par une suite d’achats compulsifs, puis d’y bâtir à grands frais et à crédit embellissements et annexes. En juillet 1838 il s’y installe enfin, ce qui l’oblige, afin de ne pas trop s’éloigner, « parallèlement » comme dira Verlaine, du quartier parisien des libraires, à louer à partir de novembre une chambre au 112 rue de Richelieu, chez son tailleur, un gîte bien commode car il comporte deux entrées – et par conséquent deux sorties… Mais quand ses dettes à l’égard de l’ami tailleur s’élèveront à 15 000 francs, il sera forcé de déguerpir précipitamment.
Nouvel achat d’une maison supplémentaire aux Jardies en mai 1839 : un mur mal construit s’écroule et, en juin, Balzac fait dans son jardin trop pentu une mauvaise chute qui le tiendra trois semaines couché et maugréant. Le 25 août 1840, une première saisie de la propriété est tentée par le créancier Foullon. Le 25 septembre, Balzac déménage donc son mobilier pour en empêcher la confiscation. Le 1er octobre une nouvelle location, cette fois au nom de Louise Breugnol, permet l’installation du romancier 19, rue Basse à Passy (l’actuelle « Maison de Balzac », 47, rue Raynouard, 16e). Il y vivra maritalement avec Louise, rebaptisée par ses soins Madame de Brugnol (et reçue comme intendante-maîtresse sans aucune réticence par sa famille, tout en étant soigneusement dissimulée à la jalouse Ève Hanska. Celle-ci, qui ferait la veuve idéale épousable dont il rêve depuis des années, la dernière fois qu’il l’a rencontrée remonte au 4 juin 1835 à Vienne, et il ne la reverra qu’en 1843 après la mort de l’époux polonais et convolera enfin, in extremis le 14 mars 1850, pour mourir le 18 août). Quant aux Jardies, le petit domaine est vendu « par adjudication judiciaire » 17 550 francs le 15 juin 1841 – l’achat initial avait coûté 45 000 francs !
La course désespérée après l’argent liquide remplit la correspondance. Pourquoi toutes ces dettes et ces fuites éperdues devant les recors ? C’est que le romancier (qui ne s’appelle jamais lui-même et à juste titre que « poète », en particulier dans les Lettres à Madame Hanska) pratique toute sa vie, et singulièrement au fil de ces années cruciales de la maturité, une ahurissante cavalerie. L’époque est celle où l’on bascule d’un régime artisanal de l’édition à la naissance d’une industrie lourde. Balzac tâte simultanément des deux systèmes et jongle entre eux. Aux « libraires » à l’ancienne, qui sont en fait des éditeurs minuscules à l’affût du « coup », il vend livre après livre pour un temps limité (ce qui permet, une fois ce temps écoulé, de revendre le même produit à un autre). Mais cette vente se fait non pas sur le manuscrit achevé mais sur un projet que la formidable jactance balzacienne transforme en réalité immédiatement palpable.
Il signe donc un contrat, touche une avance parfois considérable, la dépense et finit par honorer presque tous ses engagements, mais sous la contrainte des lettres de rappel, menaces, procès, tout en se montrant d’une exigence royale pour les corrections d’auteur (jusqu’à dix-sept jeux d’épreuves par page !). Cela explique la multitude des transactions et des documents contractuels, passionnants à étudier de près, qu’il noue et paraphe avec la Veuve Béchet, Buloz, Charpentier, Furne, Souverain, Werdet (qui finira ruiné).
Mais en même temps, lui qui fut président actif de la Société des Gens de Lettres et se battit pour défendre les droits de l’auteur, participe à l’essor de la grande édition, sous la férule notamment de Delloye, Lecou, Bohain dès 1836, puis d’Hetzel. Qu’est-ce qui le sauve, dans ses moments d’opulence ? La collaboration, dans l’ensemble très bien payée, aux revues puis aux quotidiens lancés simultanément en 1836 par Armand Dutacq (Le Siècle) et Émile de Girardin (La Presse) et riches de leurs feuilletons. Mais Balzac croit en ses propres capacités d’entrepreneur, point vraiment échaudé par le fiasco de sa brève carrière d’imprimeur et de fondeur de caractères en 1825-28, qui pourtant se solda par une première dette monumentale de 60 000 francs, contractée il est vrai auprès de sa famille et de « la Dilecta », sa maîtresse chérie, qui avait 22 ans de plus que lui et qui mourut en 1836 (nous n’avons presque rien de sa correspondance avec celle qui fut sans doute la mieux aimée de ses femmes, car le fils de Laure de Berny, sur ordre exprès de sa mère, brûla l’ensemble le jour même du décès et en avisa Balzac). Le fougueux stratège se lance donc personnellement dans la reprise d’un périodique, La Chronique de Paris, qui fait le 16 juillet 1836 une faillite à l’origine de l’efficace haine du créancier Duckett et de la perte des Jardies.
Une des étrangetés de la personnalité balzacienne apparaît dans les lettres de 1836 à 37 : incapable de gérer ses propres affaires, Balzac, en deux voyages transalpins, s’acquitte fort bien de la mission à lui confiée, en tant que « mandataire général et spécial » par les Guidoboni-Visconti, et règle, au mieux des intérêts de ses mandants, une succession embrouillée. Mais quand en 1838, alléché par des rumeurs, il retourne pour la troisième fois en Italie et pousse à bord d’un « pyroscaphe » jusqu’en Sardaigne où il compte exploiter des cendres argentifères abandonnées, il constate qu’une société de Marseille, qui l’a doublé et fera fortune, est déjà sur place, et rentre bredouille.
Longs voyages en cahotante diligence, parfois sur l’impériale comme un étudiant, par mesure dérisoire d’économie ! Ce sont des vacances néanmoins pour le surmené endémique, le premier départ surtout peut-être, où il est accompagné par une Caroline Marbouty de 33 ans déguisée en page : de cette présence érotique, pas un mot bien sûr à la Reine mère, Madame Hanska pas encore veuve et dont, quotidiennement, il entretient de loin les feux. Le Balzac de la quarantaine, qui commence à prendre des kilos, que les caricaturistes ne se privent pas de croquer en avatar porcin, est un homme couvert de femmes. Ne s’en étonnera pas le lecteur des deux « Quarto » Gallimard de 2005-6 dévolus aux premiers états des Nouvelles et Contes (nous en avions dit les mérites ici même, QL n° 938, 16/31 janvier 2007, où nous rendions compte également de la Correspondance I en « Pléiade »).
On y découvrait, page 1 739 du second volume, un portrait photographique tiré d’un daguerréotype. Balzac chemise ouverte, main droite aux doigts écartés posée sur la poitrine, fixe un point imaginaire (un point de son imaginaire intérieur) éloigné infiniment de l’objectif (de toute objectivité banale). Or il est beau de force léonine, et d’une magnétique évidence qui fait songer. Ajoutez à cela que furieusement mondain en dehors de ses orgies de travail, il était causeur éblouissant et, malgré un douteux excès d’élégance qui trahissait son parvenu, capable de tenir sous le charme un auditoire entier de dames oisives et énamourées, comme le raconte un de ses amis, le général baron de Pommereul (Nouvelles et Contes, page 1 583).
N’avait-il pas d’ailleurs toujours écrit pour les femmes, pour son amante Laure de Berny, pour la déceptive duchesse de Castries (ou plutôt contre elle), pour son amie George Sand, pour Zulma Carraud surtout, l’admirable provinciale qui l’accueillit si souvent à Frapesle, près d’Issoudun, après l’avoir rencontré enfant au Collège de Vendôme où, quasi délaissé par sa mère, il fut si malheureux dans les années 1807-13 ? De Zulma, l’unique correspondante capable de lui dire ses quatre vérités sur la dissipation, les dettes, les liaisons imprudentes (elle était sans doute elle aussi amoureuse de lui), nous trouvons encore ici des lettres fermement écrites, pleines d’intelligence et de pénétration.
Mais c’est vrai qu’il doit résister aux assauts d’une nuée de veuves, ou de mal-aimées, qui l’assomment d’éloges presque toujours à côté de la plaque, quand elles ne prétendent pas infléchir son œuvre dans un sens édifiant (ah ! ces chrétiennes frustrées, quelle plaie !). De temps en temps, une coquette joue avec lui à la mystérieuse, ce qui aguiche sérieusement sa bouillonnante sexualité. Avec une certaine « Louise », qui n’est pas Madame de Brugnol (future « belle écaillère » du Cousin Pons), il mord à l’hameçon mais, comme elle refuse de se dévoiler, se lasse. Combien a-t-il donné de rendez-vous dans le boudoir de La Fille aux yeux d’or ?
Le regret lancinant du lecteur, qu’au reste toute la correspondance de Balzac attise, sauf celle (rarement) entretenue avec Madame Hanska, naît de l’absence, dans la plupart des lettres, de considérations proprement littéraires, si bien que la longue épître du 29 mai 1837 à Maurice Schlesinger (oui, le propre mari de cette Élisa Foucault dont s’éprit Flaubert au point d’en faire l’héroïne en creux de L’Éducation sentimentale, sous le nom de Madame Arnoux !), où le romancier traite de si magistrale façon la question de son ignorance puis de son initiation à la musique – son correspondant dirigeait la Revue et Gazette musicale de Paris – constitue dans cet épais recueil une exception, et éclaire la composition, tout entière informée par la découverte de Beethoven, de César Birotteau.
Années de ruine, années de gloire : Balzac, aussi secret sur l’essentiel qu’il est bavard en société sur l’accessoire, essaie de triompher enfin (ce qui veut dire pour lui d’en finir avec ses dettes), et consacre, en dépit des frasques amoureuses, des voyages, des lubies commerciales, le plus nocturne de son temps à produire. Pour le théâtre, mais Vautrin n’a qu’une unique représentation, est arrêté par la censure le 14 mars 1840, d’où une catastrophe pour les commanditaires du spectacle, dont Balzac lui-même. Plus tard Les Ressources de Quinola n’intéressera pas plus Marie Dorval que Mercadet Frédérick Lemaître. Pour l’édition surtout et les chefs-d’œuvre s’accumulent : Le Lys dans la vallée, Illusions perdues, César Birotteau, Béatrix, Le Curé de village, Ursule Mirouët, tant d’autres…
De l’élaboration de tout cela, rien ne transpire dans une correspondance dont la famille a par ailleurs presque disparu (sa mère se plaint de son silence et du non-paiement de la pension qu’il lui doit pour compenser des dettes initiales toujours criantes ; sa sœur Laure, devenue Surville par mariage en 1820, se voit déchue d’un statut jusqu’alors privilégié de confidente principale). C’est dans ses rêves fixés noir sur blanc, dans Facino Cane, saisissante nouvelle publiée pour la première fois dans la Chronique de Paris du 17 mars 1836, que se lisent les fameuses lignes sur la genèse des fictions, quand le narrateur s’amuse « à suivre » un couple d’ouvriers, épouse « leur vie » et sent « leurs guenilles sur (son) dos ».
Alors seulement l’essence du génie balzacien se déploie et, pour nous qui sommes depuis tant d’années familier de ses fantasmes, le romancier-poète par excellence parle enfin d’une voix que nous entendons, toujours aussi distincte que celle du plus proche des vivants.
Maurice Mourier
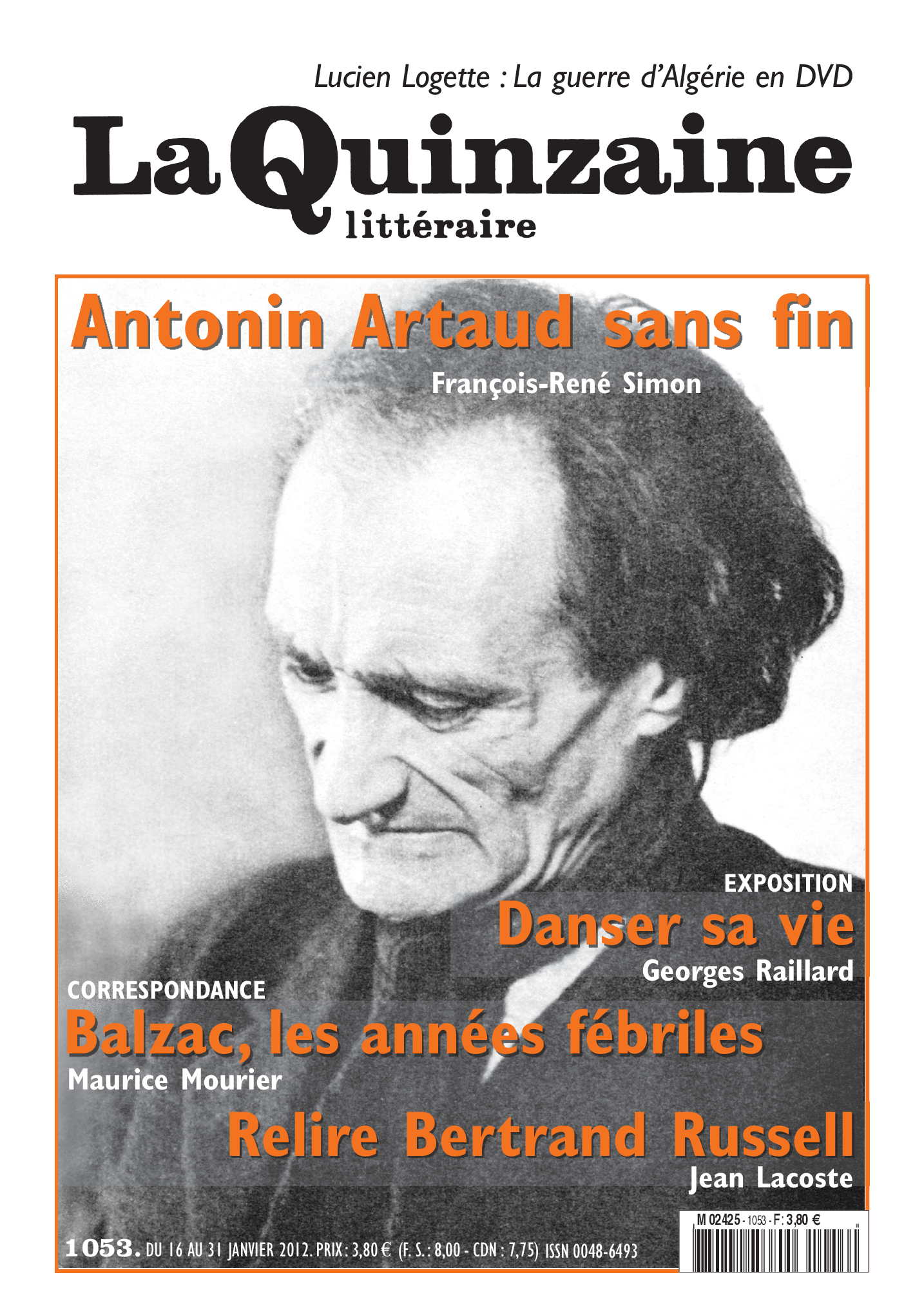

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)